Nos archives. Vestiges américains
Pour la série "Nos archives", Entre-Temps propose à des historiennes et des historiens d'exhumer un fragment de leur propre fonds d’archives pour en faire brièvement le récit. Ainsi se dessine une série d’auto-portraits et puis, au fur et à mesure des contributions, se constituera un fonds d’archives collectif, celui de l'écriture d'une autre histoire : celle que les historiennes et les historiens ont vécu et avec laquelle, consciemment ou inconsciemment, ils et elles écrivent celle des femmes et des hommes qui les ont précédé·es. Pour ce nouveau volet, Matthieu Letourneux évoque les souvenirs de thèse qu'on fait ressurgir les quelques dollars américains retrouvés dans l'un des tiroirs de son bureau.

Il traîne au fond d’un des tiroirs de mon bureau, sous un amoncellement de vieux papiers, trois billets de vingt dollars américains (Fig. 1.). Ils doivent y être depuis plus de vingt ans, au milieu de brouillons liés à ma thèse de doctorat, eux-mêmes recouverts par d’autres bouts de papiers, notes hâtives, prises au crayon sur des tickets d’entrée en bibliothèque ou sur les pages arrachées à un agenda (le dernier que je me sois acheté date de 2011), également abandonnées là. Sont rassemblés en vrac des vestiges de recherches passées, pour la plupart incompréhensibles ou sans intérêt évident, que je ne jette pas parce que je n’ai pas le courage de les trier, et parce que j’ai pensé qu’ils allaient me servir un jour (à l’instar de ce feuillet orné d’un « conserver » en majuscules, qui évoque l’« Émission de radio Sky King (1946-54), Cow boy du ciel », le « Périodique grec ‘Maska’ (1957) avec la fameuse marque des éditions du Masque » et le titre de deux romans populaires) (Fig. 2.).

C’est en cherchant dans ce tiroir un document susceptible de donner lieu à un article pour Entre-temps, que j’ai retrouvé les trois billets de vingt dollars, ensevelis sous les notes, et oubliés comme elles. De même que les documents, ces billets sont liés à des recherches passées. Sans apparaître comme des archives personnelles (ils sont dépourvus de marques ou de signes distinctifs, et auraient dû depuis longtemps être dépensés), ils font pourtant remonter à ma mémoire des activités d’une époque que j’avais oubliées, et qui appartiennent déjà, en un sens, à l’histoire des pratiques. S’il s’agit de documents d’archives, leur sens n’est donc lisible que par moi.
Ces billets sont liés à la préparation de ma thèse de doctorat, à partir de 1997. Après un DEA de Lettres consacré au roman d’aventures à partir de l’étude d’une œuvre de Stevenson, d’une œuvre de Joseph Conrad, d’une œuvre de Jules Verne et d’une œuvre de Pierre Benoît, j’avais décidé naturellement d’élargir un peu mon corpus dans la perspective de ma thèse, qui devait également porter sur ce genre. Mais pour cela, il me fallait en approfondir la connaissance que j’en avais. Or, à côté de lectures critiques et de romans en français et en anglais disponibles en France dans les bibliothèques et les librairies, j’avais accès à tout un réseau de sites amateurs. Internet, qui n’était pas très vieux, connaissait sa période de croissance chez les particuliers, avec ses pages et ses sites personnels (j’en avais moi-même réalisé un à cette période sur le roman d’aventures, Fig. 3.). Pour constituer mon corpus, je disposais donc des informations présentes sur ces sites, qui avaient souvent tout des fanzines en ligne. Très vite, à côté de Jules Verne, de Jack London ou même de Rider Haggard, pour lesquels il était facile de trouver des informations dans les bibliothèques françaises, je découvrais progressivement tout un ensemble d’auteurs, dont le portrait et les couvertures de livres étaient reproduits en basse résolution sur les sites en question : romanciers pour la jeunesse anglais (G. A. Henty, W. H. G. Kingston, Charles Kingsley…), auteurs de pulps américains (Talbot Mundy, Rafael Sabatini, Henry Bedford-Jones…) et toute la gamme d’auteurs de récits d’aventures, de thrillers et de romans plus ou moins bas de gamme, mais toujours oubliés (Rex Beach, Otwell Binns, Zane Grey…). Internet m’apparaissait ainsi comme une fanzinothèque à ciel ouvert, constituée de biographies et de bibliographies sommaires sur des auteurs de seconde zone, accompagnées tout au plus de considérations sommaires sur les qualités respectives des romans et des collections (Fig. 4.). Rien de tout cela n’était satisfaisant en termes scientifiques, mais cela m’ouvrait de nouvelles perspectives. Cinq ans plus tôt, sans accès à internet, il est peu probable que j’aurais eu connaissance de l’existence de ces auteurs. Bien sûr, il y avait en France des amateurs pour qui ces romanciers étaient familiers, mais pour un étudiant comme moi, l’effort aurait été trop important, la démarche, trop peu évidente et à défaut de cet accès, je me serais certainement contenté de travailler sur les écrivains les plus connus, ajoutant tout au plus à leur liste quelques romans de Thomas Mayne Reid ou de James Oliver Curwood, bien traduits en français. Mais avec internet et son nouveau réseau de pages personnelles, ma perception du genre se trouvait naturellement changée.

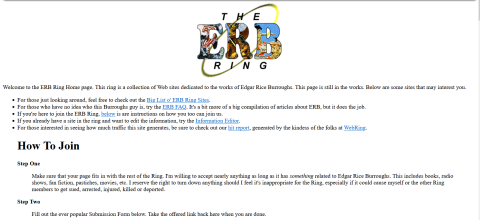
Reste que c’était une chose de constituer la liste de ces auteurs, de déterminer s’ils avaient publié leurs récits dans des dime novels, des Story papers ou des pulps et d’identifier ce qu’ils avaient écrit. C’en était une autre de les lire ou de disposer de travaux un peu plus approfondis sur eux. Pour les auteurs français, il était possible de se rendre à la Bibliothèque Nationale de France, éventuellement aussi d’aller voir les bouquinistes (j’avais d’ailleurs réalisé à l’époque une liste de ces librairies spécialisées, que je viens de retrouver pour l’occasion – presque tous ces libraires ont disparu). Mais pour les auteurs anglo-saxons, les choses étaient plus compliquées. Il n’y avait pas encore d’ouvrages numérisés en ligne, si l’on excepte une poignée de romans au format texte sur Gutemberg.org (The Prisoner of Zenda, « zenda10.txt », d’Anthony Hope ; The Monster Men, « monst10.txt », d’Edgar Rice Burroughs, etc.), que je téléchargeais et enregistrais sur disquette grâce à la rapidité de connexion des stations Sun installées à l’ENS. Mais pour les auteurs plus obscurs – ceux-là même que je découvrais sur les sites d’amateurs agrémentés de gif animés – il n’y avait presque rien en ligne, presque rien non plus à la Bibliothèque Nationale de France, tout au plus une poignée d’épouvantables traductions-adaptations à destination de la jeunesse.
Pour trouver les livres, il restait la solution du commerce en ligne, comme abebooks ou eBay, site vieux alors d’une année à peine. La version française d’eBay n’existait pas encore en France (elle a été lancée un an avant ma soutenance de thèse), mais le site américain avait déjà quelques années. On trouvait comme aujourd’hui ces romans populaires en quantité sur ces sites, dans des états souvent très médiocres, et à des prix étonnamment bas par rapport aux tarifs actuels. Quant aux ouvrages universitaires, ils étaient soldés à des prix dérisoires au gré des désherbages des bibliothèques universitaires. Pour les romans, on trouvait en particulier des séries au format standardisés de « meilleurs romans » d’auteurs comme Rex Beach, Sax Rohmer ou Talbot Mundy pour une poignée de dollars (Fig. 5.). Ces séries bon marché correspondaient à une pratique courante dans l’édition américaine, de vente par correspondance à petit prix : on en trouvait régulièrement la publicité dans les pulps et les magazines populaires américains des années 1920.

Pour acquérir ces ouvrages, il fallait à l’époque accepter un système de transaction un peu rudimentaire, car il n’existait sur ces sites aucun moyen de paiement électronique entre la France et les États-Unis. Il fallait donc envoyer l’argent liquide par la poste, dissimulé entre deux feuilles de papier dans une enveloppe, croiser les doigts pour que le vendeur reçoive le courrier (ou reconnaisse l’avoir reçu), attendre ensuite souvent plus d’un mois le colis adressé par voie maritime au moyen de sacs postaux dédiés, dans lesquels ces ouvrages quasiment sans valeur étaient jetés pêle-mêle.
Les premières années de thèse, le rythme des acquisitions était intense, et il arrivait fréquemment que je reçoive plusieurs colis par semaine. Aussi devais-je régulièrement m’approvisionner en dollars, dans un bureau de change. Ces trois billets de vingt dollars sont les derniers vestiges de cette période de constitution de ma bibliothèque de recherche. Je suppose qu’un système de paiement électronique les a supplantés, puis s’est généralisé. En tout cas, l’usage des billets de banque s’est tari et ces trois dernières coupures sont restées dans le tiroir, recouvertes progressivement par les notes associées à mes travaux suivants. Elles ne sont réapparues qu’à l’occasion de cet article, lorsqu’il s’est agi de rechercher un document susceptible de faire archive.
Ces billets de vingt dollars apparaissent comme la trace de pratiques quotidiennes d’un chercheur en gestation, liées à un moment médiatique aujourd’hui révolu : celui du développement de l’internet personnel, de l’accès croissant à des informations au niveau mondial, des processus de professionnalisation et de commercialisation de ce réseau, et de l’incidence de tous ces aspects en interaction sur les activités d’un jeune chercheur (trouver des informations, rassembler des documents, lire des œuvres). Ce moment médiatique instable (beaucoup de chose ont changé entre le début et la fin de ma thèse, en 2001) a déterminé des manières de faire, largement abandonnées depuis, mais qui ont eu une incidence sur mon rapport aux textes et aux supports. La façon de naviguer sur des sites d’amateurs de littérature populaire, de tenter d’identifier à distance les auteurs et les œuvres, de les commander et de les attendre, engageait un rapport aux corpus, aux textes et aux supports. Elle a favorisé une manière de travailler, une logique encyclopédique, bricolée et abstraite, une approche par le genre précédant la saisie des textes, un élargissement aux formes délégitimées, la nécessité, une fois les livres reçus, de se contenter d’une lecture diagonale, une attention enfin aux supports, et aux effets de séries qu’ils induisent parfois entre des œuvres et des auteurs différents. Quelques années plus tôt, faute de pouvoir accéder à des informations sur ces auteurs ou à leurs livres, je me serais sans doute tourné vers un corpus plus restreint et plus canonique, favorisant la lecture des œuvres dans leur spécificité plutôt que l’appréhension des séries (matérielles, médiatiques, génériques, culturelles). Quelques années plus tard, le développement des corpus numérisés et des publications scientifiques en ligne m’auraient permis de développer des approches plus authentiquement en phase avec les logiques sérielles, mais m’aurait en partie coupé de la matérialité des supports : j’aurais sans doute lu sur écran, sans tenir entre mes mains les dime novels, pulps, hardbacks et paperbacks, et sans percevoir nécessairement la variation des modes de lecture induite par les supports. Mes méthodes auraient été différentes dans les deux cas. Elles se sont d’ailleurs rapidement transformées, en même temps qu’ont évolué d’autres pratiques, périphériques au métier de chercheur, mais qui en alimentent les méthodes. Certaines ont fortement décliné : les systèmes de discussion amateurs et professionnels par Usenet, les forums de discussion, les échanges chez les libraires spécialisés (presque éteints aujourd’hui) ; le recours parcimonieux à la photocopie, la constitution de cahiers de notes manuscrites ; d’autres sont apparues, comme la lecture numérique (et leur saisie par le biais des moteurs de recherche), la photographie et l’archivage de documents et de livres, l’accumulation d’études sous forme d’articles et de livres en pdf, les drives partagés. En vingt ans, ce sont sans doute des dizaines d’autres méthodes qui ont été bricolées, parfois pour deux ou trois ans, à partir d’une mutation médiatique ou technologique en apparence très éloignée de la recherche – comme ce mode de paiement international – avant qu’une autre technologie ne change à son tour la manière de procéder. Mais à chaque fois, ces transformations souterraines ont fait apparaître de nouveaux objets, produit des effets d’attraction, suscité des questions, influencé les manières de penser, induit des pratiques, des choix. Nos recherches sont aussi le résultat de ces mutations très indirectes et de leur sédimentation.