À l’ombre ou au soleil : conseils de lecture pour l’été 2025
L'été n'approche plus, il est là, et avec lui, les conseils de lecture d'Entre-Temps. Roman, essais, bande dessinée ou autre : un peu d'histoire et d'histoires à glisser dans le sac de voyage, à ouvrir plus ou moins facilement dans le carré de sièges du train, à finir en profitant de l'air frais du soir, ou autrement. On vous donne rendez-vous à la rentrée, notamment avec un livre d'Entre-Temps à paraître dont on vous dira bientôt plus... Mais d'ici là, bon été et bonnes lectures !

— — — — — — — — — — — —
ROMAN – Sandrine Collette, Madelaine avant l’aube, JC Lattès, 2024, 252 p.

C’est une histoire sans date, qui se déroule quelque part entre la Peste noire et la Révolution. Certains lecteurs la situeront à l’amont, d’autres à l’aval de cette chronologie, mais aucun avec certitude. C’est une histoire sans date qui se passe à l’ombre d’un seigneur, dans la dureté d’un pays, d’une terre aride, du quotidien d’un hameau minuscule dont les habitantes et les habitants survivent – mais pas toujours.
Entre eux, il y a des liens, de famille mais pas seulement. Entre eux, au milieu d’eux, comme un nœud de ces liens, il y a une petite fille : Madelaine. Et ces liens, comme la vie même, sont mis à l’épreuve par l’enchaînement des saisons, la rigueur du ciel, de la pluie, du froid, de la faim ; par la violence de la domination seigneuriale.
C’est l’histoire sans date de Madelaine, qui se débat.
Élisabeth Schmit
— — — — — — — — — — — —
RECHERCHE – Isabelle Heullant-Donat, Élisabeth Lusset (dir.), Une vie en boîte. Cellules de religieuse et maquettes de couvent (XVIIIᵉ-XXIᵉ siècle), Éditions de la Sorbonne, 2025, 392 p.
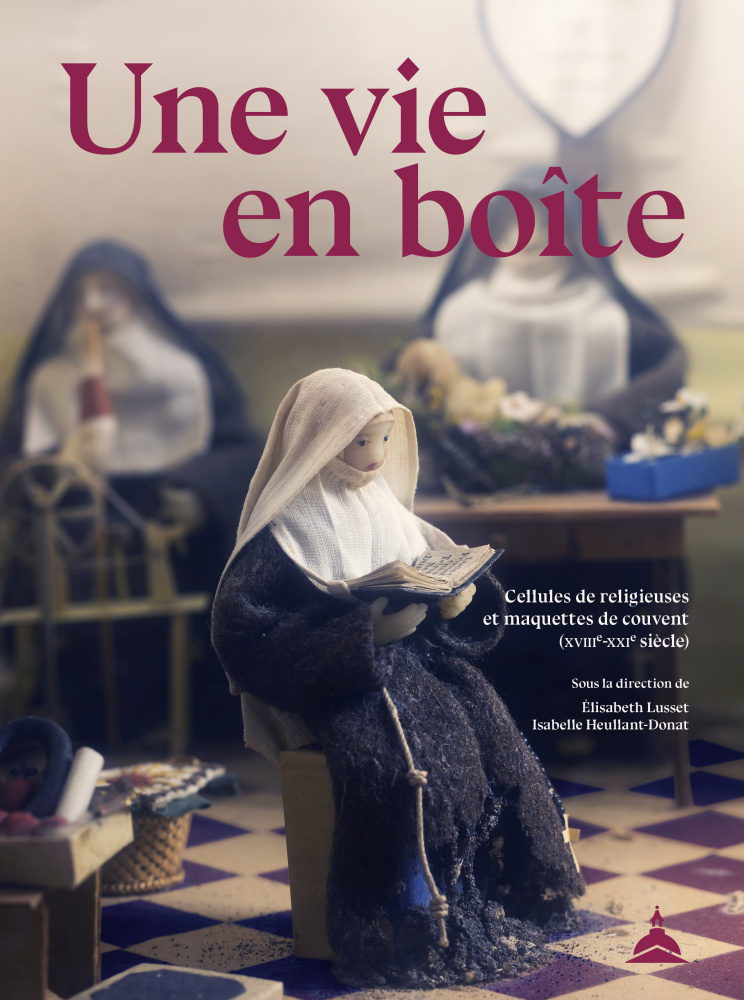
Il y a des objets mystérieux qu’un livre soudain fait exister. C’est le cas des maquettes de cellules de religieuses des XIXe et XXe siècles réalisées dans des couvents et qui ne faisaient jusqu’il y a peu que le plaisir de collectionneurs érudits.
Ils ont offert à Elisabeth Lusset de convier avec sa complice Isabelle Heullant-Donat un ensemble de chercheuses et chercheurs en histoire, spécialistes des mondes de la clôture religieuse ou des objets, mais aussi en histoire de l’art et de la photographie, à s’approprier ces objets. Chacun·e avec sa méthode, ses connaissances les a manipulés, les a déplacés, les a inclus dans d’autres séries d’objets et d’images …
Grâce à la mise en commun de ces regards divers, ces « boîtes de nonnes » acquièrent une valeur inédite et nous, lectrices et lecteurs, assistons fasciné·es à cette magnifique et exemplaire opération de savoir.
Philippe Artières
— — — — — — — — — — — —
BANDE DESSINÉE – Marion Montaigne, Nos mondes perdus, Dargaud, 2023, 208 p.
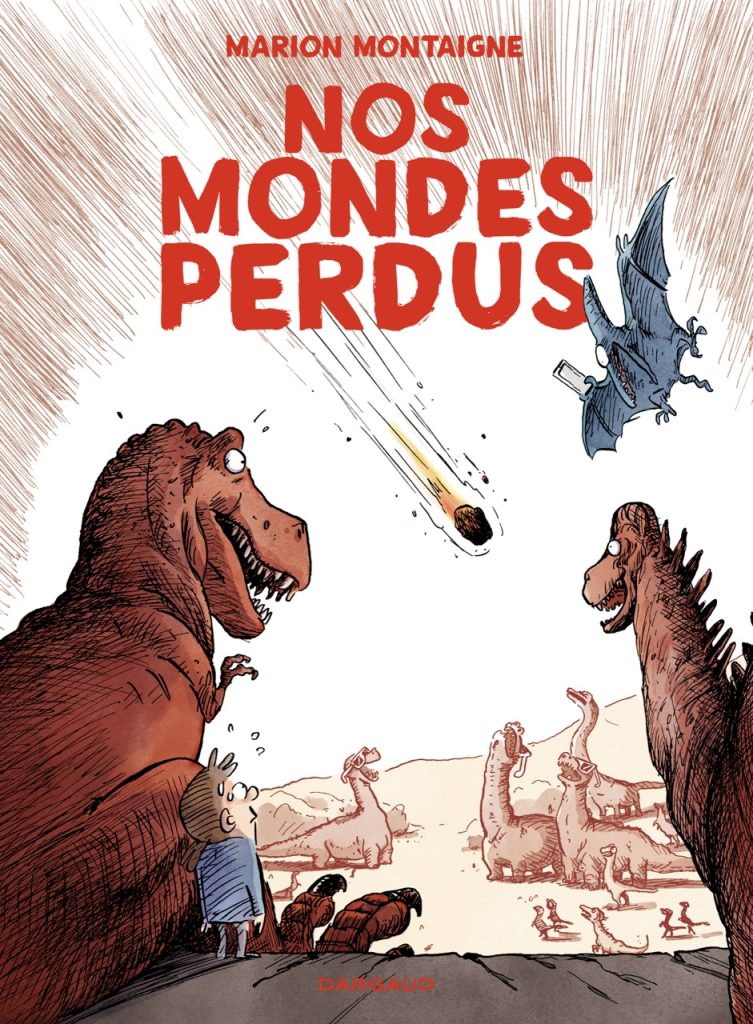
Il faut bien se l’avouer, il existe un pan de l’histoire que la revue Entre-Temps néglige cruellement : la période des dinosaures. Il est vrai qu’à l’ère mésozoïque humains et dinosaures n’ont pas été contemporains (l’écart est modique : 64 millions d’années entre les deux !). Or l’histoire s’intéresse principalement à l’être humain, et laisse les dinosaures à la paléontologie. Pour remédier à ce néanmoins terrible manque – car qui n’a pas été fasciné par les dinosaures étant petit (et même plus grand) ? – la bande dessinée Nos mondes perdus de Marion Montaigne est idéale.
L’autrice est déjà bien connue pour ses bestsellers Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même) et Dans la combi de Thomas Pesquet. Avec Nos mondes perdus, elle mêle autobiographie, récit d’enquête et histoire dans un réjouissant entrelacs dont la bande dessinée de vulgarisation a désormais le secret. Depuis le choc fondateur devant le film Jurassic Park (qui ouvre le récit), elle n’a cessé de s’intéresser aux dinosaures, à leur découverte et à leurs représentations. Elle mène ainsi l’enquête sur les débuts de la discipline de la paléontologie et ses différents acteurs et actrices pionniers, celles et ceux qui ont fondé la connaissance que nous en avons aujourd’hui. Par la même occasion, elle révèle ses propres craintes et obsessions, racontant la manière dont le dessin lui permet d’apaiser ses angoisses existentielles, notamment écologiques.
Irrépressiblement drôle, bien raconté et bien documenté (avec en appendice une table des sources précisant les libertés qu’elle a prises pour ménager son récit), l’ouvrage de Marion Montaigne confirme avec quel brio la BD peut permettre le partage des savoirs scientifiques d’une manière à la fois efficace, fiable et créative.
Margot Renard
— — — — — — — — — — — —
ESSAI – Nicolas Nova, Persistance du merveilleux. Le petit peuple de nos machines, Premier Parallèle, 2024, 240 p.
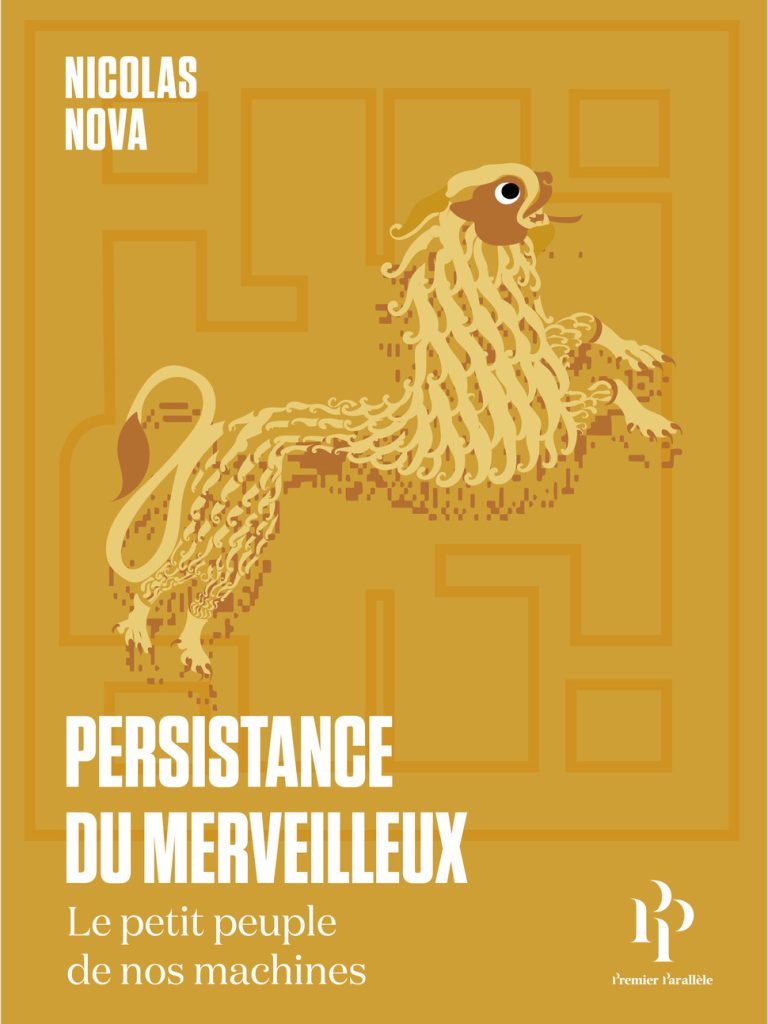
Il y a des années qu’on souhaiterait voir commencer sous de meilleurs auspices. Ceux sous lesquels s’est ouvert 2025 étaient résolument sombres, à l’annonce de la disparition de l’anthropologue et écrivain Nicolas Nova, parti le 31 décembre de l’année qui était en train de s’achever.
Ses livres, eux, sont toujours là, qui perpétuent la joie de sa démarche et l’inattendu de son regard. C’est le cas du dernier qu’il a fait paraître aux éditions Premier Parallèle, l’année dernière. Persistance du merveilleux, c’est son titre, comme un pied de nez, rappelant que le motif de ce qui perdure c’est aussi une pensée, surtout quand elle se déploie à la marge et à la frontière entre les disciplines. Son ambition : traquer dans notre univers numérique collectif les traces d’un désir inachevé d’enchanter le monde. « Explore Search Results Daemon will Damage your computer. » On peut ne pas s’arrêter à ce message d’erreur, et l’ignorer, cliquer et passer à la suite. On peut aussi s’y pencher, l’observer et le décortiquer. C’est ce que fait Nicolas Nova, en retraçant, parmi d’autres, la généalogie historique et imaginaire de ces démons de l’infraordinaire. Depuis son invention comme « divinité intermédiaire, entre les dieux et les êtres humains » dans la culture grecque populaire, l’auteur retrace la trajectoire de cette figure démoniaque, tantôt nuisible ou protectrice jusqu’à nos écrans d’ordinateurs, convoquant tour à tour Jean-Claude Schmitt, Paul Veyne ou Philippe Descola.
Si le spectre de l’IA et du bouleversement anthropologique dont elle serait porteuse plane sur le livre, Nicolas Nova nous rappelle qu’en donnant un certain sens – nourri de références, de connotations et de présupposés – à un monde qui semble se transformer à toute allure, nous en faisons une réalité et réaffirmons notre incessant besoin de (nous) raconter des histoires.
Pauline Guillemet
— — — — — — — — — — — —
RECHERCHE – Anne-Laure Porée, La langue de l’Angkar. Leçons khmères rouges d’anéantissement, La Découverte, coll. « À la source », 2025, 256 p.
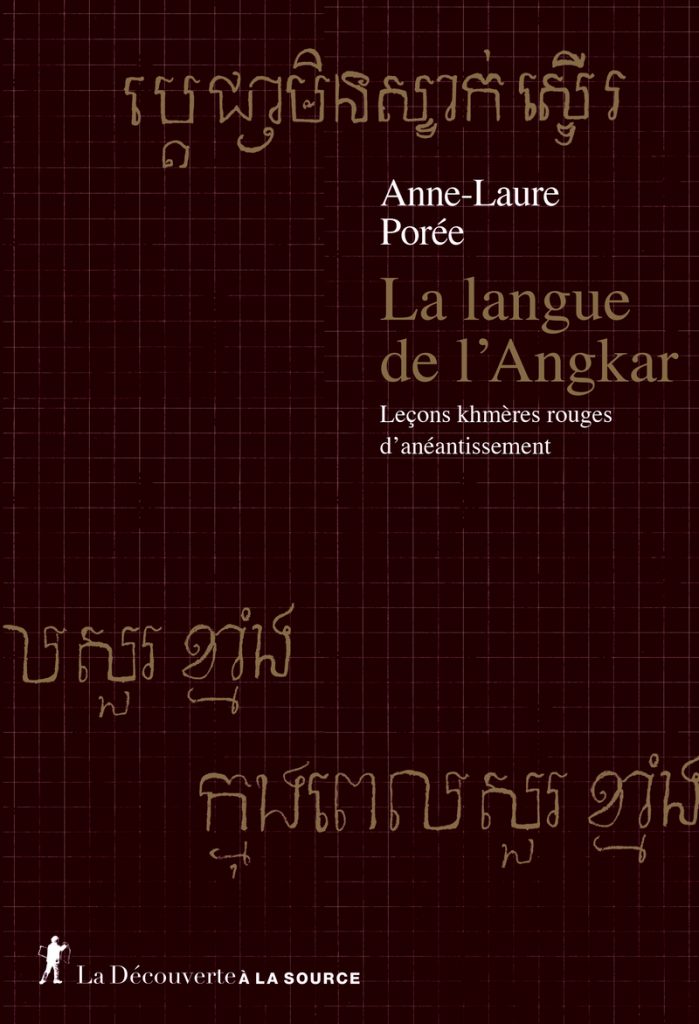
Avec La langue de l’Angkar, c’est un ouvrage frappant qu’Anne-Laure Porée a présenté au début de l’année 2025. Cinquante ans après le début du génocide conduit par les Khmers rouges au Cambodge, l’anthropologue restitue un document essentiel : un cahier noir de plusieurs dizaines de pages, manuel didactique destiné aux gardiens de la prison de S-21 où furent détenus et exterminés les ennemis du régime.
Depuis cet objet et les leçons qui y sont dispensées – parfaitement ordonnées et distinctement soulignées –, l’autrice nous conduit dans le quotidien des geôliers khmers rouges, au plus près de leurs mots et de leurs actes : discipline dans la posture, finesse des termes, application dans la violence… Avec ce livre, Anne-Laure Porée ne décrit pas uniquement une administration de la mort mais restitue avec une rare finesse la pensée – tout comme la pratique – politique des Khmers rouges.
Timothée Brunet-Lefèvre