Lectures estivales : une sélection de la rédaction
En ce début d'été, la rédaction d'Entre-Temps vous propose sa désormais traditionnelle sélection de livres de plage, à découvrir ou redécouvrir sous un parasol, dans l'herbe ou au fond d'un canapé... et vous donne rendez-vous à la rentrée!
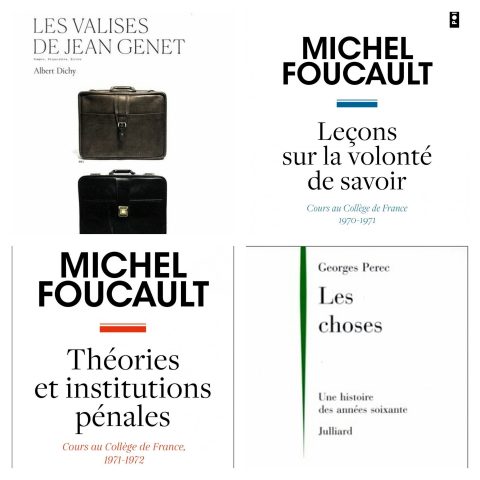
Des choses et d’autres
Par Philippe Artières
On dit que l’été 1966, sur les plages, on lisait Les Mots et les choses de Michel Foucault, pour cet été sous le parasol ou dans la chaise longue, on pourra lire les cours au Collège de France du même philosophe qui viennent de paraître en poche, ou on pourra préférer lire ou relire un livre paru un an plus tôt portant le sous-titre Une histoire des années 60 : le roman de Georges Pérec, Les Choses. Ce petit livre contient tout un programme, celui que développera dans les années suivantes l’écrivain avec la Vie mode d’emploi notamment, mais aussi celui dans lequel nous sommes engagé·es, en histoire en particulier : histoire par les objets, histoires des objets. Pérec invite aussi à lire le très beau livre album Les valises de Jean Genet d’Albert Dichy (imec ed. 2020). En avril 1986, quelques jours avant sa mort, Jean Genet confie à Roland Dumas, son avocat rencontré pendant la guerre d’Algérie, deux valises de manuscrits. Ce sont ces valises qui sont ouvertes, dépliées dans l’ouvrage, non pour révéler un manuscrit inédit, mais les archives d’un regard, d’une attention, d’une présence singulière au monde : celle d’un écrivain à l’histoire collective des années 1970-1980, des Black Panthers aux Palestiniens, des luttes autour de la prison au désir infini et réfréné d’écrire de l’auteur du Journal du voleur.
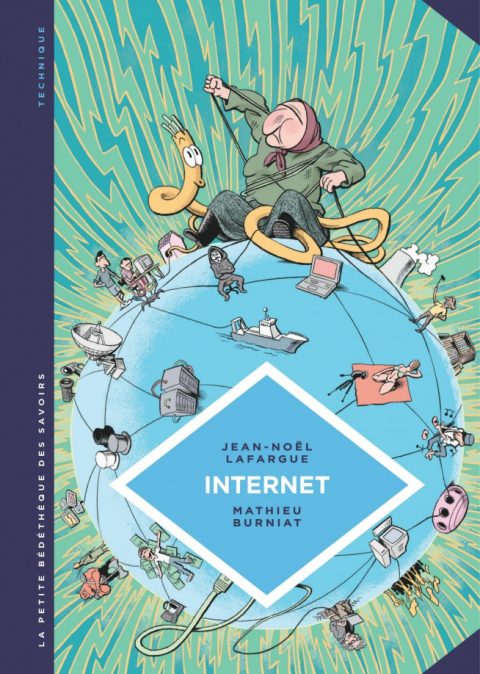
Jean-Noël Lafargue, Mathieu Burniat, Internet : au-delà du virtuel, Le Lombard, coll. « La petite bédéthèque des savoirs », 2017
Par Gaëtan Bonnot
28 mars 2011, près de Tbilissi, capitale de la Géorgie. Une femme âgée de 75 ans sectionne par mégarde, avec une pelle, un câble alors qu’elle cherchait du cuivre à revendre. Durant plusieurs heures, l’Arménie est coupée d’Internet. C’est que 90 % du réseau de ce pays est branché sur celui de son voisin géorgien…
Partant de cet événement bien réel, un dialogue s’engage entre le câble et la ferrailleuse, qui accepte de « voyager » avec lui dans le monde de l’Internet. Cette expédition, fort rythmée, emmène le lecteur dans les temps et les espaces du réseau planétaire pour en livrer une histoire au long cours, depuis des héritages anciens jusqu’à nos jours. Télégraphes optiques puis électriques, modems téléphoniques, débuts de l’internet, démocratisation progressive du web sont décryptés. Avec humour et gravité, des explications et des pistes sont données pour comprendre cet « objet » ubiquitaire du quotidien, et, plus généralement, certaines des inflexions du numérique, soulevant enjeux environnementaux, socio-économiques et éthiques.
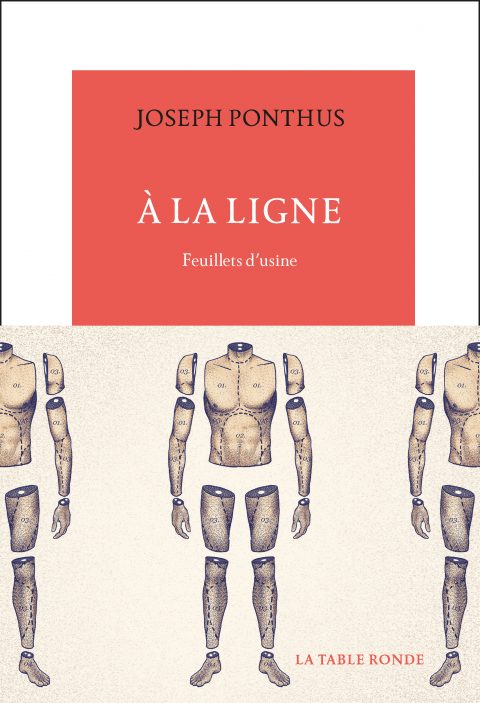
Joseph Ponthus, À la ligne. Feuillets d’usine, La table ronde, 2019
Par Louise Gentil
Chaque jour
Irrémédiablement
À l’usine
L’auteur nous emmène éprouver le rythme de la chaîne
qu’il donne à vivre par le passage à la ligne
et l’impossible ponctuation
À l’heure où la dématérialisation du travail nous est présentée comme un idéal, cette plongée au cœur des besognes nécessaires de l’agroalimentaire a quelque chose de jubilatoire. Par son journal de travail, Joseph Ponthus nous livre un instantané de vie ouvrière – sur la chaîne et en dehors. On comprend par l’enchaînement des livraisons, des pannes mécaniques et des discussions ces vies que le labeur cadence. Un texte essentiel et une belle prescription pour fuir la chaleur de l’été et le temps pandémico-arythmique. Cette balade poétique qui montre le corps à l’épreuve dans le froid des frigos peut se lire d’une traite en un après-midi ou jour après jour entre le café et la sieste.

Adrien Dénouette, Jim Carrey, l’Amérique démasquée, Façonnage Éditions, 2020
Par Pauline Guillemet
Un masque vert, une voiture-chien, un faux rhinocéros… la liste des objets est longue, comme une série d’artefacts, qui servent d’instruments aux métamorphoses burlesques successives de Jim Carrey dans le cinéma américain des années 1990. Car, à ces objets, correspondent des dates, 1994 : le masque de The Mask et la voiture de Dumb et Dumber ; 1995 : le rhinocéros d’une scène d’Ace Ventura en Afrique, qui devait être rognée par la suite pour cadrer avec les standards comiques de la télévision américaine.
Dans le livre qu’Adrien Dénouette lui consacre, Jim Carrey est comme une couche archéologique, dévoilant un certain stade d’occupation cinématographique et télévisuel, celui des années 1990 aux États-Unis. Ses films et les émissions qui l’ont fait connaitre, à l’instar du comedy show In Living Color, constituent de significatifs carottages révélant cette Amérique des années Reagan que le rire permet de saisir, en miroir inversé. C’est en images et par de courts chapitres, comme autant d’épisodes qui permettent de cerner l’époque, que l’auteur « façonne » une étonnante biographie de Jim Carrey, dans cet ouvrage porté par les éditions Façonnage qui, du stand up aux jeux vidéo, s’intéressent aux singulières « façons » de la popculture.
S’il cherche, comme son sous-titre l’indique, à « démasquer » l’Amérique, ce livre est aussi une histoire du gag dans la télévision et le cinéma américain, de Buster Keaton à Donald Trump, épopée dont la décennie 1990, véritable « fin-de-siècle », constitue l’une des périodes les plus curieuses et les moins convenues.
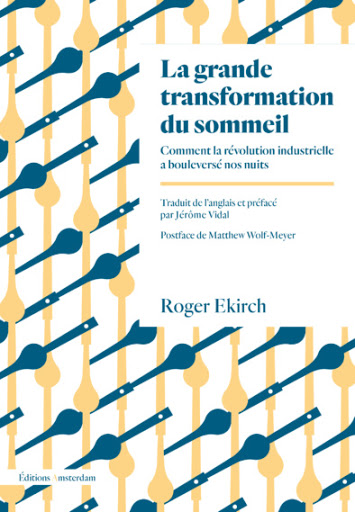
Roger Ekirch, La grande transformation du sommeil. Comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits, traduit de l’anglais et préfacé par Jérôme Vidal, postface de Matthew Wolf-Mayer, Éditions Amsterdam, 2021
Par Margot Renard
Et si la manière dont nous dormons était en réalité un construit, une habitude récemment adoptée ? C’est le sujet qu’aborde, dans une écriture claire et percutante, l’historien américain Roger Ekirch, dans La grande transformation du sommeil. Comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits, un essai traduit cette année aux éditions Amsterdam et rassemblant deux articles de 2001 et 2015. Le postulat de départ de Roger Ekirch ne manquera pas d’intriguer le lecteur : avant le XIXe siècle, la dite « Révolution industrielle », ses nouvelles cadences de travail diurne et nocturne et la mise en place de dispositifs tel que l’éclairage public, nos ancêtres auraient connu un sommeil en deux phases, comprenant un « premier sommeil » jusqu’à minuit ou une heure du matin, puis une phase de réveil d’une heure environ, au cours duquel on méditait sur ses rêves ou sur sa journée, on visitait les voisins, on fumait ou on faisait l’amour. Une phase de « second sommeil » suivait jusqu’au matin. Si les raisons pour lesquelles ce sommeil segmenté s’est perdu sont parfois difficiles à retrouver et nécessiteraient de plus amples recherches, Ekirch atteste de façon convaincante de sa transformation, et nous invite au passage à reconsidérer notre pratique d’un sommeil continu vu comme naturel, pratique muée en injonction à laquelle nombre d’entre nous a bien du mal à se plier. Se réveiller au milieu de la nuit, dans cette perspective, ne serait pas la marque d’un esprit agité, un « trouble » à traiter, mais la rémanence d’une pratique jadis généralisée à l’ensemble de la population. Ou de remarquer comment l’histoire, encore une fois, jette un éclairage nouveau sur le présent et sur nos pratiques contemporaines.
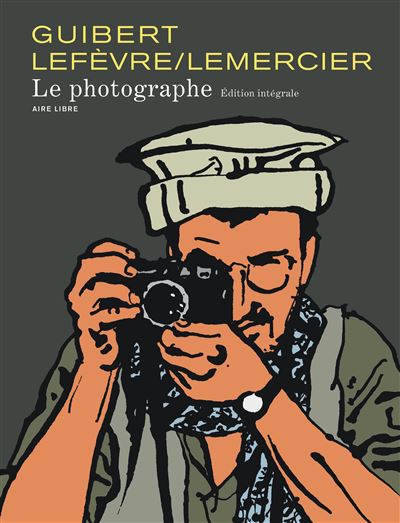
Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre et Frédéric Lemercier, Le photographe (édition intégrale), Éditions Dupuis, coll. « Aire libre », 2010
Par Élisabeth Schmit
Issue du témoignage narratif et photographique de Didier Lefèvre après son voyage entre le Pakistan et l’Afghanistan en 1986, Le Photographe est objet unique en son genre, mêlant dessin, photoreportage et récit en trois volumes, réunis en 2010 dans une belle édition intégrale. La perspective, si intime soit-elle, du narrateur lui-même s’entrelace à la visée documentaire sur l’Afghanistan alors occupé par l’URSS et sur le travail des équipes de Médecins sans frontières qu’accompagne alors le photographe. D’une page à l’autre, l’immersion dans cette étrange vie quotidienne peuplée de mille personnages est rompue par la beauté saisissante des paysages photographiés. A lire ou à relire cet été!
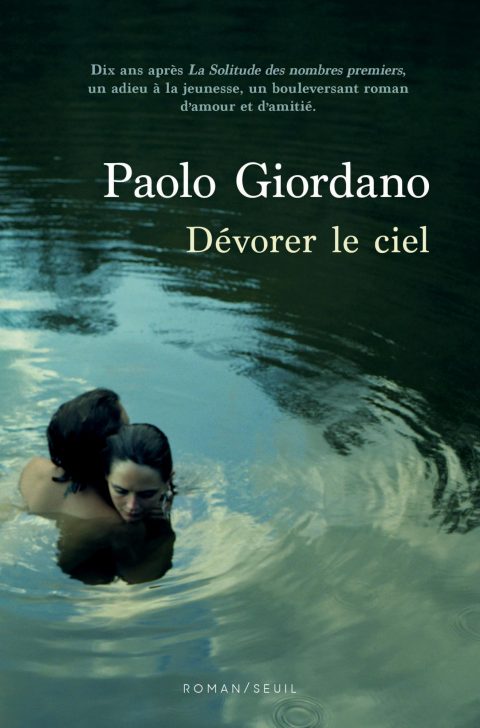
Paolo Giordano, Dévorer le ciel, (traduit par Nathalie Bauer), Éditions du Seuil, 2019.
Par Florie Varitille
Tous les étés, Teresa suit son père dans les Pouilles, dans la maison familiale de Speziale. Chaque année, elle retrouve trois garçons, Tommaso, Nicola et Bern, qui vivent « à la ferme ». À ces occasions, elle laisse derrière elle son quotidien de Turin pour se plonger dans la vie de ces garçons, habitant le village à l’année. Paolo Giordano propose ici une confrontation entre deux mondes, entre urbains de passage un été et ruraux, eux-mêmes en marge de la communauté villageoise, à la recherche de spiritualité, d’idéaux d’anarchisme et de retour à la terre. Cette rencontre, au crépuscule de l’enfance, marquera la vie d’adolescente et de jeune femme de Teresa. Dans cet ouvrage, l’auteur propose une belle lecture de la découverte de soi et des autres et d’une construction de l’individu, interrogeant sans cesse ses croyances et le sens donné à la vie.