Livres de plage : sélection de la rédaction
Vous partez en vacances ? Entre-Temps entame sa première pause estivale après quelques mois d’existence, avant de revenir début septembre. Mais avant de partir, nous avons demandé à des membres de la rédaction de vous proposer un conseil de lecture : un livre de poche ou un pavé, à vous de voir, de lire, de choisir, avant de vous rendre à la plage... ou ailleurs.
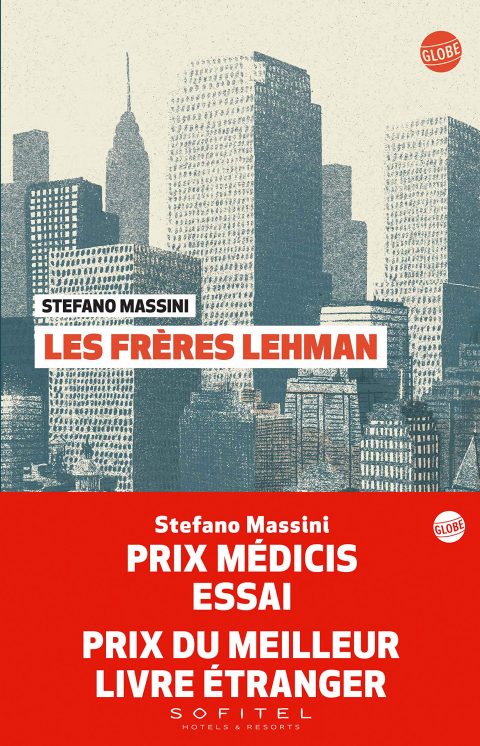
Stefano Massini, Les frères Lehman, 2018.
Par Patrick Boucheron
Un livre de plage doit être épais, lourd et stable, pour caler ce qui doit l’être. Si possible, il doit être haletant, et conter une saga familiale. J’ai ce qu’il vous faut : Les frères Lehman, qui vous cueille le 11 septembre 1844, à New York, où débarque Heyum Lehmann, fils d’un marchand de bestiaux en Bavière, et s’achève le 15 décembre 2008, par la faillite de la banque Lehman Brothers. Entretemps, ça file : du coton au sucre, du sucre au café, du café au charbon, du charbon au chemin de fer, du chemin de fer aux armes, des armes aux chiffres, des chiffres à la disparition : une histoire de l’Amérique, du capitalisme, de la modernité. 842 pages au compteur : vous en aurez pour votre argent. D’ailleurs il s’agit exactement de cela : dans la famille Lehman, les uns content, les autres comptent. L’illustre dramaturge italien Stefano Massini signe ici une œuvre majeure sur notre temps, une œuvre d’avant-garde d’une puissance narrative proprement irrésistible, qui emporte son lecteur dans l’implacable chorégraphie d’une danse féroce. Ce qui tournoie ici, c’est la frénésie de la langue et du nombre. Car l’histoire vient de très loin : par vagues, elle ramène sur nos rivages des refrains poétiques et des litanies prophétiques. Sous ce pavé, la plage, et sous la plage, les temps bibliques. Et pour les dire, les laisses traînantes et entêtantes d’une balade folk, d’un conte yiddish ou d’une épopée médiévale. Ah oui, j’oubliais : c’est un roman en vers.
—

Elsa Morante, La Storia, 1974.
Par Pauline Guillemet
« …19** », ces chiffres qui ouvrent et ferment La Storia d’Elsa Morante dessinent les contours de l’incursion au cœur du vingtième siècle à laquelle l’auteure italienne nous convie. Des premières années du siècle – celles d’avant 1941 – ne subsistent dans le roman qu’un raccourci chronologique, une dizaine de pages qui découpent en tranche les décennies précédant la Seconde Guerre mondiale. L’auteure y pose – par le rappel des faits – que « le siècle nouveau se règle sur ce principe immuable et bien connu de la dynamique historique : aux uns le pouvoir et aux autres la servitude ».
C’est ensuite sans jamais quitter Rome, durant les sept années qui s’écoulent du début de l’année 1941 à la fin de l’année 1947, que nous suivons le quotidien du personnage principal Iduzza et de ses deux fils, Ninnuzzu et Useppe. Des rangs de l’armée fasciste à son engagement aux côtés des Partisans, le premier fils, Ninnuzzu, fait pénétrer dans ce paysage romain quelques bribes du dehors, des combats et de la résistance. Le souvenir de la rafle du ghetto juif d’octobre 1943 et du convoi parti de la gare Tiburtina qui précèdent les descriptions des photos de la libération des camps dans ces journaux qu’Iduzza s’empresse de jeter à la poubelle, charrient d’autres images du dehors. Images de la tragédie si profondément imprimées dans le regard du petit Useppe – qui les as surprises dans les kiosques à journaux – qu’elles semblent responsables du déclenchement de ses premières crises épileptiques à partir de 1945.
Il reste que le cœur du roman est cette vie romaine qui continue durant les années de guerre et d’immédiat après-guerre : la vie collective dans la grande salle de l’abri pour réfugiés de Pietralata, au son du magnétophone ; le vol d’un sac de farine lors d’un contrôle par des soldats allemands ; la fermeture de l’école où Iduzza enseigne et dans laquelle elle ne peut plus se rendre suite aux bombardements et, surtout, sa peur panique : que l’on découvre son identité de « demi-juive » dont l’arbre généalogique devient, du jour au lendemain, par le renforcement des lois raciales, synonyme de déportation.
La Storia n’est peut-être pas, à proprement parler, un livre d’été. Son poids – historique tout autant que physique (c’est un livre de près de 1000 pages) – ne permet pas vraiment de prendre le large. Pourtant, c’est au cœur d’un voyage romain que l’on s’embarque, grâce notamment aux pérégrinations quotidiennes d’Useppe et de sa chienne Bella – qui est traitée, au même titre que le chien Blitz et la chatte Rosella avant elle, comme un véritable personnage. L’enfant et l’animal parcourent Rome en franchissant progressivement certains seuils – par la traversée du Tibre par exemple – et croisent, au passage, les éléments mêlés de leur histoire et de celle de la ville. C’est une histoire qui porte le nom d’Histoire, des jours et des heures qui passent et font écho aux passages des années du découpage chronologique qui introduit chacun des chapitres du livre, de 1941 à 1947.
Un voyage italien fut, pour moi, le prétexte de cette lecture et de la découverte de cette auteure à laquelle La Compagnie des auteurs sur France Culture avait consacré une série, en compagnie de Goliarda Sapienza. À écouter ici si vous avez encore peur de vous engager dans ce pavé.
—

Daphné du Maurier, La Maison sur le rivage, 1969.
Par Élisabeth Schmit
Ou le passé de loin en loin…
Un homme d’une quarantaine d’années perdu dans un second mariage se réfugie en Cornouailles chez un ami chimiste, qui a laissé à son intention une drogue étrange : chaque prise le projette, lui et les lieux qui l’entourent, au début du XIVe siècle. Le héros, qui voyage ainsi dans le temps mais non dans l’espace, assiste en témoin invisible au drame qui se noue entre les seigneurs de la région. La force du livre tient au caractère très sensoriel de ces voyages. Le héros éprouve dans son corps chacune des prises de la drogue, et bascule d’autant plus profondément dans le passé qu’il cherche à fuir sa propre contemporanéité. De ce passé, il n’a en même temps qu’une perception parcellaire : comme l’historien, il peine à reconstituer quelque histoire des bribes qui lui parviennent lors de chaque trip – tandis qu’entre chacun d’entre eux le temps, passé comme présent, continue de s’écouler.
—
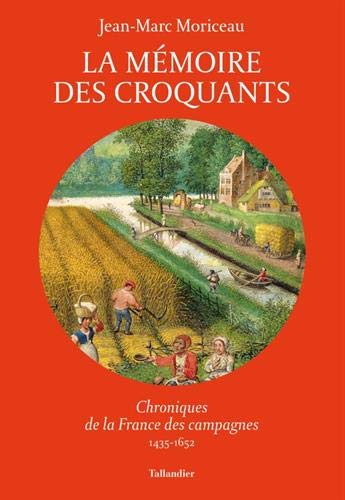
Jean-Marc Moriceau, La Mémoire des croquants. Chroniques de la France des campagnes, 1435-1652, 2018.
Par Gaëtan Bonnot
« Le nom des « gens de la terre » n’est point inscrit au fronton des célébrités nationales. Loin des figures de proue de l’histoire politique ou militaire, les personnages que nous recherchons forment la majorité des anonymes. Ils sont censés ne pas avoir « fait » l’histoire mais l’avoir subie. Or c’est aussi bien comme acteurs que comme sujets que nous entendons les observer. Ces « Croquants » – pour reprendre le sobriquet des paysans révoltés en Limousin et Périgord de 1593 à 1643 –, qui étaient-ils vraiment ? »
Que le parcours suive la trame événementielle qui structure l’ouvrage ou bien qu’il prenne, à l’aide des différents index proposés, des détours par localités, par thématiques ou encore au gré des protagonistes cités (célèbres ou anonymes, humains mais aussi animaux), c’est un voyage au cœur d’un univers trop souvent vu d’en-haut qui est proposé ici. Laissant la part belle à des témoignages contemporains mis en dialogue avec des travaux d’historiens, cette fresque au long cours est une invitation à une découverte itinérante du monde rural, au fil des pages, de temporalités et d’espaces qui s’enchevêtrent, depuis la fin de la guerre de Cent ans jusqu’à la Fronde. Et, pourquoi pas, donnerait-t-elle l’envie de (re)parcourir quelques-uns de ces lieux cet été ?
—
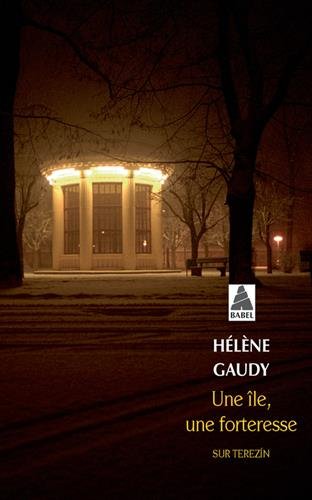
Hélène Gaudy, Une île, une forteresse, 2015.
Par Adrien Genoudet
L’été, il arrive que l’on traverse, au fil des jours et des étapes, des villes et des paysages aux histoires scalaires ; il arrive que tout ce qui nous interroge au cours de l’an viennent frapper aux portes visitées, aux ponts franchis, comme si les lieux soudain burinés de chaleur et de soleil se révélaient nus et nous parlaient d’eux-mêmes, de ce qu’ils sont, c’est-à-dire, bien souvent, un ramassis informe de temps et d’histoires. Et pour mieux comprendre ce que les lieux ont à nous dire, mieux vaut à la fois les parcourir du regard et apprendre à les lire, accumuler du savoir en écoutant, en interrogeant, en marchant – en écrivant. Alors que nous sommes quelques unes et quelques uns à attendre la sortie, à la rentrée littéraire 2019 de son prochain roman, Un monde sans rivage (Actes Sud), il faut revenir au dernier texte d’Hélène Gaudy pour saisir la justesse de son projet littéraire – entre journal, enquête, roman et autobiographie.
Alors, certes, on me dira que l’été, sur la plage, à ras de la mer, quand on peine à trouver la bonne position pour lire (vous aussi, n’est-ce pas, vous savez que lire sur une serviette étalée sur la plage c’est très inconfortable ? Qu’il n’est pas possible de rester trop longtemps sur le ventre sans se prendre un ballon entre les cuisses ou se broyer les coudes ; et qu’il n’est pas non plus tenable de tendre le livre, allongé sur le dos, pleins bras, en essayant de cacher vaille que vaille l’épais disque du soleil ; on le sait, un livre de poche ne fait pas l’affaire. Manque de pot, la dernière édition d’Une île, une forteresse est chez Babel, donc ça ne suffit pas. Peut-être pouvez-vous encore le trouver dans son édition originale, chez Inculte, mais ce n’est pas forcément mieux pour cacher le soleil), vous me direz, donc, que vous ne voulez pas en plus lire un livre qui parle de Terezín, alias Theresienstadt, ghetto devenu antichambre d’Auschwitz… Certes. Mais qui se souvient de la scène inoubliable d’Austerlitz de Sebald sait que l’histoire de Theresienstadt dépasse celle de l’horreur de l’extermination des Juifs d’Europe. Souvenez-vous du héros de Sebald en train de rechercher, image par image, dans le tristement célèbre film de propagande réalisé par Kurt Gerron, Le Führer offre une ville aux Juifs, le visage oublié de sa propre mère. S’intéresser à la ville de Terezín, passer les portes de la forteresse et avancer pas à pas au milieu d’un lieu aux airs de village Potemkine, c’est nécessairement s’y aventurer avec une quête nouée au cœur. Hélène Gaudy traque, marche, interroge et cherche à comprendre ce qui nous pousse, tous, parfois, à être happé par des lieux dits, des portes, des débris et des ruines. Pour nous guider elle nous ouvre la voie de ses doutes et de ses craintes, elle accumule les histoires qui poussent par bouquets de mauvaises herbes le long des murs, elle fait renaître des personnages oubliés, artistes et officiels, qui ont tous tournés en rond au milieu de la forteresse, et qui en sont bien souvent sortis pour ne jamais revenir.
Et, sur le fil de Sebald, là où l’on comprend que la littérature n’est peut-être qu’une expérience d’anthologie de récits en fuite, on s’approche de la narratrice, de l’auteure, de cette intimité qui jaillit des murs comme on projette les silhouettes des aïeuls sur des diapositives. Et le livre trouve ici sa pointe, le bord qui le laisse basculer vers un ailleurs ténu, où se mêle l’opéra de l’histoire et l’aparté de l’intime.
Allez le lire à l’ombre, avant d’aller retrouver le soleil, je vous promets qu’après ça, on entend encore mieux les vagues.
—
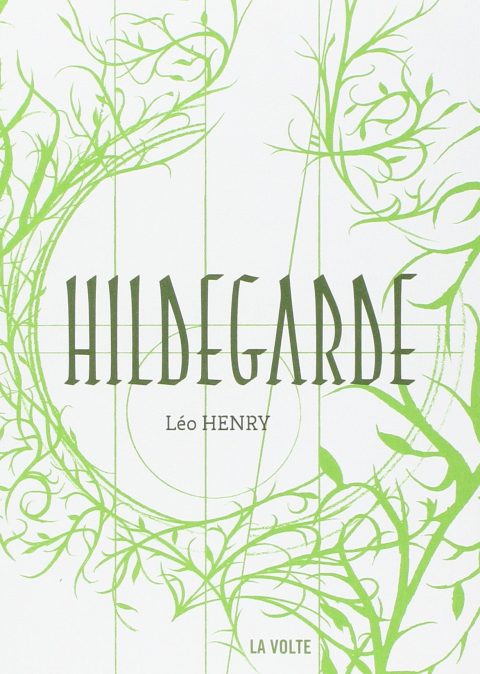
Léo Henry, Hildegarde, 2018.
Par Clément Weiss
Puisqu’il est question d’effondrement, que ce 29 juillet 2019 marque le « jour du dépassement » à partir duquel l’humanité a consommé toutes les ressources renouvelables de la planète pour l’année en cours et que les récentes canicules ont rappelé à quel point nos petits corps fragiles subissent le dérèglement climatique, pourquoi ne pas profiter de l’été pour transporter nos angoisses eschatologiques dix siècles en arrière, dans la Rhénanie du XIIe siècle, à travers un roman de presque cinq cents pages consacré à la religieuse et mystique Hildegarde de Bingen, rendue fameuse pour ses visions de la fin des temps, de l’avènement et de la chute de l’Antéchrist ? À la narration linéaire d’une page Wikipédia romancée, Léo Henry a préféré l’ellipse du contour, dessinant en creux la figure d’Hildegarde par de subtils détours : évocation de la vie des saints qui ont donné leur nom aux institutions religieuses qu’elle a fréquentées ou fondées, retour de l’os de son bras comme « bibelot et presse-papier » sur la table d’étude de l’érudit Jean Trithème qui redécouvre au XVe siècle la Lingua Ignota qu’elle a inventée, nœuds de récits des premières croisades noués autour de l’itinéraire du comte de Flandre qui prend la croix après avoir consulté la prophétesse, obsession de l’empereur Frédéric Barberousse pour sa rencontre avec l’abbesse et pour les corbeaux censés annoncer la fin des temps, ravissement de la narration au cours d’un chapitre habité par l’envers de la sainte, « Cundrie, la sorcière édentée ». Le chapitre central, trompeusement intitulé « Vita Hildegardis », se présente comme un montage de témoignages de tous les contemporains d’Hildegarde à son sujet et propose une variation sur une question déjà posée par Jacques Le Goff dans son Saint-Louis : dans les innombrables récits qu’elle a suscités, est-il possible de retrouver des gestes ou des attitudes qui prouvent que le corps mortel d’Hildegarde a bien existé ? À cette question, le dernier chapitre, « Apocalypse », qui prend enfin la voix d’Hildegarde, répond peut-être par un ultime détour : « Ces visions qui sont venues par moi me sont déjà lointaines, mystérieuses et riches, et belles parce qu’étrangères. Nul ne sait dire ce qui s’est produit, mais quelques traces témoignent que ce n’était pas un rêve, et ces signes perdurent, ils passent, ils traversent le temps. »