Intérieurs. Ép. 5 : Accessoires
Entrée, salon, cuisine, chambre à coucher... Comment aménage-t-on son chez-soi ? Et les photographies, les textes qui capturent ces espaces et leur mobilier, que révèlent-ils de celles et ceux qui y ont habité ? Dans ce nouvel épisode, Philippe Artières s'arrête devant trois objets typiques des intérieurs du second XXe siècle : la table roulante aux multiples fonctions, la moquette prise dans les rituels de son changement et de son entretien, le ficus et ses fragilités.
Les tables roulantes

On les a d’abord rencontrées dehors, sur les champs de bataille ; c’était les roulottes pour nourrir les soldats des armées en guerre. La Mère Courage de Brecht pousse une de ces carrioles, cette cantine permet de distribuer la soupe aux combattants mais aussi de faire théâtre.
Il y en a aussi dans les institutions d’enfermement, la roulante permet de livrer des repas de cellule en cellule sans avoir à porter les marmites. Le repas vient aux détenu·e·s. C’est un prisonnier qui se charge de pousser ce comptoir ambulant ; il y a tout à bord, et le charriot dispose parfois d’une source de chaleur qui garantit une tournée plus longue.
Chez les particuliers, elle avait peu d’intérêt tant qu’il y avait les gants blancs pour servir. Mais sans doute n’est-ce pas un hasard si son heure de gloire a été les années 1950-1970, car cette desserte montée sur des roulettes a pu remplacer les domestiques qui commençaient à réclamer des droits et des congés. Grâce à elle, sans quitter ou presque la table, on dispose de tout le repas ; inutile d’aller à la cuisine pour prendre les assiettes à dessert, nul besoin non plus de se lever pour offrir « un fruit ». Le meuble a-t-il participé à la disparition de la domesticité ? Ou bien a-t-il été une des inventions pour y palier ? Toujours est-il qu’il est venu s’installer durablement dans les intérieurs bourgeois.
Son plus grand succès est sa déclinaison pour l’apéritif, en version bar, avec son porte-bouteilles intégré qui permet d’éviter les catastrophes ; le maître de maison peut sans effort servir et resservir à ses invités un verre de whisky ou de gin.
La table servante est décidément des plus pratiques :
Plats, couverts, bouteilles tiennent facilement sur les deux larges plateaux […] Un ramasse-couverts est prévu sous le plateau supérieur. Comme c’est agréable de les rouler silencieusement de la cuisine au coin salle à manger.
Chez Georges Dambrine, le fabricant du 86 avenue du Général-Michel-Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris, il vous en coûtait en juin 1968 entre 240 et 450 francs pour en acquérir une, tandis que chez Joly à Champigny-sur-Marne, le Bar-desserte roulant 60 x 60 cm est à 210 ou 235 francs. Son prix dépend des matériaux (Formica, acajou ou façon merisier) mais aussi de la taille des roues.
Les roues dans ce monde sans domestique prennent soudain une valeur essentielle. Il ne s’agit pas de porter, le dos devient soudain une zone sensible. On ne met pas sur roulette seulement le bar, la vaisselle et le repas… on place l’objet de tous les désirs sur une table-roulante : la télévision a très tôt son meuble que l’on rapproche de la table de salle à manger pour regarder le journal télévisé du soir.
On y regardera sans modération les films de Chabrol dans lesquels la table-roulante est le témoin privilégié du petit théâtre de la bourgeoisie. Avant que la cuisine « américaine » vienne occuper une partie de la pièce de réception, ce petit meuble permet des déplacements fort utiles pour des discussions en aparté. Car c’est encore grâce à lui qu’on servira le café puis le digestif. Un accessoire décidément central en ces années 1960-1980.
Pourtant, il ne survit pas à l’arrivée de la gauche au pouvoir ; il prend le chemin de la terrasse pour les beaux jours et il sera désormais en plastique comme la table et les chaises de jardin ; le meuble intérieur, quant à lui, est très pompidolien et giscardien – un intérieur est-il pour autant de gauche ou de droite… la question demeure ouverte. Reste que la table-roulante n’est pas très socialiste, on lui préfère la table basse, celle autour de laquelle on prendra un apéro dinatoire avec « les enfants ». Car, faut-il le préciser les enfants ne doivent pas jouer avec la table-roulante, ils vont casser une porte vitrée, l’abîmer ou pire briser le service en porcelaine hérité des grands-parents et reçu en cadeau de mariage. La table-roulante est en revanche mixte : Monsieur l’utilise pour l’apéritif et Madame à table. Il n’y a aucune confusion des rôles possible. Bien que roulante, elle assigne chacun à une place, sa place.

La moquette
Le plus souvent d’une couleur unie plus ou moins éclatante, la moquette s’introduisit dans nos intérieurs au moment où les pattes de nos pantalons s’élargirent et nos jupes se raccourcirent. La moquette c’est le collant Dim de nos appartements. Le plus souvent synthétique, elle a modifié durablement la relation de notre corps à nos intérieurs. Voyez le parquet, sur lui on marche bottés ou en chausson, parfois même en patin ; il craque sous le poids des corps : pour rentrer (trop) tard la nuit, on tient ses chaussures à la main de peur de réveiller l’autre. Sur la moquette, on gambade pied nu, on s’y allonge même, plus ou moins vêtu·e. On la caresse de la main – une pratique d’onanisme discrète. On y pose la tête. Car la moquette est sensuelle à l’image des fauteuils de Pierre Paulin, on l’aime épaisse et accueillante — si elle brûle la peau par frottement c’est qu’elle est de mauvaise qualité, qu’on l’aura mal choisi. Il faudra en changer.
Il y a en effet toujours cent raisons de la remplacer. Comme d’un vêtement, on s’en lasse très vite. Dans le magasin, sur le gros rouleau, sa couleur semble parfaite au bout de la troisième visite : on l’adore et on se le dit. Elle est à la fois lumineuse, soyeuse et peu salissante. Le vendeur a insisté pour que l’on achète de la terre de Sommière en cas d’accident – un verre de vin renversé, un bâtonnet de glace tombé, un biscuit d’apéritif écrasé ; éviter surtout les mousses bon marché et autres produits soi-disant miracles ; de même les bombes aérosols qui laisseront une auréole fatale. Avoir une belle moquette, c’est exigeant et ça se mérite.
Il faut d’abord la poser ; on a souvent préféré mettre quelques francs de plus « au mètre carré » pour prendre « le haut de gamme », plutôt que de se soucier de financer la pose. Alors une fois choisie, pour éviter que ça tourne mal comme la dernière fois, celle où on en est arrivé à la menace de divorce, on mobilise un extérieur, le beau-frère bricoleur ; un samedi, avec les gosses qui tournent tout autour alors que l’opération exige une grande concentration, on s’y met, le rouleau ne peut pas éternellement rester dans le corridor. Il ne faut pas « se râter » : éviter les plis, prévoir les recoins ou encore fixer la barre métallique au seuil de la pièce. Car tout l’espace de l’appartement n’est pas couvert de la même moquette. Dans la chambre des enfants, elle sera plus ludique ; elle les fera y rester si elle est bien confortable. Dans le couloir, elle doit être plus résistante, sinon très vite on verra des marques d’usure ; on mettra un tapis pour les masquer, un de ceux qui est à la cave que l’on a hérité des grands parents et dont on ne savait que faire et qu’on a eu longtemps en diapositive. Dans le salon, la pièce de réception, elle est chic. Et si elle souffre d’un accroc, le tapis servira de cache misère. Dans cette pièce – c’est dire combien on tient à sa moquette – il devient un accessoire préventif. Il permet d’accueillir la tache ou la brûlure. Les cendres d’une cigarette peuvent faire un terrible ravage et il faut prendre sur soi quand le collègue du bureau sans même s’en rendre compte en laisse tomber une de sa Gitane. Alors que sur le parquet il habillait, sur la moquette il est semblable aux coudes en cuir que l’on coût sur le pull-over neuf ; il surcharge. L’été, il rend l’appartement étouffant. Il sauve la moquette mais il complique tout : si on trouvait jusqu’alors le passage de l’aspirateur presque plaisant – quelle joie de voir les miettes de pain avalées en un quart de seconde ! Quel bonheur que d’admirer la virginité retrouvée de la moquette ! –, le tapis rend l’activité de ménage plus pénible.
Quoi qu’il arrive, il vient bien un printemps où ce n’est plus possible, où vraiment il faut changer la moquette ; elle est sale, elle fait vieillot, elle ne va plus avec le nouveau papier peint ; certains matins, en se levant on rêve même de déménager pour s’y soustraire. Car la moquette on ne voit que ça.
Quand on retourne à la périphérie de la ville, chez Mondial Moquette ou aux Tapis Saint-Maclou, on est persuadé cette fois de faire dans le classique, le sobre, ni trop clair – « le crème est très réussi chez tes parents mais avec les enfants ce n’est pas possible » –, ni trop coloré – « si nous avions des meubles “design” pourquoi pas mais avec la table basse, le pouf et le tissu mexicain, ça ne va pas ». On évite aussi le trop sombre – il rétrécit les espaces et on se croirait dans une boite de nuit – et on opte pour le moucheté. La moquette avec des taches a l’immense avantage d’être passe-partout. C’est peut-être pour cette raison qu’on a fini par se demander ce qu’il y avait dessous. Les articles sur les dangers des acariens ont fait le reste. On a redécouvert le parquet bourgeois. On a même voulu en recouvrir tout le sol de « l’appart ». Le vendeur a eu beau suggérer du jonc pour le couloir et du lino, très tendance, pour les toilettes, on a acheté des paquets de lames en 80 cm et on s’est mis à quatre pattes après avoir fait d’interminables calculs. Il faut réaliser combien le souci de l’intérieur a fabriqué, à leur insu et contre leur gré, des quantités de bricoleurs et de bricoleuses. À ton intérieur tu t’aliéneras, avant qu’avec les tutos sur internet tu t’en libèreras !
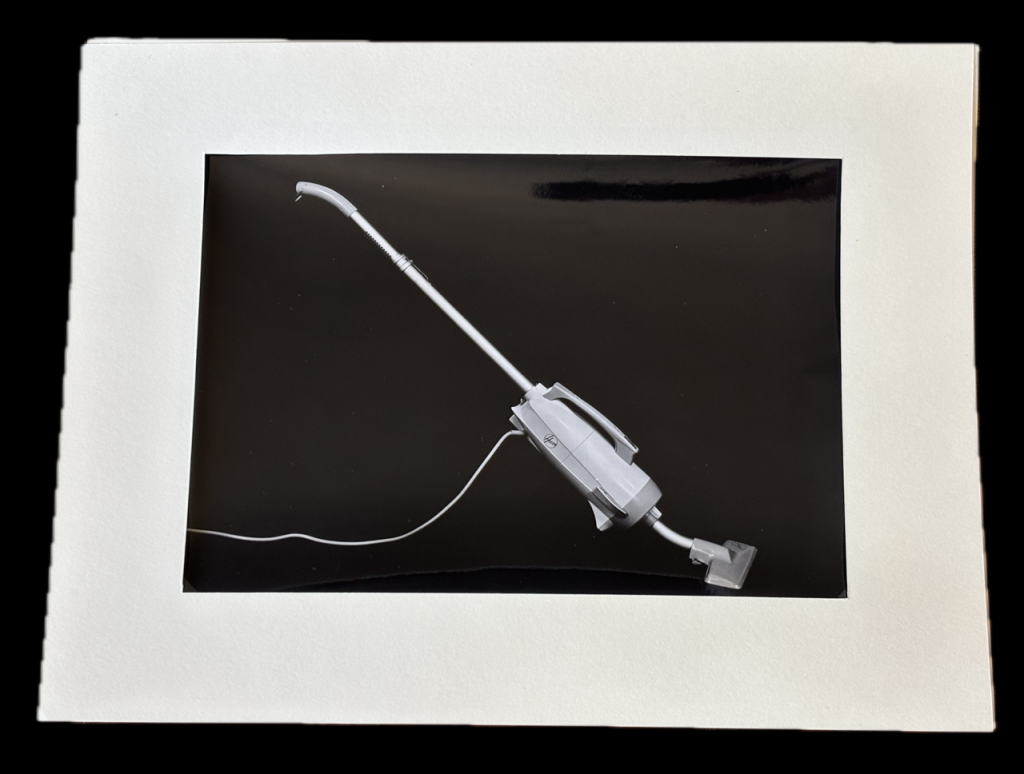
Le ficus
Au milieu des années 1980, pour une raison mystérieuse, on a vu apparaître dans les appartements parisiens un arbuste jusque-là inconnu du plus grand nombre. Dans son pot Riviera ou de terre cuite, il en poussa partout derrière les fenêtres des boulevards. « Avoir un ficus » était synonyme d’un souci manifeste pour son intérieur et prendre soin de son intérieur était une marque de distinction. La prolifération de ces plantes vertes exotiques fut contemporaine de l’ouverture de magasins de mobiliers et accessoires également exotiques – on ne voyageait pas alors aussi facilement qu’aujourd’hui, l’Asie et son bambou faisait envie, de même que les senteurs d’encens. Une visite chez Pier Import offrait la possibilité d’accéder à un ailleurs qui était pour la grande majorité encore très lointain. Ces magasins se voulaient ainsi de véritables « cavernes d’Ali Baba », avec chaque semaine de nouveaux arrivages d’objets, de tissus, de meubles souvent improbables et dont l’inutilité était évidente.
Si l’acquisition d’un hamac ou d’un volumineux fauteuil en rotin ne demandait pas d’entretien, le ficus était une plante fragile qui exigeait toutes les attentions. Il fallait laisser la terre sécher entre deux arrosages et en hiver ne pas oublier de vaporiser les feuilles plusieurs fois par semaine. Les jardinistes qui en faisaient commerce recommandaient aussi de les dépoussiérer régulièrement. On voyait ainsi, le week-end, des Parisien·ne·s se mettre à passer délicatement un chiffon sur des plantes et parfois impatient·e·s tenter avec l’aspirateur un dépoussiérage plus rapide – cette tentative avait souvent des conséquences désastreuses dans les couples qui ne manquaient pas cette occasion pour se disputer.
Votre ficus pouvait surtout devenir une source d’inquiétude lorsqu’il perdait à l’automne ses feuilles ; on en parlait aux ami·e·s, on demandait conseil ici-et-là ; on s’empressait de le déplacer sur le précieux balcon, ce qui avait le plus souvent un effet désastreux ; il prenait un coup de froid et l’arbuste au feuillage caduc ne s’en remettait que rarement. Il n’était ainsi pas rare au début de l’hiver de voir sur les trottoirs des cadavres de ficus encore le pied pris dans sa motte de terre sèche. La plante verte desséchée et le sapin de Noël jauni constituaient les deux victimes annuelles végétales de notre goût pour la déco intérieure.
Je ne sais si son succès venait du fait que dans la religion bouddhiste il était l’arbre de la sagesse, celui sous lequel le jeune Siddhârta médita jusqu’à connaître la Vérité. Reste que dans nos logements petits ou grands, il témoignait, lorsqu’il était bien vert, d’un certain bien-être, d’une forme d’équilibre. Si le bonzaï japonais était signe de préciosité ou de maniaquerie, si la collection de cactus pouvait apparaître comme relevant d’une forme de perversion – à quoi bon avoir des plantes qui piquent –, le ficus n’était pas pour autant anodin. Les jeunes enfants devaient éviter d’en manger les feuilles faute de quoi ils risquaient une sévère intoxication. Il était un reste des années 1970 au milieu des années 1980.
C’est dans le salon qu’on le plaçait de préférence – les plantes dégageant, dit-on, du gaz carbonique, elles étaient proscrites dans la chambre à coucher. Dans le « séjour », pas trop près des fenêtres, le bac prenait place. Le ficus ne supportait pas la compagnie d’autres plantes vertes, les modalités de son arrosage, on l’a dit, étant très particulières. Il se portait en revanche parfaitement avec les lithographies acidulées de l’artiste Tofoli, ces paysages andins ou ses femmes indiennes ; il allait aussi très bien avec un fauteuil style Louis XV ou un confortable canapé moderne. Le ficus permettait aussi d’associer une veille commode et une bibliothèque Knoll. La plante constituait une sorte de transition, évitant le contraste trop brutal. Et puis, elle était vivante. Elle n’avait pas le caractère disgracieux de l’aquarium ; elle était un chat sans litière et sans griffure sur le bas des fauteuils. Le ficus introduisait ainsi un peu de vie dans nos intérieurs qui en dehors des journaux et des magazines avaient une certaine tendance à l’immobilisme. Le soir venu, il était courant qu’un éclairage bien placé ait pour effet un jeu d’ombre à la fois inquiétant et reposant. Le ficus était certes un accessoire mais il était en réalité essentiel dans sa capacité à produire une atmosphère. Aucun meuble n’avait une telle vertu. Meublé d’un arbuste le salon et les soirées y seraient plus clémentes, les dimanches moins gris.
Lorsque, par malheur, il venait « à crever », on courait chez Truffaut ou sur les quais pour le remplacer. On imagine qu’il y avait en banlieue ou un peu plus loin au sud de grandes serres où l’on faisait pousser des milliers de ficus, suffisamment grands pour faire présence. Cet arbuste a, en partie, disparu comme il était arrivé… il a peu à peu déserté nos intérieurs ; il demandait trop d’attention et prenait sans doute, comme les livres, trop la poussière. À la différence d’autres accessoires qui ne sont plus au goût du jour, on ne le retrouve pas sur les brocantes ou seulement sur les photos familiales – certain·e·s en faisant même un arbre de Noël moins encombrant que l’autre qui perdait ses aiguilles. Les rayons « plantes vertes » se sont faits plus rares dans les jardineries. La nature est désormais sur le fond d’écran de nos ordinateurs.
