Vitalités de l’archive – 5 : les diapositives
Pour la Nuit des idées, le comité éditorial d’Entre-Temps et leur invité Philippe Artières ont décidé de mettre en scène, le temps d’une représentation, leur façon de travailler, d’étudier ou encore d’explorer les archives tout en leur redonnant un soupçon de vie. Lors de cette soirée – qui s’est déroulée jeudi 30 janvier au Collège de France – cinq textes inédits ont été rédigés et performés. Entre-Temps publie, pendant cinq semaines, ces textes qui incarnent une part de ce que notre revue cherche à défendre. Chacun d'entre-eux se découpe en trois temps : la découverte, la description et la réactualisation de l'archive.

Les diapositives
La ronde
1.
Il faut d’abord traverser les marais du Cotentin où les jeunes parachutistes alliés sont morts noyés le D-Day, le 6 juin 1944.
Il faut ensuite longer le cimetière militaire allemand dont, à la fin des années 1950, on autorisa la construction.
Il faut enfin entrer dans le bourg, celui qui fut reconstruit après et n’a pas connu les désastres de la guerre.
Précédés de tous ces fantômes, on arrivera au Bon-Sauveur de Picauville. Devant nous, il y aura l’asile. Ses hauts murs et son grand portail barreront le paysage. On hésitera à rentrer, mais très vite, sans même s’en rendre compte, on sera au-dedans.
Un ensemble de pavillons fait penser à un village VVF ; ils ont été construits au début des années 1970, symboles de la sectorisation voulue par quelques psychiatres, dès 1945, et qui mit tant de temps à se réaliser.
Il faudra tourner à gauche vers les grands édifices et leurs cours intérieures ; monter les escaliers, entrer dans les dortoirs désertés, ouvrir un placard, fouiller dans des cartons restés comme des dépouilles et trouver cette boite de diapositives kodak. On ne verra pas tout de suite ce qu’elles représentent.

Au départ, il y a un grand blanc ; une immense radiation que la technique photographique ne permet pas de saisir. Un excès de lumière ; un trop de feu. Au départ, il y a l’explosion des bombes et la destruction des bâtiments, sept ans après la commémoration du centenaire de la Fondation de 1837. L’hôpital est bombardé et les patients et personnels fuient sous le feu.
Une religieuse note dans son journal :
« Des malades arrivent se bousculant et criant : « Le feu est au Bon-Sauveur… » ; de par ailleurs l’on crie : « L’immaculée est atteinte », et nous sommes à côté. Un craquement formidable sur nos têtes, ce n’est qu’un cri : « Le clocher est atteint… » (Sœur T. qui se trouvait à la chapelle se demande comment elle a pu gagner la sacristie, elle ne voyait que poussière et fumée.) Sous le cloître, tout le monde est à genoux, les bras en croix. La mort plane sur nos têtes, c’est évident. Chacune renouvelle le sacrifice de sa vie. Le Dr H. demande une personne de bonne volonté pour aller avec lui représenter aux autorités que c’est vraiment inhumain de s’attaquer à un hôpital et surtout à un hôpital d’aliénés. Il est trop tard d’entreprendre des pourparlers. La chapelle est touchée, il faut absolument fuir notre abri. Monsieur l’Abbé B. propose de gagner le presbytère, la cave nous défendra peut-être… Les malades du Sacré-Cœur arrivent affolés… Monsieur l’Abbé, revenu d’un petit examen au-dehors, se concerte avec Notre Mère et le docteur. Un ordre est donné : « Partons au plus vite à travers la campagne. » Les sœurs qui ont leur valise proche s’en emparent vite et chacune essaie d’entraîner à sa suite un groupe de malades. Ce n’est pas chose facile : les uns au lieu de suivre le mouvement veulent prendre une porte déjà aux trois quarts arrachée ; d’autres refusent de partir, il faut les traîner de force et le danger devient de plus en plus pressant. Enfin nous voilà au-dehors, entre deux feux, car les Américains sont aux environs et même hier ils se battaient à Étienville dans un village tout proche, il y avait combat au corps à corps. L’intention de nos mères est de rester à proximité de la communauté. La maison du frère de sœur Louise V., sise à un kilomètre, ferait bien un abri, celle de sa sœur cinq cents mètres plus loin, en ferait un autre, il nous serait ainsi facile de revenir voir ce qui se passe chez nous. Monsieur l’Aumônier porte le Saint-Sacrement. Quel contraste avec nos belles processions de la Fête-Dieu… C’est le cœur navré que nous suivons. À bien des reprises, il faut gagner le fossé, se blottir contre les haies : mitrailles et fusillades sans arrêt. Les premiers groupes ont atteint la maison de A. V. » Journal de sœur V. [juin 1944]
De cette nuit de feu, il n’y a pas d’images, juste ce récit.
Alors depuis la catastrophe, on a fait des images ; beaucoup d’images : des photographies qui resteront et non des écritures qui disparaissent.
Il y en a des centaines abandonnées dans les bâtiments désaffectés de cet hôpital psychiatrique du Département de la manche, nul ne sait vraiment combien, car la collection ne fait que commencer ; le corpus n’est jamais à l’abri de la découverte d’un nouveau gisement ; un placard dont on retrouve soudain la clé, une fuite d’eau ou la mort d’un des protagonistes sont autant d’occasions de remontées d’images. Dans un contexte de fragilité de l’écrit, la photo rassure, elle donne la preuve que cela a existé et ainsi fait être ce qui a disparu. De ce point de vue, elle a un pouvoir rétroactif. Elle redonne existence à ce que les bombes et le feu avaient détruit et rendu invisible.
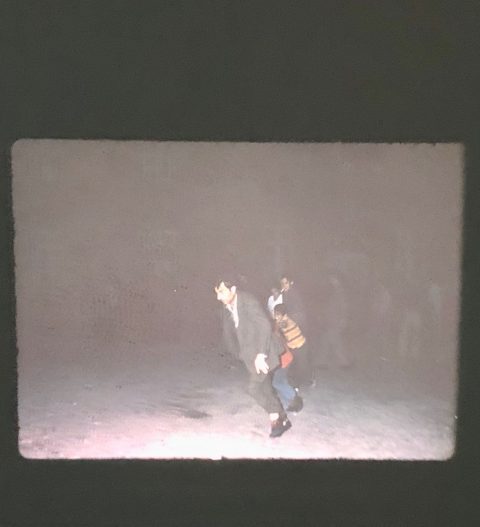
2.
Ces diapos font soirées, des diapos qui sont projetées en grand quelques semaines après les vacances. Occasion de se souvenir de moments singuliers : les sorties, les fêtes, les séjours au-dehors… Les images d’un monde avec ses acteurs. Il y a Louis, Émile, Blanche et puis ce malade chez qui l’on envoyait toujours les infirmiers « bleus », histoire de les déniaiser. Il y a Lourdes, Saint-Michel… Autant de noms des divers secteurs de l’hôpital. Ces photos n’ont pas de date ; on ne sait pas qui en est l’auteur ; une bonne sœur ? Un infirmier ? Qu’importe.
Car ils avancent, ils sortent de la nuit et pourtant leur ronde semble infinie, sans âge, presque archaïque. Impression d’un infini piétinement. Ils tournent en rond. Le sens de cette parade est peut-être ailleurs ; il fait aussi écho au charivari, à ces pratiques médiévales d’inversement et de suspension de l’ordre social. Le fou, le déclassé deviennent, pendant ce temps de la procession, les puissants. Moment singulier que celui de la fête où l’institution se montre en creux dans l’exceptionnel. Patients, soignants et religieuses tombent le masque, ils font les fous… Un moment de désordre pour affirmer ensuite l’ordre et la place de chacun. La photographie prolonge le geste en l’inscrivant dans le temps. On regardera les photographies, on se souviendra de ce drôle de jour où tout était désordre.
On se demandera aussi si ces photographies ne racontent pas une autre histoire, celle de l’évasion.
L’un de ceux qui figurent sur les diapos n’a t-il pas écrit :
« Je sens qu’il me faudrait un grand calme. Si vous saviez comme j’ai besoin de calme. Mon père a une petite propriété si vous vouliez que je continue chez lui je travaillerais tout en me surveillant. Je ne voudrais pas avoir l’air de mettre de la mauvaise volonté, je ne suis pas fou du moins autant que chaque être peut en juger lui-même, je crois que je suis normal à peu de chose près, quand mon père viendra nous discuterons si vous voulez car je sens une fatigue sur moi si vous n’y voyez pas d’inconvénient au crayon ou à l’encre est-ce que je vous embête approximativement quand pourrais-je repartir avec les miens, je ne veux pas vous retarder. Mais je ne suis pas malade. Je ne veux pas vous désobliger mais maintenant je n’ai qu’une hâte, c’est que ma famille vienne me chercher. Je suivrai les ordres de mon père et de ma femme pour autant qu’ils s’accordent avec ma conscience car moi même je suis trop abruti pour prendre la décision dans la limite voulue. Je ne sais pas si j’aurai le courage moral de me rétablir chez moi je consulterai les miens. »
Je sens qu’il me faudrait un grand calme. Si vous saviez comme j’ai besoin de calme.
« Le jeudi 20 décembre, à la faveur de l’obscurité et au moment de la rentrée des travailleurs, ayant trouvé la porte ouverte (vers 6h1/2) le soir, il s’est évadé. Après l’avoir cherché, on nous dit qu’il s’est dirigé du côté des ruines de l’église. Le lendemain vendredi 21, vers huit heures du soir, des prisonniers allemands travaillant dans la maison, nous font prévenir qu’ils l’ont retrouvé ; est rentré au quartier après avoir dîné avec ses camarades (qui sont venus le conduire).
Prétend s’être évadé pour éviter l’électrochoc, et pour aller à Cherbourg au dentiste et chercher des peintures pour faire des tableaux pour restaurer la chapelle.
Proteste toujours pour tout et contre son internement et veut travailler pour réparer les ruines, et surtout faire de beaux tableaux. Dit qu’on l’a fait entrer ici pour le faire mourir de faim, et espère que le Bon Dieu punira les français qui n’aiment pas le Bon Dieu. »
3.
Non ce sont les archives d’un moment heureux.

C’est comme quand on est en famille, qu’on est content, qu’on n’y pense pas, et que l’un prend conscience de ce bonheur, alors il sort l’appareil photo juste avant la fin de l’événement, in extremis. Il faut sauver un souvenir, garder trace de ce moment heureux. On pourra l’envoyer à ceux qui n’étaient pas là. Les albums de Picauville sont pleins de ces portraits saisis avant que l’on ne se mette à desservir, à empiler les assiettes, à ramasser les miettes et passer l’éponge… à éteindre le feu de joie. Bref, avant que l’ordinaire ne reprenne le dessus. Ils sont nombreux ces clichés de groupe où les patients sont en mouvement ; certains regardent le photographe, mais la plupart sont tout à leur bon plaisir. Car quelle autre scène saisir, en dehors de cette folle ronde pour montrer la joie d’être ensemble ? Éternelle obsession de renvoyer une autre image que celle de la souffrance. Opposer à la scène solitaire de la prise des comprimés avec le verre d’eau celle du partage de la fête. La veillée dehors mieux que la chambre, la cour mieux que la tablette, le groupe mieux que la solitude… Mais ces photographies ont une autre fonction : elles construisent un récit commun. Si ces événements reviennent d’année en année, à raison d’un ou deux par saison, définissant ainsi un calendrier, ils dessinent également une chronologie Ça, c’est au printemps 1979, on reconnaît X et Y ; on venait de refaire le pavillon, etc. Ça, c’est le jour où l’on est allé jusqu’à la mer avec P. » Ces photos de fête inscrivent la vie du dedans dans celle du dehors. Elles imposent une autre chronique que celle des traumatismes individuels, des crises d’untel ou de la fugue de tel autre. Elles les font accéder à l’autre temps, celui de l’histoire collective. Elles font entrer ces sujets dans notre histoire.
Ces archives elles sont présentes dans tous les greniers des écoles maternelles, dans les albums de chacun, celles d’une fête de fin d’année, d’un anniversaire, d’une crémaillère, d’un mariage, d’un nouvel an…

Ce ne sont pas les archives de la guerre, du bombardement, Ce ne sont pas les archives de l’histoire d’une institution psychiatrique, mais les photographies de la fête de la Saint jean que l’on fête dans tous les villages, c’est la fête de la musique dix ans avant sa création, ce sont les archives de la fête, du moment où parce qu’on est ensemble, parce que c’est la nuit, on entre dans l’entre-temps.
