"Au-dessus et dedans à la fois" : entretien avec Christophe Naudin
Christophe Naudin, historien et enseignant, était au Bataclan le 13 novembre 2015. Il publie aujourd'hui son journal, tenu pendant trois ans après les faits et revient, pour Entre-Temps, sur ce journal-archive et sur cette étrange position de témoin-historien, "au-dessus et dedans à la fois".
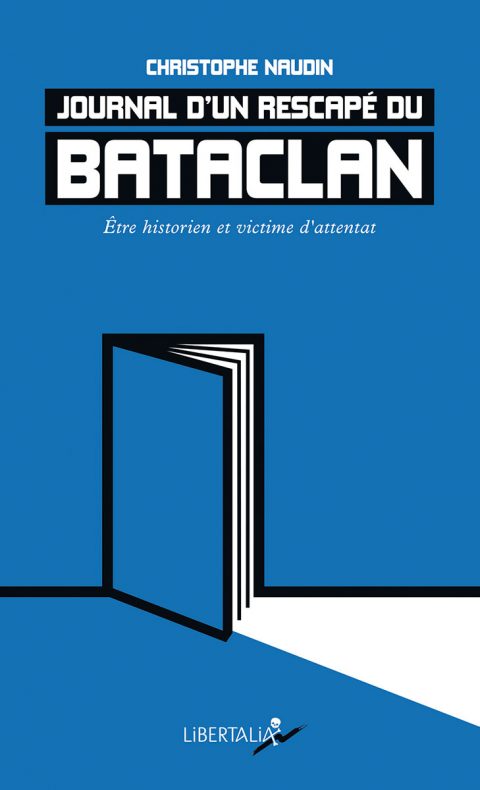
Elisabeth Schmit : Le livre s’inscrit en fait dans une triple temporalité : celle des attentats et du moment de l’écriture, celle de la publication aujourd’hui, de la force du témoignage dans notre société contemporaine, et puis celle du temps long de l’histoire de l’événement, telle qu’elle sera étudiée et écrite plus tard. On pourrait commencer par revenir sur le moment de l’écriture et sur la conscience que vous avez déjà, alors, de cette triple temporalité.
Vous parlez à plusieurs reprises dans le livre de votre position d’historien et le recul critique qu’elle implique sur les événements. Est-ce que cette position joue un rôle au moment où vous écrivez le journal ? Est-ce que vous avez, d’une manière ou d’une autre, l’impression de constituer une archive ?
Christophe Naudin : Bonne question ! j’y ai réfléchi après… j’ai l’impression que ça dépend des moments. Il y a des moments – notamment les premières semaines voire les premiers mois, et encore, par à-coups – où j’écrivais comme ça sans réfléchir, sans aucun recul. Même si dès la première date du journal, je suis déjà dans l’analyse, par une sorte de réflexe inconscient. On m’a toujours dit que j’intellectualisais trop : en fait j’écris pour me vider dans ces moments-là, mais sans que ce soit au début conscient – peut être que ma formation d’historien a d’ailleurs joué un rôle là-dedans – j’essaye déjà de prendre du recul, sans toujours y parvenir. Sans souvent y parvenir en fait. C’est assez compliqué à expliquer : comme si j’essayais de me mettre un peu au-dessus, tout en étant dedans. C’est pour ça aussi que c’est très confus au début.
Et après, plus ça avance, plus je vais relire ce que j’ai écrit avant, et plus je vais avoir ce réflexe de vouloir prendre un peu de recul. Il y a un mélange entre essayer d’écrire « comme ça », et prendre un peu de recul – mais je n’y arrive pas toujours, parfois je suis sous le coup de la colère… mais plus je vais écrire, plus je vais essayer d’avoir ce recul, notamment en me relisant. Ce qui m’a servi, c’est à la fois d’écrire et ensuite de me relire les semaines et les mois suivants.
ES : Vous avez régulièrement relu en continuant à écrire ?
CN : Voilà. Je me suis relu, mais sans réécrire évidemment. Régulièrement je relisais, pas tous les jours, parfois au bout de trois semaines, un ou deux mois, je relisais, soit en entier, soit par morceaux, je remontais dans le temps – ça explique parfois les références que je fais à des passages précédents du journal. Ça m’a permis, je pense, de me reconstruire différemment aussi, enfin je ne sais pas. En tout cas j’ai pris ce recul petit à petit grâce à ces relectures.
ES : Est-ce qu’au moment où vous écrivez, vous associez cette démarche avec celle initiée par le programme « 13 novembre[1] » de Denis Peschanski, que vous évoquez par ailleurs dans votre journal, et auquel vous participez ? Comment est-ce que vous articulez votre journal à ça ?
CN : Alors justement ce n’était pas du tout articulé. J’en parle effectivement dans le journal mais je n’associe pas du tout les deux sur le moment, et c’est peut-être curieux d’ailleurs. Je vois petit à petit mon journal comme un témoignage, mais qui pendant tout ce temps était censé ne servir qu’à moi. Le fait de témoigner chez Peschanski me permettait de dire un peu ce que je disais dans mon journal mais à l’extérieur. Ce n’est pas exactement le même angle. Peschanski nous interroge sur l’événement lui-même, sur la manière dont on l’a vécu, sur le moment de l’événement dont je parle beaucoup moins dans mon livre puisque je parle beaucoup plus des aspects politiques, des aspects dont je ne parle pas dans le programme. Donc c’est comme si c’était deux choses différentes en fait, deux témoignages différents. Avec Peschanski, c’était conscient pour moi de servir de source en fait, et c’est pour ça que je l’ai fait – alors que mon journal, c’est a posteriori que je me suis dit ça pourrait être une source, une fois qu’il était terminé et qu’on en a discuté avec les éditions Libertalia. Ils m’ont dit que ce serait plus intéressant de publier le journal.
ES : Vous aviez un autre projet d’écriture au départ ?
CN : Oui au départ j’ai un autre projet, qui est celui d’écrire un livre un peu sur le même sujet, sur la manière dont l’histoire avait servi à ma reconstruction, mais en repartant de souvenir plus anciens, parce que j’ai des souvenirs des attentats de 1995 par exemple. Je n’ai jamais été très loin des attentats – sans être superstitieux, mais plusieurs fois je n’étais pas très loin… et ça m’a toujours intéressé. Et je pensais à mon parcours, aux attentats, à ma reprise d’études, aux sujets auxquels je me suis intéressé, en me disant que ça pouvait être intéressant de le raconter, en me servant de mon journal mais ponctuellement. J’ai proposé quelque chose à Libertalia, et ils m’ont dit « c’est intéressant, mais tout ne fonctionne pas, et tu parles beaucoup de ton journal, est ce que tu ne voudrais pas plutôt le publier ? ». Alors évidemment il fallait le contextualiser, et puis il ne pouvait évidemment pas être publié tel quel, il y avait trop de choses dedans. Mais au bout du compte je n’ai pas coupé tant que ça, il s’agissait surtout de ne pas être trop redondant, de garder le même esprit, et surtout ne pas réécrire les choses. Ensuite, le plus important pour moi était de prévenir dans quelles conditions j’avais écrit, et ensuite de m’analyser un peu moi-même, de prendre du recul, et de voir ce que ça m’avait apporté et ce que ça pouvait apporter. Donc l’idée de publier le journal est finalement très récente, à peine un an, et elle vient vraiment des éditeurs. Quand j’ai écrit mon journal et quand je l’ai terminé, enfin quand il s’est terminé de lui-même sans que je le décide, à aucun moment je ne pense le publier.
ES : Vous en avez été le seul lecteur jusqu’à ce que qu’il parvienne aux éditeurs ?
CN : Oui. Les premiers qui m’ont lu sont mes éditeurs. Même ma compagne, à qui je lisais parfois de petits extraits, des petites boutades comme ça, ne l’avait pas lu, ni mes amis, ni même William[2], aucune personne proche qui aurait éventuellement pu le lire ne l’avait lu.
ES : À quoi ressemble le manuscrit au moment où vous écrivez ? C’est un seul fichier continu ?
CN : Oui, un seul fichier où j’écrivais à la suite, au fur et à mesure.
ES : Il y a eu beaucoup de coupe ?
CN : J’ai beaucoup coupé oui, mais en même temps rien d’important. Je mettais beaucoup d’extraits de journaux, de captures d’écran, de tweets, et puis je racontais aussi des choses plus personnelles, sur mes sorties etc., mais ça, ça n’avait aucun intérêt. C’est bien de les évoquer parce que ça fait partie de moi à ce moment-là, mais proportionnellement au reste c’était anecdotique. Même moi, en le relisant, je trouvais ça hors-sujet. Ce n’est pas tellement que c’était trop intime pour le public, c’est plutôt que ça ne collait pas avec l’esprit global du journal. Sinon ce sont des détails, des trucs redondants. C’est du gras en fait que j’ai coupé.
ES : Donc c’était originellement un fichier mais qui ne comprenait pas seulement du texte ? C’était un dossier composite ?
CN : Oui, par exemple à un moment il y avait des témoignages à la suite, de victimes, je ne sais plus où je les avais trouvés, dans un journal, dont j’avais fait un grand copier-coller qui faisait plusieurs pages, ou des captures d’écran de tweets – par rapport à toutes mes histoires avec Médine notamment[3] – il y avait pas mal de trucs comme ça.
ES : Et vous n’avez pas envisagé de publier ce manuscrit-là, tel quel ?
CN : Si, dans la première version que j’avais proposée à Libertalia, j’avais gardé une partie des tweets, des captures d’écran etc., des notes de bas de pages où je renvoyais aux liens d’émissions… mais finalement on a jugé que ce n’était pas nécessaire – que c’était mieux d’épurer.
ES : Si on parle maintenant de la publication de ce témoignage justement, on pourrait revenir sur votre position un peu spécifique de témoin-historien. Il parait évident de considérer que quand on est un témoin, on écrit l’histoire différemment, mais est-ce que, quand on est un historien, on témoigne autrement ? Quel témoin est-on et peut-on être quand on est historien ? En quoi votre expérience d’historien fait-elle de vous un témoin spécifique ?
CN : J’ai du mal à être sûr de moi là-dessus… c’est quelque chose que des journalistes m’ont dit, que mon témoignage était vraiment différent des autres, parce qu’il s’intéresse davantage à l’actualité, à l’analyse de l’actualité, à l’aspect politique des choses, ce qu’on ne voit pas tellement dans les autres témoignages de victimes qui sont sortis. Ce serait peut-être ça la spécificité, qui n’est pas calculée, ce serait peut-être ça mon côté historien : plutôt que de raconter ma vie, ce choix d’essayer d’être dans l’analyse – c’est de ça dont j’avais personnellement besoin. Il y a des victimes qui ont raconté leur reconstruction de façon très personnelle, d’autres qui ont parlé de la vie dans les associations, de la manière dont on crée des associations de victimes. De mon côté ce serait plutôt l’analyse politique : alors je parle aussi de moi bien sûr, mais proportionnellement, je parle beaucoup moins de moi que d’autres victimes.
ES : Et vous parlez assez peu finalement de l’événement lui-même, vous l’évacuez au début : comment ça s’est passé, est-ce que le témoignage que vous avez d’abord écrit sur Médiapart, sur la manière dont tout s’était passé pour vous, a ensuite permis de passer à autre chose ? Dès la première date du journal, le 5 décembre ?
CN : Oui, et là c’est intéressant par rapport aux faits eux-mêmes : il y a deux choses. Il y a effectivement le témoignage dans Médiapart qui m’a servi de déclic et en même temps voilà, ensuite je n’avais plus besoin de le réécrire, même pour moi, il me suffisait d’y revenir quand j’en avais besoin. Et je ne sentais pas le besoin ou l’intérêt en écrivant, même si c’était pour moi-même, de le re-raconter. Par contre, je reconstitue en quelque sorte l’événement au fur et à mesure du journal, par bribes. A la fin, globalement on sait ce qu’il s’est passé – et moi je le sais aussi. Ce n’était pas du tout calculé comme ça, mais je me le dis a posteriori : si on a lu le livre dans l’ordre, au fur et à mesure, on se rend compte que petit à petit je mélange mes souvenirs et ce que j’apprends par l’enquête pour pouvoir dire « ça doit être comme ça que ça s’est passé, j’étais là à telle heure, il s’est passé ça à tel moment, etc. » … je le raconte petit à petit avec les différentes pièces du puzzle, de ma mémoire, de mes souvenirs, de ce que j’apprends par l’enquête ou les médias, et à la fin on a une idée à peu près de ce que j’ai vécu, sans que j’aie eu besoin de refaire le témoignage de Médiapart.
ES : En fait l’événement est reconstitué au fur et à mesure mais pas seulement au travers de vos propres souvenirs ?
CN : Oui en fait je me sers des autres sources, et notamment l’enquête, pour m’aider à reconstituer l’événement sans me servir seulement de mes souvenirs, parce que je sais les limites de mes souvenirs… J’ai fait deux fois le programme de Peschanski en trois ans et on se rend compte qu’on oublie des choses, et puis il y a la distorsion du temps et de l’espace… J’ai mes souvenirs mais il y a aussi ce que disent les médias, et l’enquête, puisqu’étant partie civile, j’avais accès à l’enquête, et tout ça me permet de reconstituer l’événement vécu par moi, et l’événement tel qu’il est arrivé. La dernière vraie pièce du puzzle sera le procès.
ES : C’est peut-être ça, finalement, votre position d’historien, la spécificité de votre témoignage, c’est cette volonté de reconstituer, de recouper les différentes sources d’information dont vous disposez ?
CN : De croiser mes souvenirs avec des sources extérieures, oui.
ES : La publication a impliqué des coupes mais aussi un retour sur le texte, une analyse que vous esquissez à la fin du livre sur votre propre journal, avec une sorte de rigueur qui est finalement historienne, vous critiquez le texte, vous dégagez des périodes, des thèmes : vous avez tout de suite décidé d’accompagner le texte de cette analyse ?
CN : Oui tout de suite, déjà pour que les gens comprennent dans quel contexte le texte est produit, et ne pas le donner brut, comme ça. Si j’avais eu des visées littéraires, peut être que je l’aurais fait, mais je voulais que ce soit différent. C’était important pour les gens qui allaient le lire, mais aussi pour moi-même.
ES : Vous avez l’impression à ce moment-là, quand vous écrivez la postface, d’avoir une distance suffisante ?
CN : Pas du tout. J’avais plus de distance qu’il y a deux ou trois ans, mais pas encore suffisamment. Même en la relisant un peu récemment, j’ai l’impression qu’il y a encore des choses qui ressemblent à ce que j’écrivais dans le journal lui-même.
ES : Qu’est-ce qui a guidé le choix des mots du titre du livre ?
CN : Ce sont les éditeurs qui me l’ont proposé. De mon côté je n’avais aucune idée. Il y a toujours beaucoup de débats sur les titres, j’ai été assez pragmatique là-dessus, n’ayant moi-même pas tellement d’idée arrêtée. Les termes, c’est toujours compliqué : rescapé, survivant, victime… Il y a aussi quelque chose qui doit être accrocheur. Je me rappelle quand on avait publié Les Historiens de garde, il y avait cette couverture pour la première édition avec le drapeau français qui avait fait beaucoup débat entre nous. Là ça me convenait : je ne voulais pas qu’il y ait seulement « victime » avec un côté trop pathos, « survivant », ça fait un peu « je suis sorti de la guerre, etc. », rescapé ça me paraissait un juste milieu de ce point de vue. Ensuite dans le sous-titre, « Être historien et victime d’attentat » a créé parfois un peu d’incompréhension, avec des gens qui attendaient parfois davantage une vraie analyse historienne. Mais moi j’ai trouvé ça bien, ce « être historien », ça montre d’où je parle. De ce point de vue le sous-titre est plus intéressant que le titre – même si ça peut tromper sur certains aspects du livre : des gens qui ne sont pas historiens ou n’ont pas de formation de ce type ont pu penser que ça allait être plus un livre d’historien ou ce qu’ils voient comme un livre d’historien, c’est-à-dire un témoignage et ensuite une vraie et longue analyse, avec moins ou pas de choses ou de ressentis personnels. Ces personnes ne voient pas forcément l’aspect historien dans ce dont on vient de parler, sur l’analyse, le recoupement des sources, etc.
ES : La force et le retentissement du témoignage est décuplée par ce qu’il se passe au moment où il sort, c’est-à-dire l’assassinat de Samuel Paty : c’est-à-dire que ce dont il témoigne dépasse finalement ce dont peut être vous vouliez témoigner, notamment parce que vous êtes enseignant…
CN : Alors évidemment, j’aurais préféré me passer de ce genre de pub, mais c’est intéressant de voir comment ça s’est lancé, notamment à partir de l’article de Jean Birnbaum dans Le Monde qui dit à quel point ça résonne avec l’actualité et c’est vrai. J’ai eu ensuite beaucoup de questions dans les médias par rapport à ça, d’autant plus que je commence justement le journal en parlant de la menace sur les profs – donc des journalistes ont pu me dire ensuite que j’avais prédit ce qui allait se passer en quelque sorte, même si a priori le terroriste n’a pas de lien avec l’État islamique, mais au moins avec disons une idéologie djihadiste. Il y aussi le fait que je raconte plusieurs fois dans le journal mes craintes et mon anxiété par rapport à mon travail… tout ça donne finalement un éclairage intéressant au livre qui n’était pas forcément le plus facile à expliquer mais qui pour moi était important, notamment le rapport aux élèves, leur rapport à ce qu’il se passe, à Charlie Hebdo par exemple, et leur rapport avec moi. Cet aspect prof d’histoire qui n’était peut-être pas le plus visible ressort beaucoup plus aujourd’hui, mais il a toujours été important pour moi.
ES : La rentrée s’est bien passée ?
CN : Oui, on est grève mais à part ça… on s’est mis en grève lundi, à cause du sabotage de l’hommage par J.M. Blanquer. Mardi on a obtenu d’avoir ce qu’on aurait dû faire lundi, c’est-à-dire une réunion entre nous, ensuite on a reçu les élèves, ça s’est bien passé, j’avais une classe de 5e en binôme avec une collègue de français, ça a été très bien. Les élèves savaient des choses, mélangées avec des rumeurs et c’est normal, mais ils avaient beaucoup d’empathie pour le collègue. Avec eux on a presque pas parlé de l’aspect caricatures, de la liberté d’expression, on a vraiment parlé du professeur, de Samuel Paty, et des faits. On a parlé de la manière dont ils avaient appris les choses, c’était bien. En revanche avec ma classe de 4e, dont je suis prof principal, c’était plus dur, il n’y avait aucune réaction. Je les avais fait travailler pendant les vacances : au départ ils devaient bosser sur le procès des attentats de janvier 2015, et puis quand il y a eu l’attentat, je leur ai demandé un travail très factuel dessus. Ils ont presque tous rendu quelque chose, et au moment où je leur pose des questions, rien. Deux ou trois ont participé mais c’est tout, pas d’échange réel, mais pas de provocation non plus, aucun incident, rien. C’était bien d’avoir cet échange, mais avec cette classe c’était frustrant. Alors il faut continuer, dans les semaines qui viennent on fera d’autres travaux là-dessus, on met en place avec une collègue un blog du collège, tenu par les élèves, avec des articles d’actualité, on va rebondir là-dessus, je sais qu’ils sont meilleurs à l’écrit qu’à l’oral… mais donc oui, la rentrée s’est bien passée. Là maintenant on est en grève mais à cause du protocole sanitaire, c’est encore autre chose. L’ambiance est un peu pesante, l’assassinat du collègue et le protocole sanitaire nous plongent tous dans une incertitude à la fois sur la sécurité et la santé… mais ça se passe très bien au collège, avec les élèves, avec la direction aussi, même s’il y a de grosses négociations sur le protocole, ça se fait dans le respect. Ça va bien.
ES : Vous parlez plusieurs fois de la manière dont vous gérez ça avec les élèves, à votre retour au collège après le 13 novembre, quand vous êtes absent par la suite aussi… Est-ce que ça ressurgit maintenant avec la sortie du livre ?
CN : Les élèves étaient au courant qu’on était au Bataclan, avec mon collègue et ami David, le fait qu’on soit deux était important. Tout le monde le savait, ils pouvaient me poser des questions, il n’y avait aucun problème. Après, depuis l’année dernière, et surtout cette année, a priori, à part les frères et sœurs des élèves que j’ai déjà eus, ils ne sont pas censés savoir. En même temps je n’ai pas envie de leur cacher, mais je n’ai pas envie de l’utiliser. Je veux rester neutre. Quand il y a des sujets à risque, par exemple quand on a parlé du procès des attentats de janvier, j’ai aussi évoqué les attentats du 13 novembre, et les élèves me regardaient comme un prof normal. Mais je suis passé sur Quotidien mardi et des élèves m’ont ensuite sauté dessus, « monsieur, vous êtes passé à la télé, c’est vrai que vous avez fait un livre ? c’est vrai que vous étiez au Bataclan ? » et puis il y en a un qui m’a dit « ah bah c’est bon vous vous en êtes sorti ». Ce qui est intéressant c’est que ces élèves, de 5e, qui m’ont dit ça mardi, une fois qu’on était en classe, qu’on a parlé de Samuel Paty, des attentats djihadistes, il n’y en a aucun qui a fait référence à moi ou manifesté quoi que ce soit. C’est intéressant de voir à quel point ils cloisonnent, d’eux-mêmes.
—
[1] Ce programme transdiciplinaire, qui doit se dérouler jusqu’en 2028, est composé de plusieurs études parallèles. Son objectif est d’étudier la construction et l’évolution de la mémoire après les attentats du 13 novembre 2015, et en particulier l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. Voir https://www.memoire13novembre.fr/.
[2] William Blanc, co-auteur avec Christophe Naudin de deux ouvrages : Les historiens de garde. De Lorànt Deustch à Patrick Buisson, la résurgence du roman national, Inculte Essai, 2013, réed. en poche chez Libertalia avec une postface inédite, 2016 ; et Charles Martel et la bataille de Poitiers. De l’histoire au mythe identitaire, Libertalia, 2015.
[3] En juin 2015, l’annonce de deux concerts du rappeur Médine au Bataclan provoque une vive réaction, en particulier sur les réseaux sociaux.cha