Le choix des mots : à propos de la « lettre aux instituteurs » de Jean Jaurès
Pourquoi les mots de la « lettre aux instituteurs » de Jean Jaurès, qui ont semblé si justement résonner dans la cour de la Sorbonne le 21 octobre dernier, ont-ils brusquement pu paraître discordants lors de la rentrée scolaire du 2 novembre dernier ? Peut-être parce qu’ils ne s’adressaient pas à celles et ceux à qui on a voulu la lire, et qu’ils ne disaient pas exactement ce qu’on voulait lui faire dire. Emmanuel Jousse revient pour Entre-Temps sur le sens de cette lettre, et sur les questions que le texte de Jaurès pose, in fine, à l’ensemble de la société.
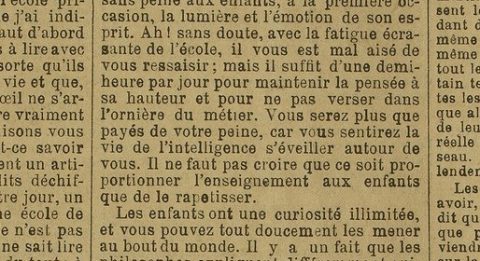
Les mots de Jean Jaurès ont particulièrement résonné dans la cour de la Sorbonne, le 21 octobre, lors de l’hommage rendu à Samuel Paty[1]. Une prose aux périodes longues, aux termes choisis, qui exige beaucoup du lecteur et davantage encore de l’auditeur. La controverse sur le « caviardage » de ce texte est un faux procès : on ne lit pas un texte de Jaurès devant une classe sans la préparer, sans le préparer. Les coupes ne révèlent aucune manipulation coupable, tout au plus montrent-elles que nos élèves ont changé. Mais quel truisme de l’écrire !
En vérité, c’est le choix du texte lui-même qui peut surprendre, et c’est une bonne surprise parce qu’il est très beau. Il s’agence comme un dialogue, où Jaurès conseille au nom de l’expérience de qui connaît « les fatigues écrasantes de l’école », anticipe les objections en y répondant par ses conseils. Benoît Kermoal a rappelé la densité de cette relation, de cette affection qui unit Jaurès aux instituteurs[2]. Ce registre de l’intimité n’est déjà plus celui du discours de distribution des prix au lycée d’Albi, prononcé quelques mois plus tard, le 31 juillet 1888. Jaurès y tenait aux bacheliers des propos qui auraient sans doute plus efficacement touché les élèves le 2 novembre dernier : « il est autre chose que vous emportez du lycée : c’est ce sentiment de générosité humaine qui tient à ce que vous avez appris à comprendre et à aimer les hommes quel que soit leur habit, quelle que soit leur condition ». Contrairement à ce discours, la lettre lue en Sorbonne n’était pas destinée à des élèves, mais à des enseignants. Elle évoque leur vocation et la responsabilité qu’elle implique. Elle interroge leur place dans l’institution scolaire et dans la société. Le ministère de l’Éducation nationale a décidé d’introduire une continuité factice entre l’hommage en Sorbonne et l’hommage en classe, par un texte qui se prêtait au premier contexte, mais pas au deuxième. Pas de complot, donc, mais beaucoup de maladresse.
Jaurès adresse sa lettre « aux instituteurs et aux institutrices », leur parle de leur métier, de leurs difficultés et de leur mission. Mais il ne leur parle pas de laïcité. Ni l’idée ni le terme n’apparaissent dans la lettre de 1888, alors que les hommages multipliés depuis le 16 octobre l’ont mise au cœur du drame noué à Conflans. À nouveau, d’autres textes jaurésiens auraient certainement été mieux adaptés pour en définir la notion en classe, en particulier le discours que Jaurès prononce en 1910 à la Chambre, connu sous le titre de « Pour la Laïque ». Alors que la loi de Séparation des Églises et de l’État est votée depuis décembre 1905, alors que son règlement a provoqué les tensions de la querelle des inventaires en 1906, l’opposition catholique se saisit du débat sur les manuels scolaires pour revendiquer la liberté des familles dans les choix d’enseignement. Les mots de Jaurès sont donc plus explicites, plus militants aussi, car il est devenu le héraut du socialisme depuis 1893 et le héros de l’Affaire Dreyfus depuis 1898. La définition qu’il propose de la laïcité l’intègre dans le projet éducateur de la République, en des termes qui auraient pu être repris à la rentrée de novembre : « L’idée, le principe de vie qui est dans les sociétés modernes, qui se manifeste dans toutes leurs institutions, c’est l’acte de foi dans l’efficacité morale et sociale de la raison, dans la valeur de la personne humaine raisonnable et éducable. C’est ce principe qui se confond avec la laïcité elle-même. L’exercice de la souveraineté, l’exercice de la puissance publique dans les nations modernes n’est subordonné à aucune formule dogmatique de l’ordre religieux ou métaphysique. Il suffit qu’il y ait des citoyens, il suffit qu’il y ait des êtres majeurs ayant leur liberté, leur personnalité et désireux de mettre en œuvre ce droit pour que la nation moderne dise : voilà la source unique et profonde de la souveraineté ». Le choix de maintenir le même texte d’un hommage à l’autre a donc institué un deuxième décalage : celui d’en faire le prétexte d’une explication de valeurs qui ne sont pas au cœur de la lettre.
Ce texte était-il entièrement hors-sujet ? En réalité, il exprime le fond du métier d’enseignant lui-même, à travers deux fils qui en tissent la trame. C’est, d’abord, la responsabilité des enseignants, qui tiennent en « mains l’intelligence et l’âme des enfants », charge à eux de leur transmettre les faits du savoir, les valeurs de la citoyenneté, et les fondements de la personnalité humaine. Pour Jaurès, cette responsabilité est éminemment sociale, car les enseignants doivent placer leurs élèves « en relation familière avec la pensée humaine ». Dans la lettre de 1888, cette responsabilité est un face-à-face entre l’enseignant et l’élève sous la supervision de l’État. Aujourd’hui, ce dialogue n’est plus enfermé dans les murs de l’école. L’enseignant s’intègre dans une équipe où interviennent ses interlocuteurs hiérarchiques, ses collègues et les conseillers principaux d’éducation, les acteurs du suivi quotidien des élèves (infirmerie, conseillers d’orientation, psychologues, services sociaux), et, évidemment, les parents. Cette « communauté éducative » a l’immense mérite d’accorder une place aux élèves qui, pour des raisons diverses, restaient naguère à l’écart. Mais les enseignants n’ont pas été préparés à un travail d’équipe qui exige bien plus que des qualités académiques ou pédagogiques. Et inversement, tous leurs partenaires n’y sont pas adéquatement formés. Surtout, chacun s’y méfie de tous. Combien d’enseignants reprochent-ils à leurs rectorats de ne pas les accompagner ; à leurs directions d’établissement de ne pas les soutenir ? Et inversement, combien de chefs d’établissement considèrent leurs enseignants comme « le taon sur le flanc d’un cheval un peu mou » ? Combien de parents expliquent leur fait à un enseignant dont ils mettent les choix en cause, et combien d’enseignants considèrent les parents comme des intrus dans leurs activités pédagogiques ? Le drame de Conflans a bouleversé de nombreux professeurs parce que l’horreur de l’acte assemble et remonte des petites mécaniques qui surviennent immanquablement dans le cours d’une année scolaire : la protestation d’un élève devant un contenu qu’il juge inacceptable ; le conflit avec un parent d’élève qui rappelle le professeur à l’ordre ; le soutien défaillant de l’institution qui étouffe les conflits pour mieux les éteindre. L’issue est terrifiante, et d’autant plus terrifiante que chacune de ses étapes initiales est possible.
La lettre de Jaurès est d’autant plus touchante qu’elle n’entretient pas d’illusion non plus sur ce que sont les élèves, avec leur « curiosité illimitée », mais aussi leurs « rechutes profondes d’ignorance et de paresse d’esprit ». Pas plus qu’en 1888, les enseignants ne sont naïfs sur les enfants qui repoussent les murs de la classe et la rendent transparente à l’extérieur, par leur usage du numérique en particulier. Les professeurs restent démunis, et les seules réponses dont ils disposent sont celles de l’expérience et de leur bon sens, deux qualités qui ne se formalisent dans aucune séquence pédagogique proposée par les rectorats. En revanche, ces deux qualités ont absolument besoin d’un élément qui fait trop souvent défaut : les enseignants doivent avoir confiance dans une institution qui se met à leur service. Le renoncement à débattre avec les élèves de notions qui les bousculent n’a d’autre cause que le sentiment anticipé, et donc hypothétique, de ne pas trouver de soutien quand ils en auront besoin. Les directions d’établissements doivent entretenir une relation de confiance avec les enseignants, car quand cette confiance existe, bien des choses changent, pour reprendre les termes de Jaurès. Les rectorats doivent rester au service des enseignants et les accompagner individuellement, ce qui n’est pas toujours le cas. Avant même l’assassinat de Samuel Paty, combien d’enseignants se sont sentis délaissés par leurs rectorats lors du premier confinement, et combien ont alerté, sous le hashtag #PasDeVague, sur leur solitude ? C’est dans cette redéfinition de « l’école de la confiance » que les professeurs pourront pleinement reprendre à leur compte cette phrase de Jaurès de 1910 : « on n’enseigne pas ce que l’on veut ; je dirais même que l’on n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que l’on croit savoir : on n’enseigne et on ne peut enseigner que ce que l’on est ».
Naturellement, une telle exigence n’amoindrit pas l’importance de la formation. Jaurès écrit au contraire que l’enseignant doit être « tout pénétré de ce qu’il enseigne », qu’il doit disposer « d’une demi-heure par jour pour maintenir la pensée à sa hauteur et pour ne pas verser dans l’ornière du métier ». Cette prise de distance est difficile à maintenir dans le flux quotidien du travail collectif de la « communauté éducative ». Elle est découragée par la distance creusée entre l’enseignement secondaire et la recherche. Les explications d’un tel constat sont nombreuses, et tiennent autant à la spécialisation de la recherche elle-même qu’aux raideurs d’une administration qui ne sait pas encourager l’inventivité de ses enseignants. Il faut le rappeler, pourtant : c’est bien souvent la passion pour une discipline qui oriente vers sa transmission, et non l’intérêt pour la pédagogie elle-même. Certes, l’enseignement de l’histoire-géographie change parce que la société elle-même évolue. Mais il se transforme aussi en raison des mutations des disciplines elles-mêmes. Si les programmes de seconde mettent l’accent sur les échanges dans la Méditerranée médiévale, ou sur la rencontre de l’Autre dans les explorations du XVIe siècle, c’est parce que les chercheurs ont préalablement redéfini leurs programmes de recherches grâce aux apports de l’histoire transnationale. Or, si le lien se rompt, ces ajustements seront impossibles. L’enseignement secondaire restera fixé dans des postures immobiles sans voir le monde changer alentour, et la recherche sera incapable de saisir ce dont les enseignants ont besoin pour assumer la charge de « faire sentir à l’enfant l’effort inouï de la pensée humaine ».
Pour l’histoire-géographie, la distance joue sur deux plans aussi graves l’un que l’autre. D’un côté, la réforme du baccalauréat redéfinit profondément le périmètre de la discipline. La réduction à trois semaines de la classe de seconde de l’histoire ancienne et médiévale, au profit d’une histoire contemporaine dilatée sur les deux années de première et de terminale, couronne une évolution déjà en cours. En revanche, l’apparition d’un enseignement de spécialité intitulé « Histoire, géographie, géopolitique, science politique », explicite un horizon pluridisciplinaire. L’histoire-géographie tend à s’intégrer dans un enseignement généraliste de « sciences humaines et sociales », conjointement avec les sciences économiques et sociales obligatoires en seconde, en spécialité dans les autres classes. Les enseignants sont-ils formés à cette pluridisciplinarité ? Ont-ils les moyens de répondre à l’élargissement du périmètre de leurs enseignements ? Chacun d’eux peut-il, comme l’écrit Jaurès, être « tout pénétré de ce qu’il enseigne » ?
L’enseignement moral et civique (EMC) pose d’un autre côté les conséquences de ces indéterminations. Voilà un enseignement qui n’est identifié par personne, faute de directive claire pour savoir qui l’enseigne et comment. Formellement, n’importe quel professeur peut le dispenser au lycée. Les professeurs d’histoire-géographie le prennent en charge dans l’extrême majorité des cas, car leurs collègues sont tenus de le faire au collège. L’EMC devient bien souvent une variable d’ajustement pour boucler des programmes d’histoire-géographie très lourds, ou pour compléter des services rendus incohérents par le jeu des options, des dédoublements de classes ou des décharges. Les directives sont très vagues -elles ont été opportunément précisées fin octobre : en classe de seconde les élèves discutent la notion de liberté ; en classe de première ils interrogent le lien social ; en terminale ils examinent la démocratie. Pas d’indication précise sur une mise en œuvre concrète : l’enseignement valorise surtout la discussion d’enjeux très contemporains sous la forme de débats, de travaux collectifs, d’initiatives déployées dans les établissements. L’enseignant est seul pour inventer, et ce qu’il en fera dépendra des classes qu’il trouve, de l’implication de l’établissement, de sa propre motivation. Pour cette raison, les élèves ne saisissent pas les objectifs de l’enseignement moral et civique : il n’est lié à aucun contenu académique identifiable pour eux, ni à une structure claire d’évaluation ; son contenu peut considérablement différer d’un établissement et d’un enseignant à l’autre. Quant aux parents, beaucoup ont probablement découvert l’existence de cet intitulé des emplois du temps et des bulletins trimestriels après l’assassinat.
Et c’est précisément ce qui n’est pas anodin : que la mort de Samuel Paty ait été provoquée à la suite d’un enseignement d’EMC. Comme la discipline n’est identifiée par personne, le discours de l’enseignant se trouve de plain-pied avec celui des élèves. Il doit déconstruire des discours de haine, les mots quotidiens du racisme, de l’antisémitisme ou du fondamentalisme, avec la seule arme de son raisonnement et de ses convictions. Comme l’écrit Jaurès dans « Pour la Laïque », le professeur doit apprendre à ses élèves « la même liberté de réflexion et […] leur soumettre la même information étendue ». En somme, il ne peut que les ouvrir à l’exercice du jugement critique, sans jamais l’exercer à leur place. Il arrive souvent, et c’est heureux, que les élèves bousculés dans leurs représentations en tirent la construction d’un jugement plus élaboré. Mais il peut arriver aussi que le raisonnement du professeur ne suffise pas. Qu’il se heurte à un mur.
Là encore, le problème n’est pas tant la transmission des valeurs républicaines, que la façon dont elle s’opère dans le quotidien des classes. La tâche est d’autant plus difficile que le professeur doit accompagner des enfants et des adolescents âgés de 10 à 18 ans. La laïcité, la liberté d’expression, les valeurs républicaines, ne peuvent être discutées de la même façon avec des élèves de 4e et des élèves de terminale. La remarque est tellement évidente qu’elle ne fait pas l’objet d’un accompagnement particulier pour la pratique quotidienne des enseignants. Et une séquence organisée sur la laïcité sera-t-elle efficace ? Ne risquera-t-elle pas d’identifier cette valeur à un enseignement scolaire obligatoire, donc distancié ? Ne faut-il pas davantage que l’enseignant puisse saisir, dans sa classe, un incident qui pourrait le conduire à transmettre le message sur les valeurs de la République ? Dès lors, pourquoi le professeur d’histoire-géographie serait-il le seul à le faire sur un horaire dédié, comme si les valeurs de la République n’étaient importantes que trente minutes par semaine ? Et pourquoi la réflexion sur la transmission de la laïcité à l’école doit-elle toujours prendre la forme d’un examen parfois inquisitorial sur ce que font ou ne font pas les enseignants dans leurs classes ? Ne s’agit-il pas d’un débat qui implique l’ensemble de la société française, les parents d’élèves, les citoyens ? En somme, il n’y aura pas de réflexion sérieuse sur la transmission des valeurs de la République sans réflexion profonde sur ses transmetteurs. Sur les professeurs, donc.
Le choix de la lettre de 1888 aura donc été particulièrement opportun, mais pas pour les raisons attendues. Il ne s’agit pas d’un discours destiné aux élèves, ni d’un éloge vibrant de la laïcité (ni même de la liberté d’expression, d’ailleurs). En revanche, il pose frontalement la question du rôle de l’enseignant dans l’institution scolaire et dans la société, de ses moyens d’action. Ce débat a été trop souvent escamoté pour qu’on l’évacue d’un revers de main. Il est nécessaire de s’interroger collectivement sur la transmission des valeurs républicaines de liberté et de laïcité. Il est plus nécessaire encore de réfléchir sérieusement et honnêtement sur la place et le rôle de celles et ceux qui le font tous les jours.
—
[1] Les textes de Jaurès font l’objet d’une édition critique en 17 volumes. La lettre aux instituteurs et aux institutrices ainsi que le discours pour la distribution des prix prononcé à Albi figurent dans le premier volume (Jean Jaurès, Œuvres, vol. 1. Les années de jeunesse (1859-1889), édition établie par Madeleine Rebérioux et Gilles Candar, Paris, Fayard, 2009, p. 255-263). Le discours parlementaire intitulé « Pour la Laïque » figure dans le volume 12 (Jean Jaurès, Œuvres, vol. 12. Penser dans la mêlée (1907-1910), édition établie par Jean-François Chanet et Emmanuel Jousse, Paris, Fayard, à paraître en 2021).
[2] https://jean-jaures.org/nos-productions/jaures-les-instituteurs-les-institutrices-et-la-republique