Pas trop vite, pas plus tard : maintenant
Face au chagrin, à la colère, à la honte, on peut faire silence. On le doit même, pour préserver quelque chance de se relever dignement. Mais comment souffrir alors l’insupportable brouhaha des commentaires inutiles, comment se préserver de cette blessure qu’inflige à l’intelligence et à la volonté la nuée hargneuse des paroles imprécises ou déplacées ? Alors il ne suffit plus de se taire pour faire silence, et ce n’est pas le trahir que de se remettre à parler — non pour exprimer je ne sais quelle conviction, mais simplement pour tenter de se comprendre.
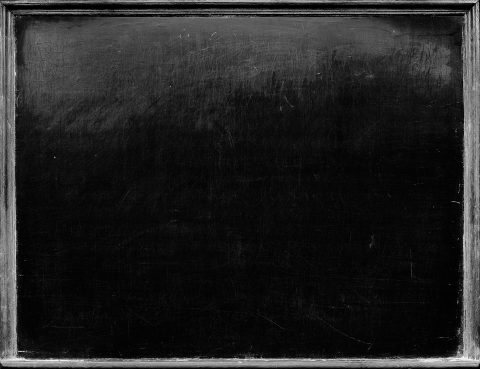
Et puis, pour beaucoup, on n’a pas le choix. Nos collègues qui se retrouveront lundi 2 novembre face à leurs élèves, ceux qui, dans les universités, forment les futurs enseignants, ceux-là ont dû ou devront trouver les mots, aller chercher au plus profond d’eux-mêmes, là où niche la sincérité de leur engagement, pour tenter de comprendre ce qui a rendu possible cette folie meurtrière : l’assassinat de Samuel Paty, enseignant d’histoire et de géographie, pris pour cible et atrocement mis à mort par le terrorisme islamiste parce qu’il enseignait à des enfants la liberté d’expression. Il l’enseignait, c’est-à-dire qu’il ne l’inculquait pas, qu’il ne prétendait pas imposer ce qu’il croit, ou ce qu’il espère, à des esprits dociles. Il l’enseignait, en n’étant sûr de rien, en se méfiant de lui-même, en ne se laissant griser ni par la violence du dire ni par l’adhésion à ses propres valeurs, mais en tentant d’agir avec tact, humanité, prévenance, en rendant son savoir serviable et fraternel. Il l’enseignait ainsi, car la joie d’enseigner n’est jamais indemne de cette inquiétude profonde, et on l’a tué pour cela.
Qui ça « on » ? C’est là que les ennuis commencent. Dès lors que l’on cherche à nommer et circonscrire la menace en ne se contentant pas de ces deux facilités symétriques que sont le déni et l’inculpation généralisée, les ennuis commencent. Car il faudrait pouvoir tenir ensemble une description réaliste de cette nouvelle banalité du mal où chaque segment d’action, erratique et médiocre, demeure d’une bêtise affligeante mais où l’idéologie meurtrière qui les lie entre eux poursuit, d’un attentat l’autre, un projet politique d’une intelligence et d’une efficacité terrifiantes. Le djihadisme global, on le sait désormais, développe une haine particulière vis-à-vis du modèle républicain français ; sa capacité de destruction de la société, on le craint aujourd’hui, ne connaît pas de limites.
De cette catastrophe en cours, la déchéance du débat public est davantage qu’un symptôme, mais bien l’agent actif. Il n’aura fallu que quelques heures après l’assassinat de Samuel Paty pour que nombre de politiciens sans scrupule et d’idéologues sans vergogne sautent sur l’occasion afin de solder leurs petites querelles, trop heureux de raviver leurs rancœurs ou d’exhiber leurs certitudes. Derrière cette apparente confusion, il n’y a, comme d’habitude, qu’un seul parti qui progresse : celui de la bêtise à front de taureau beuglant son éloge de la force. Va-t-on continuer à assister, impuissants, à la trumpisation du monde ? Pour toutes celles et tous ceux qui n’y peuvent consentir, il appartient de réfléchir collectivement aux conditions politiques de rétablissement d’un véritable espace public, à bonne distance de l’esprit de meute qui agite les réseaux sociaux et de la continuation routinière des effets de tribunes.
Et pour commencer — ou disons : recommencer — pourquoi ne pas s’accorder sur une règle simple ? La valeur d’une parole publique dépend d’abord de la probité avec laquelle elle reconnaît le lieu propre d’où elle s’énonce. Si l’on prend au sérieux un tel précepte, force est de constater que la plupart des reproches, des exigences, des complaintes ou des recommandations charitables que s’autorisent les commentateurs professionnels sur l’exercice de l’histoire en milieu scolaire sont nuls et non advenus. Je n’ai pour ma part jamais enseigné en collège et en lycée, mais je défends la solidarité de savoir, de méthode et de valeur de la profession historienne. Or c’est celle-ci que les assassins de Samuel Paty ont frappé à la tête, en ce jour funeste du vendredi 16 octobre 2020. Sera-t-on assez inconséquent pour croire que notre métier n’en puisse être durablement, douloureusement, profondément affecté ?
Notre métier. Voici ce que l’on propose de soumettre à l’examen critique. Non pour le proclamer — encore une fois, rien n’est plus contraire à l’exercice de l’histoire que l’affirmation claironnante de principes intangibles — mais pour en défendre la beauté, la nécessité et la fragilité. Car voici ce que Samuel Paty enseignait à ses élèves dès lors qu’il choisissait de s’adresser à leurs intelligences singulières pour les guider sur le chemin de l’émancipation, et voici en quoi nous lui serons toujours, humblement, redevables. Critiquer n’est pas récuser, et l’on peut sortir renforcés de l’épreuve du doute — il faut donc tout à la fois croire avec ardeur aux principes politiques qui nous fondent et ne jamais cesser de les remettre en cause par l’exercice opiniâtre de la critique historique.
Tandis que l’on assiste accablés au festival des « oui mais », il est urgent de rétablir la dignité de la coordination « et » qui, sans feinte ni concession, affirme simplement et tranquillement que deux faits ou deux énoncés peuvent être également vrais. Les universitaires, par exemple, sont des enseignants-chercheurs — entendons qu’ils sont enseignants et chercheurs, et qu’ils ne sont pas moins enseignants en étant chercheurs. Or ce qui est vrai à l’université l’est tout autant à l’école, au collège ou au lycée : l’histoire est une discipline d’enseignement et de recherche, et un enseignant n’affaiblit jamais son autorité en cherchant les moyens de la rendre intelligible.
Au moment où le Ministre de l’éducation nationale accuse honteusement l’université de « faire des dégâts dans les esprits » tandis que sa collègue de l’enseignement supérieur, de manière tout aussi scandaleuse, ne prend même pas la peine de défendre l’institution dont elle a la charge, il appartient à toutes les historiennes et tous les historiens de profession de réaffirmer collectivement le sens, la portée et les limites de leur mission. On n’est pas assez naïf pour croire que l’exemple puisse venir d’en haut. Mais l’on sait ce qu’il faut de patience, de générosité et d’abnégation pour mener à bien un tel travail critique en surmontant des années de paresse, de renoncement ou d’indifférence. Il nous faut pour cela des forum calmes. La revue Entre-Temps peut y contribuer, en demeurant fidèle à la promesse de son nom. Pas trop vite, pas plus tard : maintenant.