L'histoire documentée : un entretien avec Iris Pupella-Noguès
Histoire publique, documentation audiovisuelle, recherche : entre ces pôles, Iris Pupella-Noguès a navigué et navigue toujours. Retraçant les début d'un parcours professionnel original, elle évoque avec Benjamin Vavon les usages de l'histoire dans les productions documentaires, l'audiovisuel comme support de la recherche, entre autres.
Benjamin Vavon : Remontons ensemble jusqu’en 2016. Vous êtes alors étudiante en master d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et vous assistez à l’intervention d’Olivier de Bannes, producteur de films documentaires et fondateur en 2010 de la société O2B films. C’est une rencontre importante puisqu’elle va dessiner les traits de votre futur parcours. Dans quel cadre précis est-elle survenue ?
Iris Pupella-Noguès : C’est le professeur d’histoire contemporaine Guillaume Cuchet qui avait invité Olivier de Bannes, avec lequel il est ami de longue date. Il lui avait proposé d’intervenir dans son cours pour parler de son dernier documentaire. De mon côté, j’étais effectivement en master recherche et j’envisageais de travailler par la suite dans les médias et avec les images. La télévision, les documentaires étaient des univers qui me plaisaient bien. J’ai donc trouvé ça génial qu’Olivier de Bannes vienne présenter French Bashing. L’idée du documentaire lui était venue après le refus de la France de participer à la guerre en Irak en 2003. Il s’agissait pour lui de comprendre pourquoi les Anglo-saxons détestaient à ce point les Français. Je connaissais déjà le master d’histoire publique, que ma directrice de mémoire, Catherine Brice, avait créé à l’UPEC l’année précédente. C’est donc avec l’idée de faire ce master que je suis allée voir Olivier à la fin de sa présentation pour lui demander s’il serait possible de réaliser le stage de fin d’étude du master pour lui. Un an plus tard, je commençais à O2B films.
B. V. : Votre stage a eu lieu durant les derniers mois du master après un premier semestre de théorie et de mise en pratique. En quoi ce moment de la formation a-t-il forgé votre conception de l’histoire publique ?
I. P-N. : Nous étions dix dans ma promotion, cinq garçons et cinq filles. Tout le monde venait de la recherche, et nous avons toutes et tous été passionné·e·s par le fait de penser l’histoire autrement. Avec deux camarades, nous avons travaillé pour l’émission La Fabrique de l’histoire d’Emmanuel Laurentin, diffusée sur France Culture. Emmanuel Laurentin souhaitait que les archives de l’émission puissent faire l’objet d’une étude. Nous avons eu l’idée d’aborder la façon dont l’émission avait traité le genre durant ses vingt années d’existence. Pour ce projet nous sommes allés piocher dans les archives de l’émission à l’Inathèque, à la BNF et en avons tiré un article bien illustré – un peu dans le style des articles de L’Équipe– qui a été publié sur la page de La Fabrique. Ça a été pour moi un premier pas dans les médias et dans la recherche documentaire. Cela m’a aussi permis de me familiariser avec le fonctionnement de l’INA : ses inventaires, son moteur de recherche, son site physique.
B. V. : Forte de ces premiers contacts directs avec le monde audio-visuel, vous entamez votre stage en janvier 2017 à O2B films. Là, vous participez à la production de la collection documentaire Topoï. De quoi s’agit-il ?
I. P-N. : Cette collection s’inspire très fortement des Mythologies de Roland Barthes. Olivier, qui avait adoré ce livre, avait eu envie de s’intéresser aux mythologies de notre époque. Il avait donc préparé des numéros sur Gérard Depardieu, sur le Big Data, sur la « pétasse » – je ne suis pas sûre qu’aujourd’hui on l’intitulerait comme ça ; les mythologies changent vite –, il y en avait aussi un sur le selfie. Quand je suis arrivée en janvier, Topoï était déjà entré en production, les tournages avaient commencé. Je devais travailler les chargés de développement, qui s’occupent de l’aspect éditorial et avec les documentalistes, pour la recherche d’images, et notamment d’images d’archives. Je me suis rendu compte que ce qui était appelé « images d’archives » englobait en fait toutes les images hors-tournage utilisées pour illustrer le propos. Dans mon mémoire « De l’histoire dans les films documentaires non historiques », j’ai essayé de comprendre le statut, la fonction de ces images chez O2B films. La couleur de l’image (ou son absence de couleur) jouait évidemment un rôle important. Le noir et blanc était utilisé pour faire ancien. Les images en couleurs participaient à la construction d’une identité très pop, très décalée, qui s’ajustait aussi à une demande de la chaîne, parce que les documentaires étaient diffusés le soir.
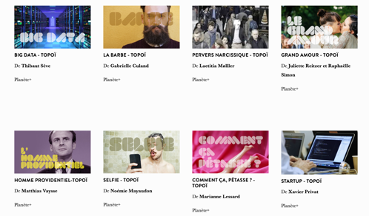
B. V. : Votre expérience de chercheuse vous avait déjà appris à être synthétique et d’une certaine manière pédagogue. Là, l’exercice était assez différent, qui plus est dans le cadre de documentaires non historiques. Quelles ont pu être vos difficultés ?
I. P-N. : J’ai été très bien entourée. Les documentalistes avec qui j’ai travaillé m’ont vraiment aidée pour la recherche d’images. Ça n’était pas un transfert de compétence, ni un changement radical. À un moment Olivier a eu une idée en tête, celle de traiter de l’amour, de son mythe et de ses origines. Cela m’a conduit à mener des recherches et notamment à lire L’Amour et L’Occident de Denis de Rougemont (1939). Comme pour un exercice universitaire, en plus de lire le livre, j’avais rassemblé et étudié tout une bibliographie autour. Mais Olivier voulait un synopsis, un pitch pour vendre son documentaire à des chaînes. Là, je me suis rendu compte qu’il y avait en tout une nécessité de vulgarisation. Il faut être efficace et assez rapide pour trouver un angle d’approche original.
B. V. : En quoi votre profil d’historienne pouvait particulièrement intéresser Olivier de Bannes ?
I. P-N. : Plusieurs membres de la société venaient du milieu des sciences humaines. Constance, la directrice des chargés de développement, était sortie de l’EHESS ; une autre personne avait fait de l’anthropologie et de la sociologie. Olivier, quant à lui, avait fait Science Po. Moi, je venais de l’université et c’était un réel apport à mon sens. La formation en histoire a également beaucoup d’atouts : on en tire méthode rigoureuse de traitement de l’information, mais aussi une grande ouverture d’esprit. Enfin, le fait que je puisse comprendre rapidement le substrat et les références de Topoï en arrivant à O2B films a été un plus pour m’intégrer à un projet déjà bien engagé.
B. V. : Après ce stage, le master d’histoire publique touchait à sa fin. Il vous a donc fallu trouver un travail. Vous êtes restée dans l’audio-visuel en intégrant la chaîne TF1.
I. P-N. : En effet, j’ai travaillé pour les JTs de TF1 et LCI, la chaîne d’infos en continu du groupe. C’était un milieu dans lequel j’avais envie de continuer à évoluer après mon stage. J’aurais pu chercher des contrats d’intermittente dans des boîtes de production comme documentaliste pour les documentaires. Mais j’avais en poche un master d’histoire publique, très peu connu en France à ce moment-là, et je voulais le valoriser. Sur le conseil des membres de O2B films, je me suis lancée dans la préparation d’un diplôme supplémentaire de documentaliste multimédia. J’ai fait une formation en alternance à l’INA et à TF1 qui a duré un an, de l’automne 2017 à l’automne 2018. TF1 m’a engagée ensuite sur un CDD d’un an.
La différence avec O2B films c’est que l’histoire avait pratiquement disparu de mon travail. J’étais rattachée à la cellule info de TF1 et LCI. Je travaillais pour les JTs du 13h, du 20h et les journaux en continu de LCI. Il y avait néanmoins quelques petites références à l’histoire pour les anniversaires, les commémorations pour lesquelles je pouvais apporter ma touche d’historienne. Par exemple, dans les séquences consacrées au débarquement, il y avait grosso modo trois minutes sur l’histoire de l’événement, puis trois autres sur le commando Kieffer, ce qui donnait à ce dernier une importance qu’il n’avait pas eue. J’ai essayé de rééquilibrer la partition. Quand il y avait un sujet sur Coluche, j’ai suggéré de ne pas toujours prendre la même photo de l’humoriste en salopette. Coluche, c’est aussi autre chose ! Souvent, à un sujet correspond une image, qui peut être très stéréotypée. Le rôle des documentalistes est d’amener vers de nouveaux horizons. On était vingt-quatre dans mon équipe et la plupart d’entre nous venaient de l’histoire. Comme quoi l’histoire mène à plein de choses !
B. V. : Vous êtes actuellement en doctorat, pourquoi ce retour vers la recherche alors que vous vous étiez lancée dans une démarche professionnalisante qui avait débouché sur une embauche ?
I. P-N. : C’est un peu un retour au premier amour. L’idée m’est venue en 2018-2019. Initialement je voulais questionner la présence des monuments fascistes dans l’Italie d’aujourd’hui. En 2014-2015 j’avais fait un Erasmus à Rome et j’avais été frappée de constater la permanence de ces monuments dans le paysage urbain et en 2015, le monde anglo-saxon avait été confronté aux premiers mouvements de décolonisation de l’espace public. J’avais envie d’interroger concrètement ce sujet en Italie.
J’ai donc quitté TF1, même si tout s’y passait très bien, et j’ai présenté mon projet doctoral à Catherine Brice à l’UPEC. Je me concentre sur les pratiques politiques quotidiennes des espaces publics à Trieste, ville frontière, entre 1919 et 1943 et suis inscrite en cotutelle, étant aussi dirigée par Tullia Catalan, professeure à l’université de Trieste. Mon ambition est également de faire un documentaire issu de mon travail de thèse ; d’interrogeant les Italiens sur leurs rapports à ces monuments fascistes.

B. V. : Ça n’est donc pas un sujet de thèse en histoire publique, mais bien un sujet d’histoire stricto sensu.
I. P-N. : Exactement. Ceci dit, en parallèle de mes recherches, j’ai eu l’opportunité de réfléchir à l’histoire publique de la monumentalité fasciste à Trieste et à Bolzano, autre ville frontière et cosmopolite, devenue italienne après la Première guerre mondiale. J’ai essayé de comprendre comment les municipalités locales avaient géré ces monuments après la chute du fascisme et ai publié un article pour une revue italienne sur le sujet.
En réalité, je n’ai jamais tellement abandonné l’histoire publique. J’ai donné cours deux années de suite à l’Université de Trieste sur l’histoire dans les médias. On a aussi organisé des visites guidées dans la ville. C’est intéressant, parce que les étudiants viennent de toute l’Italie et ont un regard original sur Trieste et sur la monumentalité fasciste. Cette ville, passée à l’Italie après la Grande Guerre, a été occupée administrée par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale et n’est redevenue officiellement italienne qu’en 1954. Le rapport au nationalisme et au fascisme est très particulier à Trieste. Pour les natifs, c’est le fascisme qui a permis à leur ville de devenir définitivement italienne. De 1918 à 1922, la ville est soumise à un gouvernement militaire, et c’est le fascisme qui a stabilisé la situation municipale. Il y a d’ailleurs dans la ville un musée du Risorgimento qui date de l’époque et qui va toujours dans ce sens.
B. V. : Avez-vous déjà quelques idées pour votre projet de documentaire ?
I. P-N. : Je me laisse encore le temps de la réflexion. Je me suis déjà un peu « auto-observée » face à ces monuments. J’ai essayé de comprendre comment j’interagissais avec eux. Puis j’ai commencé à regarder autour de moi les personnes qui regardaient ces monuments ; comment ils les regardaient, comment ils les percevaient, et les ai interrogés à ce sujet. Quand j’étais à Trieste, le documentaire était toujours présent dans un coin de ma tête. J’ai des idées, mais je vais d’abord en parler avec des producteurs, qui peuvent avoir une vision plus concrète des réalisations possibles.
L’exemple que je donne, car c’est un peu la forme que j’aimerais donner à mon futur film – une sorte de rêve – c’est le documentaire de Pasolini, Comizi d’amore (Enquête sur la sexualité, 1964). Le réalisateur avait parcouru toutes les plages italiennes en demandant aux gens leur rapport à l’amour, à la sexualité. Il contient une forme de spontanéité et j’aime beaucoup ça. Cela me semble d’autant plus nécessaire que le rapport à la monumentalité fasciste peut être complexe à appréhender dans le contexte politique italien actuel. Il y a encore aujourd’hui des pèlerinages sur la tombe de Mussolini, mais si dans ce cas, il ne s’agit pas d’un rapport spontané à la monumentalité. Ce qui m’intéresse, c’est plutôt de voir à quel point ces monuments sont encore présents dans les mentalités, dans l’espace public.
Dans le cadre de mon documentaire je voudrais observer si le fait de planter une caméra devant un monument attire l’attention ou non sur celui-ci, et si oui quelle serait la réaction des personnes ? Vont-ils reconnaître tout de suite le caractère fasciste de l’édifice, vont-ils oser le dire ? Que vont-ils en dire ? Trouveront-ils ça beau, ou remarqueront-ils une statue de Mussolini qui les fera hésiter ? C’est cette démarche que j’appelle spontanée. Je pense aussi utiliser des archives que j’ai étudiées pour ma thèse, comme par exemple les cérémonies d’inauguration des bâtiments pour faire une comparaison avec l’inscription contemporaine des monuments dans le paysage urbain.

B. V. : Avant de nous quitter j’aimerais que l’on s’arrête sur un autre de vos projets d’historienne publique : la Boîte à Histoire. Vous pourriez l’ouvrir pour nous et nous en révéler les secrets ?
I. P-N. : L’idée m’est venue avec Daphné Budasz et Romain Duplan, camarades du master d’histoire publique. À l’origine, on ambitionnait de proposer aux musées des cartels différents de ceux que l’on voit habituellement, d’ancrer davantage l’œuvre dans son contexte, de raconter son cheminement aussi, sortir d’une explication très axée sur l’histoire de l’art. On a présenté le projet au prix UPEC-BNP Paribas, que l’on a remporté. L’aide financière issue de ce prix nous a permis de créer une identité visuelle, le logo. On a aussi présenté le projet à une conférence internationale d’histoire publique à Ravenne en juin 2017, et participé à un incubateur éphémère, aux Beaux-arts de Paris.
Mais finalement, nous avons réorienté le projet dans l’idée d’organiser un festival transmédia, parce ce que ce qu’on aime c’est la rencontre entre le milieu universitaire et le public. On a créé un site internet qui permet d’entrer par de petites fictions dans chaque activité du festival. Notre première édition, en 2018, s’est appelée « Secousse ». On s’est appuyé sur la commémoration de l’année 1848. On a regroupé nos autres camarades du master pour multiplier et concentrer les compétences : l’un d’entre eux a réalisé un escape game.
La Boîte à Histoire existe toujours, avec des fluctuations qui sont liées à son caractère bénévole, car c’est extrêmement prenant. Il y a eu une seconde édition en 2019 ; on a fait une grosse pause en 2020, évidemment. En juin 2021, on a organisé un gros événement sur la Commune de Paris. En fait, depuis 2019, on répond surtout à des sollicitations. Après on a aussi notre vision de l’histoire, de la manière de la transmettre, donc dans peu de temps on va essayer de recommencer à proposer des sujets sur des thématiques qui nous tiennent à cœur.
En 2022 on a réalisé un très gros projet avec le Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, capitale européenne de la culture cette année-là. Le but était de raconter l’histoire de la ville du point de vue des habitants. C’était super : on a exploré des méthodes participatives avec des ateliers. Les ateliers qu’on organisait avaient deux objectifs. Le premier était de récolter des objets, dans le but d’organiser une exposition, et l’autre, de créer un site internet transposable dans l’espace urbain sur le passé et le présent des lieux, à travers des photos et des témoignages qu’on récoltait pendant les ateliers. Les témoignages étaient traduits, contexte plurilingue oblige. Un numéro de téléphone était placardé près de chaque lieu, qu’il était possible de composer pour entendre le témoignage qui lui était relié.
Je me souviens d’un atelier organisé avec la communauté italienne sur la thématique « objets » : une dame a apporté une peluche. Elle avait grandi en Italie et très tôt son père était parti au Luxembourg pour travailler. Il revenait avec des cadeaux ; dont cet ourson. Elle l’a gardé et l’a emporté avec elle quand elle est venue s’installer à son tour au Luxembourg. Sa migration a été contextualisée au cours de l’atelier et elle s’est rendu compte qu’elle n’avait pas été seule à vivre cette expérience. Son témoignage, fait en public, a pris une sorte de dimension thérapeutique. L’histoire mène sur des chemins parfois inattendus.

