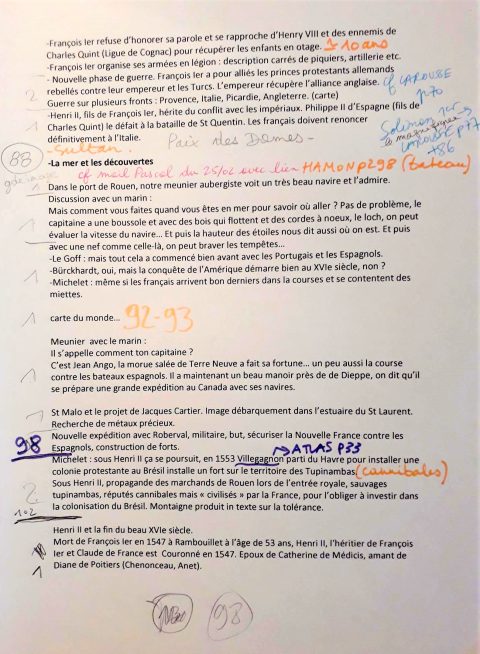Dessiner l'histoire de France : entretien avec Anne Simon, co-autrice de l'album En âge florissant. De la Renaissance à la Réforme
L’autrice Anne Simon revient avec Margot Renard sur la bande dessinée En âge florissant. De la Renaissance à la Réforme qu’elle a co-scénarisée avec l’historien Pascal Brioist, spécialiste de cette période. Paru en 2020 dans la collection l’« Histoire dessinée de la France » éditée par La Revue dessinée et La Découverte, cet album témoigne d’une rare expérience de collaboration entre une autrice et un historien professionnel. Il invite plus largement à une réflexion en actes sur l’écriture pédagogique et la mise en (non-)fiction de l’histoire par la bande dessinée.
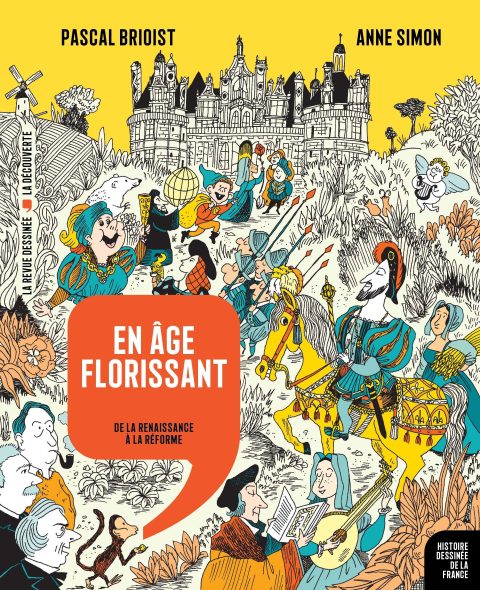
Margot Renard : Vous avez travaillé en 2019 et 2020 à la création, avec l’historien Pascal Brioist, d’une bande dessinée historique intitulée En âge florissant. De la Renaissance à la Réforme (Fig. 1). Aviez-vous déjà travaillé sur ce type de projet à visée pédagogique ?
Anne Simon : Il est arrivé plusieurs fois que l’on vienne me chercher pour des projets pédagogiques de ce type. Les éditeurs ont tendance à penser qu’aborder un sujet complexe en BD permettra à tout le monde de le comprendre. Ce n’est pas aussi simple. Je pense que La Revue dessinée a fait bouger les choses sur ce terrain il y a quelques années. A côté de ce type de projet, j’ai un travail d’autrice complète. Je fais mes textes et mes dessins, dans des bandes dessinées de fiction publiées par un petit éditeur qui s’appelle Misma. Après, pour élargir mon champ de vision, j’ai fait trois biographies dessinées en duo avec Corinne Maier, sur Freud, Marx et Einstein[1]. J’ai aussi adapté en bande dessinée la thèse Encaisser ! de la sociologue Marlène Benquet, chez Casterman[2]. Concernant l’« Histoire dessinée de la France », le projet n’est pas toujours évident, d’une part il faut trouver un bon tandem. Travailler avec quelqu’un qui n’est pas scénariste de bande dessinée professionnel nécessite de faire confiance à l’autrice ou à l’auteur des dessins. D’autre part, rester très juste historiquement et créer une fiction de toute pièce, qui permette de faire passer des idées, est assez compliqué. On peut vite tomber dans quelque chose de trop pédagogique. Mettre ensemble un auteur ou une autrice et un historien ou une historienne est en réalité un mariage forcé, il n’est pas sûr à 100 % que ça puisse fonctionner. Avec Pascal Brioist, en l’occurrence, ça s’est très bien passé, on s’est bien entendus. Je pense que lui a été assez ouvert pour lâcher un peu de lest, parce que c’est quelqu’un de pointu, et j’avais aussi ma liberté dans le dessin. Le récit se passe à la Renaissance, j’étais d’accord avec la consigne imposant de respecter les faits historiques, mais je voulais quand même avoir une petite marge de manœuvre du côté de la fiction.
M. R. : Comment votre collaboration a-t-elle fonctionné ? Quels sont les points qui auraient pu poser des difficultés ?
A. S. : C’est un très gros travail pour le dessinateur comme pour l’historien. Il faut produire plus de cent pages. À la fin, l’historien.ne doit écrire un dossier théorique et technique. Pascal y a mis les éléments qu’on ne pouvait pas raconter en BD. Ça n’est pas forcément le dessin qui m’a pris le plus de temps, c’est toute la documentation qu’il a fallu constituer avant. Une fois que le storyboard et le scénario sont faits, je me mets en pilote automatique et je dessine. Nous disons souvent que nous sommes dessinatrices ou dessinateurs, mais nous sommes réellement des auteurs complets. En général, les historiens n’ont jamais fait de BD non plus. Ils connaissent très bien leur sujet, mais pour autant cela ne signifie pas qu’ils savent produire des dialogues, créer une histoire. On a fait énormément de réunions avec Pascal où j’allais chez lui des après-midis entiers. Sa bibliothèque était très pratique. Il faut énormément de temps et de disponibilité. Pascal fut à l’écoute et disponible pour toutes mes questions.
M. R. : Est-ce que ce type de collaboration égalitaire, où chacun est co-scénariste à part égale, est le plus fréquent ? Les statuts différent en fonction des collections. Je pense notamment à une collection comme « Ils ont fait la France », où l’historien.ne est expert.e consultant.e, mais pas toujours co-scénariste. Souvent, les scénaristes, historiens et dessinateurs ne se rencontrent pas, ils travaillent par mails, à distance. C’est un type de collaboration très différent.
A. S. : J’ai fait un peu d’illustration jeunesse et dans ce cadre on ne rencontre pas l’auteur du texte qu’on nous donne, à la fois parce le temps manque et parce qu’on utilise Internet, en effet. Il est certain que pour l’« Histoire dessinée » il faut un réel échange. C’est un travail qui demande plus d’un an et il est impossible à réaliser si on ne s’entend pas. On a fait notre album en même temps que Pochep et Jérémie Foa[3], ce qui nous a permis, avec Pochep, de se soutenir entre dessinateurs, cela d’autant plus que nos livres sont ancrés dans le confinement lié à l’épidémie de Covid. Je sais que ça s’est aussi très bien passé entre Pochep et son historien. À un moment donné, Pascal et moi ne pouvions plus nous voir, uniquement s’appeler. Heureusement, tout le travail de documentation en amont avait déjà été fait. En fait, c’est une partie de ping-pong. L’historien ne peut pas se contenter de donner ses références puis de considérer que le dessinateur doit se débrouiller. Pascal et moi sommes allés visiter le musée du Louvre, par exemple. Pascal est un personnage, il est tellement dans la Renaissance qu’il en fait des reconstitutions. En plein milieu du Louvre, il s’est mis à me chanter des chansons d’époque ! C’est un peu comme les profs d’histoire de notre enfance, ceux qui nous tiennent en haleine – ou pas ! Pascal raconte beaucoup d’histoires, ce qui m’a aidé à construire mon scénario. Mais parfois j’avais tellement d’infos que j’avais une matière énorme.
M. R. : Qu’est-ce qui vous a intéressée dans ce projet sur l’histoire de la Renaissance ?
A. S. : Pour ma part, j’étais loin d’être spécialiste. La Renaissance est une période qui m’intéressait beaucoup, mais je connaissais davantage son versant italien. Je trouvais intéressant de l’aborder sous l’angle français. Quand La Revue dessinée m’a proposé de participer à cette collection, j’ai accepté en donnant mes conditions. J’avais notamment dit à Sylvain Ricard et à Sylvain Venayre, les directeurs, que je détestais dessiner des batailles, donc je ne voulais ni Napoléon, ni l’époque contemporaine. J’ai trouvé des astuces à ce sujet. Par exemple, concernant la bataille de Marignan, j’ai simplement produit une grande image d’un tombeau à Saint-Denis. Et Pascal m’avait précisé qu’à cette époque-là, les soldats ne portaient pas d’uniforme lors des combats. Ça m’allait bien parce qu’au niveau du dessin je pouvais me permettre d’être plus libre.
M. R. : Vous aviez finalement accès à beaucoup de données, d’informations, d’images, qui stimulaient votre imaginaire.
A. S. : C’est bien plus stimulant que de faire de simples recherches sur Google ! Parfois je lançais des petits défis à Pascal. Par exemple – je dis n’importe quoi – j’ai une cafetière à dessiner, comment pouvait-elle être à la Renaissance ? Ça l’intéressait énormément et il cherchait dans tous ses livres pour me trouver exactement la bonne cafetière, ou la bonne poignée de porte. Comme Pascal savait que j’aimais bien dessiner les animaux, il avait trouvé une sorte de fresque avec des prunes et des petits singes. Je l’ai utilisée pour la chronologie à la fin du livre (Fig. 2 et 2 bis). Il m’avait aussi prêté un ouvrage sur Jacques Cartier qui racontait une anecdote : quand il était arrivé au Québec, il avait vu des ours tellement vieux qu’ils étaient tout blancs. C’est très amusant, je me suis dit que j’allais le ressortir. Plus on a de matière, plus on a de quoi se nourrir, donc donner davantage au lecteur ou à la lectrice.
M. R. : Quel était votre rapport préalable à l’histoire, en tant qu’imaginaire et en tant que discipline scientifique ?
A. S. : Je m’intéresse à l’histoire, j’aime bien écouter des podcasts et des émissions de radio. En revanche, j’ai du mal à tout remettre dans l’ordre. Je ne peux pas restituer les dates de règne de tel ou tel roi. Je m’inspire constamment de l’histoire, comme dans ma série Les Contes du Marylène[4], tout en me cachant derrière la fiction. J’ai toujours aimé l’art du portrait. Il permet de se plonger dans une époque. Quand j’ai fait mes biographies dessinées, j’ai travaillé sur la photographie. On a assez peu de documents sur Marx, alors qu’il y en a beaucoup sur Freud et sur Einstein. Mais en dépit des témoignages, des photos, des tableaux, on ne pourra jamais tout savoir. Si Freud avait un pyjama à rayures, à pois, s’il dormait en caleçon…! En cela aussi la BD historique est intéressante : on n’est jamais juste à 100%. Je pense que le but du jeu est d’encourager le lecteur à aller plus loin. Quand on fait une bande-dessinée de cinquante pages sur Freud, on n’a pas du tout la prétention de rédiger une thèse. Il faut faire ce qu’on peut sans trop élucider, savoir lâcher prise et se dire qu’on ne pourra pas tout raconter.
M. R. : Pouvez-vous retracer les premières étapes de votre sollicitation par les éditeurs de l’« Histoire dessinée de la France » et de votre collaboration avec votre binôme sur l’album ?
A. S. : Pour être honnête, une autrice de bande-dessinée doit avoir des travaux de commande pour gagner sa vie. J’avais déjà travaillé pour La Revue dessinée, je m’étais bien entendue avec eux. Ils m’ont sollicitée au lancement de la collection, pour savoir si j’étais partante sur le principe, sans qu’un album déterminé me soit encore attribué. J’ai donc dit « pas Napoléon, ni Catherine de Médicis », parce que j’avais déjà travaillé sur elle. Les éditeurs m’ont donc attribué l’album sur la Renaissance. L’étape suivante a été la première rencontre avec l’historien, pour voir si ça fonctionnait. J’étais intimidée, au départ, d’être face à des historiens professionnels, j’avais peur de ne pas être au niveau. J’ai montré mon travail à Pascal, qui a apprécié mes dessins. On se nourrissait l’un et l’autre, c’était amusant de voir ce duo se lier. Ça m’a permis de me détendre un peu. C’était un challenge et j’ai réussi, en me disant que je n’étais pas plus bête qu’une autre !
M. R. : Et ensuite, une fois que vous avez validé votre duo ?
A. S. : Ensuite, on a fait la visite du Louvre. Là, on est rentré dans le vif du sujet. J’ai rempli des carnets entiers d’informations. Puis un laps de temps s’est écoulé, j’avais des projets à finir de mon côté et Pascal était très pris par les célébrations de l’anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Entre la visite du Louvre et le moment où on s’y est réellement mis, une petite année s’est écoulée. Mais j’avais toujours le livre en tête. Je suis allée à Écouen visiter le musée de la Renaissance, j’ai amassé de la documentation pendant des mois et des mois. Quand on s’est revus, on a tenté d’organiser notre travail. Personnellement, j’aime bien travailler par chapitres, par thèmes. Il fallait hiérarchiser les éléments importants et les éléments secondaires, ce qu’on gardait plutôt pour le dossier de la fin. On n’a pas eu la place d’aborder un certain nombre de thèmes, comme la place des femmes.
Une fois nos thèmes choisis, il nous fallait des personnages principaux. On ne voulait pas tout axer sur François Ier, par exemple, même s’il devait être là. Il fallait aussi trouver une manière de parler de ce phénomène de « Re-naissance ». On a eu l’idée de faire dialoguer trois historiens, Burckhardt, Michelet, et un troisième qui devait s’opposer à eux. Pascal a alors pensé à Patrick Boucheron, mais ce dernier a refusé. C’est donc Le Goff qui est apparu. C’est judicieux parce qu’il considère qu’il ne faut pas découper l’histoire en tranches[5]. Même si on est obligés de séparer l’histoire par périodes, ça ne fonctionne pas bien concernant la fin du Moyen-Âge. Il était intéressant de questionner le terme Renaissance avec un grand « R » et ce qu’il signifie réellement. Les trois historiens étaient donc notre fil conducteur pour pouvoir mettre en scène des idées, des contradictions. En parallèle, on a développé l’histoire d’un meunier dont on suit chronologiquement la vie durant plusieurs années, même si j’ai pris quelques libertés (Fig. 3). Il fallait le faire vieillir, mais historiquement c’était compliqué.

Une fois ces choix faits, on a commencé à écrire les grandes lignes de notre scénario. Pascal écrivait sur son ordinateur, j’étais à côté. Ensuite il m’envoyait nos notes. On passait une après-midi sur chaque thème. J’essayais de proposer un découpage, d’estimer un nombre de pages par chapitre (Fig. 4 et Fig. 5). Au regard du format, je savais que ça nécessitait entre huit et douze cases. C’est une petite cuisine propre à chaque dessinateur.trice. Pour ma part, au début c’est le bazar, et tout à coup je tire sur un fil et tout devient plus clair.
À ce moment-là, je passe au storyboard. Ce sont des dessins très rapides, je les fait sur ordinateur pour aller plus vite. J’y note les pages et les références de toute la documentation réunie. Une fois le storyboard terminé, quelques cent pages, ce sont les directeurs de collection qui valident ou non. À ce stade, ils nous ont demandé très peu de corrections, des détails. J’avais dessiné un château avec des ailes en retour alors qu’elles n’existaient pas encore à l’époque, pareil pour les jardins. À l’étape suivante, j’ai redessiné à la plume et à l’encre, puis j’ai fait la couleur sur Photoshop, avec Cécily de Villepoix qui m’a aidée à la fin. Voilà donc les étapes : grosse documentation, idées dans tous les sens, on essaie de faire un chemin de fer, un plan, puis on détaille davantage le scénario et je le découpe. Les dialogues ont été faits à deux.
M. R. : Vous vous êtes inspirés des albums précédents de la collection pour votre travail ?
A. S. : Oui, mais les albums sont tous différents, c’est la force de cette collection. J’ai choisi de ne pas mettre de personnage qui nous serait contemporain, à la différence de certains auteurs. J’ai plutôt fait parler les animaux, les perroquets. J’ai développé des personnages secondaires pour donner plus de vie à mon récit. Et Pascal m’avait dit ce qui lui avait plu dans certains volumes, ça nous permettait d’y voir plus clair.
M. R. : Plusieurs auteurs ont, comme vous, choisi des personnages d’historiens pour introduire le récit historique et le débat historiographique sur la période traitée. N’était-ce pas risqué ? D’autres ont choisi des options différentes, comme Valérie Theis, Étienne Anheim et Sophie Guerrive pour À la vie, à la mort, qui ont choisi le personnage de la Mort.
A. S. : Oui, l’idée était très bonne. On s’est posé la question de savoir si c’était une solution de facilité ou un écueil scénaristique, mais à la réflexion il fallait vraiment mettre en scène ces historiens. Je ne voulais pas nous mettre personnellement en scène, montrer la discussion entre l’historien et le dessinateur[6]. Ça peut être intéressant, mais je ne me sentais pas à l’aise pour ça, ni pour faire des clins d’œil à l’époque contemporaine. Sylvain Ricard m’avait dit que je pouvais tenter des choses amusantes, comme un Top Chef de la Renaissance, mais ce n’est pas du tout mon truc ! Dans Sacrées guerres, ils ont refait le tournage du film La Reine Margot, c’est vraiment bien. Faire parler des acteurs leur a permis beaucoup de choses.
M. R. : Pour vous, quel a été l’apport professionnel et/ou personnel de ce projet ?
A. S. : J’ai fait tout l’encrage pendant le premier confinement, et malheureusement l’album est sorti lors du deuxième confinement, en novembre 2020. C’est dommage car il n’a pas tellement vécu, on n’a pas fait de séance de dédicaces, ni de rencontres en librairies. On a énormément travaillé pour un livre finalement peu visible. Mais cette collection est suivie, je le vois chez les libraires. Elle est aussi beaucoup en CDI, en bibliothèque, en médiathèque, dans des librairies de musées, de châteaux. Malgré toutes ces difficultés, Pascal et moi nous sommes dit qu’un jour, on pourrait travailler de nouveau ensemble. Du côté de mon travail personnel, je pense que ça a fait évoluer mon dessin, comme chaque fois qu’il faut sortir de ma zone de confort, me lancer dans un projet dont je connais peu de choses. Ça m’a fait évoluer en tant qu’autrice.
M. R. : Vous avez une forte perspective féministe dans votre travail. N’avez-vous pas regretté de ne pas avoir davantage traité l’histoire des femmes dans votre album ?
A. S. : Je n’avais pas envie qu’on axe sur ce sujet, comme si on répondait à un effet de mode. Quand j’ai sorti La Geste d’Aglaé chez Misma en 2012, le côté féministe de ce livre est passé complètement inaperçu. Aujourd’hui, les mentalités ont changé, même si rien n’est encore gagné. Ce qui arrive en ce moment est génial, on voit apparaître dans les librairies des rayons entiers de bandes dessinées féministes. Mais certains ont aussi tendance à surfer sur la vague, et c’est agaçant. Cela dit, dans En âge florissant, je parle tout de même des femmes. Marguerite, la sœur de François Ier, est un personnage fort (Fig. 6). Elles sont secondaires mais toujours là. La situation des femmes n’était pas formidable à la Renaissance… Je pense qu’il aurait fallu un livre entier pour en parler. On avait discuté des sorcières, mais il y avait un tel phénomène autour de ce sujet qu’on ne voulait pas le récupérer au vol. En revanche, je n’aurais jamais accepté qu’il y ait des remarques sexistes dans mon livre. Récemment, j’ai fait une bande-dessinée sur les Béguines pour La Déferlante, une revue féministe[7]. Pour chaque numéro, carte blanche est donnée à une autrice, plus rarement à un auteur de bande dessinée. Encore une fois, j’ai dû m’inspirer de faits réels pour créer une fiction et choisir sous quel angle historique j’allais raconter les choses.

M. R. : Peu d’autrices de bande dessinée et d’historiennes ont produit un album pour l’« Histoire dessinée de la France ». Cette disparité reflète une réalité concernant la bande dessinée historique, produite et valorisée à une large majorité par des hommes. Comment avez-vous vécu la collaboration avec un historien ?
A. S. : Ç’a été une bonne surprise. En général je ne travaille qu’avec des femmes. En duo, je suis nettement plus à l’aise avec elles, car le risque demeure toujours de se faire embêter par un homme, comme c’est le cas dans beaucoup de milieux. Sylvain Ricard m’avait dit de Pascal qu’il était vraiment l’historien dans toute sa splendeur, hyper calé sur son sujet. Au départ, je me suis dit que ça n’allait pas marcher. Il s’avère que Pascal a été très à l’écoute. Globalement, la bande dessinée est un milieu très machiste, un milieu d’hommes[8]. J’espère qu’on arrêtera de pointer du doigt le fait qu’il y ait de plus en plus de femmes. C’est tellement long… Pendant longtemps, on nous disait qu’on ne savait pas où trouver les femmes dans la bande dessinée. Pourtant, celles de ma génération sont très nombreuses : Aude Picault, Delphine Panique, Catherine Meurisse, Emilie Plateau, Sandrine Martin, Lisa Mandel, Anouk Ricard, Nine Antico, Florence Dupré-Latour… Je m’arrête là mais la liste est longue. Elles ont toutes un travail remarquable et engagé. En 2016, le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme a été créé à la suite d’une vive polémique sur l’invisibilisation des femmes au Festival d’Angoulême. Cette année, le FIBD a encore mis les pieds dans le plat en programmant une exposition de l’auteur Bastien Vivès alors même que Julie Doucet, artiste féministe majeure, était mise à l’honneur. Tout cela a découlé à la création du hashtag #MeTooBD.
Cependant, concernant l’« Histoire dessinée de la France », il est aussi possible que certaines refusent ce type de projet. Quand je vous disais qu’au début je n’étais pas sûre de moi, que j’étais intimidée d’avoir affaire à des historiens professionnels, c’est qu’il est bien connu que les femmes ont tendance à se dévaloriser. Héloïse Chochois a déjà fait plusieurs bandes dessinées de vulgarisation, Marion Montaigne fait les siennes, mais seule. La collection de sociologie Sociorama compte un certain nombre d’autrices, mais la collection elle-même est faite par des femmes, la dessinatrice Lisa Mandel et la sociologue Yasmine Bouagga. Mais je pense que la sociologie c’est autre chose, c’est assez différent de l’histoire. Il doit y avoir un parallèle entre le milieu des historiens et le milieu de la bande dessinée. Circule encore la caricature du vieux mec qui dessine des femmes à grosse poitrine, et l’idée selon laquelle seuls les hommes lisent de la BD. À mon avis, ce qui a changé, c’est qu’il y a plus de lectrices adultes. J’ai un lectorat plus féminin et je trouve qu’il est meilleur. Elles s’intéressent plus, non pas à des récits intimistes parce que je n’ai pas envie qu’on dise que tout ce qui est domestique et privé les concerne au premier chef, mais elles s’intéressent à d’autres choses. L’autre problème de la bande dessinée est d’être longtemps restée cantonnée à la catégorie « livre pour enfant ». Pendant un certain temps les femmes ont fait de l’illustration jeunesse, et elles étaient dévalorisées pour cela. Je vois que ça évolue, mais encore trop lentement. Mon époque était celle de Pénélope Bagieu, où est apparu ce terme horrible de « BD girly ». Sur Instagram, maintenant, je vois un tas d’autrices qui sont sans filtre, et Pénélope Bagieu a justement montré avec ses Culottées qu’elle pouvait parler de l’histoire de femmes engagées à un large public, très loin de cette « BD pour filles sans cervelle » à laquelle on voulait la cantonner.
M. R. : Dans votre album, y a-t-il des éléments que vous auriez faits différemment, en y réfléchissant a posteriori ?
A. S. : Pour moi, ce livre sur le Renaissance reste bridé, et c’est normal. Nous n’avons pas discuté de l’écriture, mais c’est très difficile de trouver des dialogues qui soient justes, qui paraissent naturels, tout en faisant passer des informations théoriques. Et je trouve que ce qu’on a fait est encore trop didactique, mais nous n’avions pas vraiment le choix. La bande dessinée historique est faite pour se détendre mais aussi pour apprendre.
—
[1] Anne Simon, Corinne Maier, Freud, Paris, Dargaud, 2011 ; Anne Simon, Corinne Maier, Marx, Paris, Dargaud, 2013 ; Anne Simon, Corinne Maier, Einstein, Paris, Dargaud, 2015.
[2] Anne Simon, Marlène Benquet, Encaisser !, Paris, Casterman, coll. Sociorama, 2016.
[3] Pochep, Jérémie Foa, Sacrées guerres, de Catherine de Médicis à Henri IV, Paris, La Découverte / La revue dessinée, 2020.
[4] Anne Simon, Les contes du Marylène, 5 vol., Le Fauga, Misma, 2012-2022.
[5] Jacques Le Goff, Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches ?, Paris, Seuil, 2014.
[6] Choix narratif effectué, par exemple, par Nicoby et Jean-Louis pour L’enquête gauloise, de Massilia à Jules César, Paris, La Découverte/La revue dessinée, 2017.
[7] Anne Simon, « Ni nonnes ni épouses, laisse vivre les Béguines », La Déferlante, n° 8, novembre 2022.
[8] En 2016, les autrices de bande dessinée représentaient 27% du nombre total d’auteurs recensés en France, selon l’Enquête sur la situation des auteurs 2016 des États-Généraux de la Bande dessinée la même année. Leur nombre augmente au fil des années. On peut consulter le rapport sur http://www.etatsgenerauxbd.org/.