"Archive vivante" : usages artistiques et renouvellement du statut de l’archive
Créer avec et autour de l'archive, pour l'animer et la faire agir autrement. Depuis plusieurs années, l'archive est au centre de nombreuses réflexions et performances dans le monde de l'art. Isabelle Barbéris, organisatrice du colloque Archive vivante en 2012 revient sur cette histoire : histoire d'une mise en scène, d'une incarnation et d'un changement de statut.

Dans le monde de l’art, la notion d’archive a connu, depuis une vingtaine d’années, un déplacement de statut décisif. Elle n’est plus seulement l’objet d’un savoir historique ou archivistique, ni même la simple matière première d’une enquête scientifique : elle est devenue le lieu d’une requalification qui engage l’épistémologie des sciences humaines autant que les pratiques artistiques contemporaines. L’archive n’apparaît plus comme un dépôt inerte, mais comme un champ de tensions et de réinventions, travaillé par des usages multiples et hétérogènes.
Un moment important de ce tournant a été le colloque Archive vivante, organisé à l’université Paris-Diderot les 25 et 26 octobre 2012, dont les actes ont été publiés en 2015 aux Presses universitaires de Rennes sous le titre L’Archive dans les arts vivants. Performance, danse, théâtre. Cet événement a marqué une étape : il y fut question de la performativité de l’archive, de sa subjectivité et de sa capacité à être rejouée ou réactivée dans le présent. En inventant le vocable d’inspiration derridienne « archive vivante », le colloque invitait à s’emparer différemment de l’archive, davantage considérée comme un matériau et un processus que comme une « brique » intangible de savoir.
Mon retour sur cette expérience insiste sur la conférence-performée Autoarchive de Latifa Laâbissi et sur les prolongements que la formule « archive vivante » a connus depuis lors. Dans un second temps, je présenterai trois exemples de reformulation des enjeux archivistiques dans la continuité de cette entreprise qui date de bientôt quinze années.
Le colloque « Archive vivante » (2012) : retour sur une expérience
Point de départ symbolique de ce tournant, le colloque international « Archive vivante » (Université Paris-Diderot, 2012), dont les actes furent publiés aux Presses universitaires de Rennes sous le titre L’Archive dans les arts vivants (2017), marqua un infléchissement théorique notable. On y mobilisait la notion de « vivance », empruntée à la philosophe bergsonienne et derridienne Susanne Guerlac (Thinking in Time: An Introduction to Henri Bergson, 2006). Guerlac relisait Bergson pour montrer que la durée n’est pas seulement succession mais simultanéité de couches temporelles, un tissu vivant où passé et présent interagissent. Cette conception élargie de la temporalité nous permettait de penser l’archive non comme dépôt mort mais comme foyer de dynamiques temporelles, toujours susceptibles d’activation et de résonances. Loin de se réduire à un stock, l’archive devait être comprise comme champ de forces où se jouait l’articulation entre mémoire, historicité et invention. Cette perspective rencontrait les travaux d’Alfred Gell sur l’« agentivité » des objets (Art and Agency, 1998), et prolongeait les analyses de Jacques Derrida (Mal d’archive, 1995) sur la hantise et l’instabilité constitutives de toute trace.
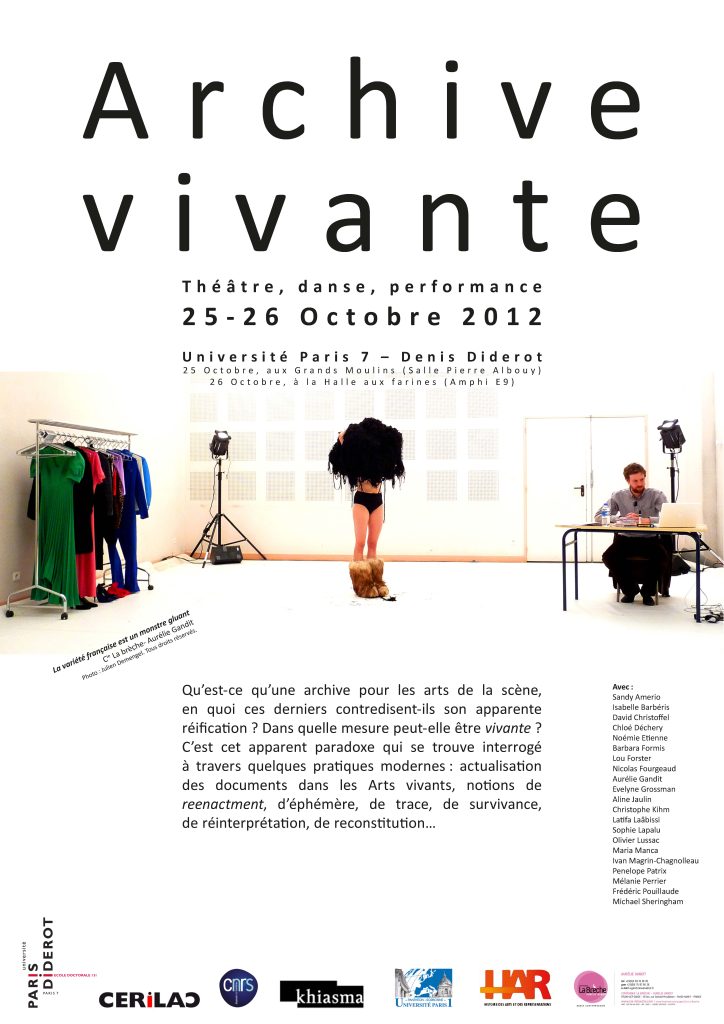
Le colloque proposait de mettre en relation études théoriques et pratiques scéniques autour de l’archive dans les arts vivants – théâtre, danse, performance – en déplaçant la conception de l’archive d’un objet fixiste vers une dynamique d’activation, de subjectivation et de performativité. L’intitulé « archive vivante » signalait d’emblée une reconfiguration épistémologique : l’archive n’était plus seulement l’enregistrement d’une preuve, elle devenait un opérateur de présentification, rejouée, réénoncée, potentiellement productrice de savoirs situés.
Le programme interdisciplinaire atteste de la place attribuée aux gestes performatifs. On y trouvait, entre autres, des interventions de Christophe Kihm (« À propos des Archives sauvages »), Noémie Étienne (« Des objets vivants ? »), Michael Sheringham (« L’archive vivante de Pierre Rivière : Foucault, Allio, Philibert »), ainsi qu’une conférence-performance de Latifa Laâbissi, intitulée Autoarchive, qui joua un rôle charnière : l’archive y était appréhendée comme processus incorporé et subjectif, un « auto-archivage » qui exposait les conditions mêmes de sa constitution. Cette perspective – que l’on retrouve explicitée dans l’introduction du volume des actes que j’ai ensuite dirigés – faisait de l’auto-archive un exercice de retour sur soi, mais surtout une opération performative : l’archive comme acte, non simple trace. Elle ouvre dès lors sur de multiples formes de reenactment, de reprise et de circulation dans lesquelles les matériaux mémoriels ou documentaires se trouvent rejoués, et resémantisés par le corps et la scène.
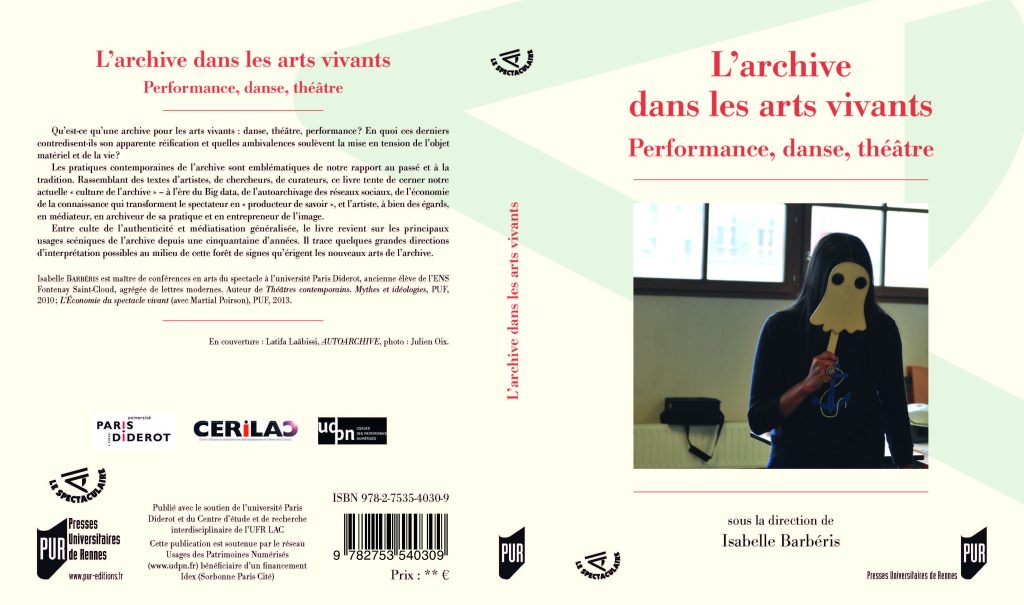
Ce repositionnement opéré en 2012 a eu des prolongements notables. À court terme, il a irrigué les cycles et séminaires adossés au projet « Spectacle en ligne(s) » du CERILAC (Centre d’études et de recherches interdisciplinaires Lettres Arts Cinéma) et de l’IRI (Institut de recherche et d’innovation), qui se closent en 2014 par une réflexion explicite sur « l’archive vivante ». Plus largement, la terminologie et les problématiques ont essaimé dans des manifestations et publications ultérieures : journées d’étude « La performance. Vie de l’archive et actualité » (2018), où l’on trouvait par exemple une intervention sur « le spectateur comme archive vivante » ; colloque « L’archive comme lieu d’expérimentation » (Lyon 3, 2022), parlant de « produire des archives vivantes et actualisables » et de l’archive comme « dispositif performatif » ; occurrences dans des contextes connexes (muséologie, histoire littéraire, études filmiques, archéologie) où l’expression « archive vivante » est mobilisée pour désigner des ensembles documentaires actifs ou des pratiques de réactivation. Cette diffusion atteste qu’Archive vivante n’a pas été un événement isolé, mais un point d’inflexion dans la manière d’articuler mémoire, document et scène. Ce retentissement interdisciplinaire souligne la fécondité de la notion d’archive comme champ de forces : activation, circulation, subjectivation, performativité.
Déplacements théoriques
Développement des usages artistiques de l’archive
L’intérêt artistique pour l’archive ne date pas des années 2000 : il prend racine dès l’après-guerre. Le mouvement Fluxus, initié par George Maciunas dans les années 1960, intégrait déjà des fragments documentaires et des instructions performatives comme autant d’archives à activer. Les cartographies de Maciunas s’éloignaient de la définition fixiste du stock de connaissances pour proposer des itinéraires dynamiques où chaque brique épistémique fonctionnait déjà à la fois comme fragment et « hypertexte ». Dans le champ théâtral, le théâtre documentaire apparu dans les années 1960 (Peter Weiss, Die Ermittlung, 1965) s’appuyait sur des transcriptions de procès, en écho au développement des sciences humaines et sociales et à l’influence de l’École des Annales, qui avait élargi l’histoire à l’étude des mentalités et des traces ordinaires.
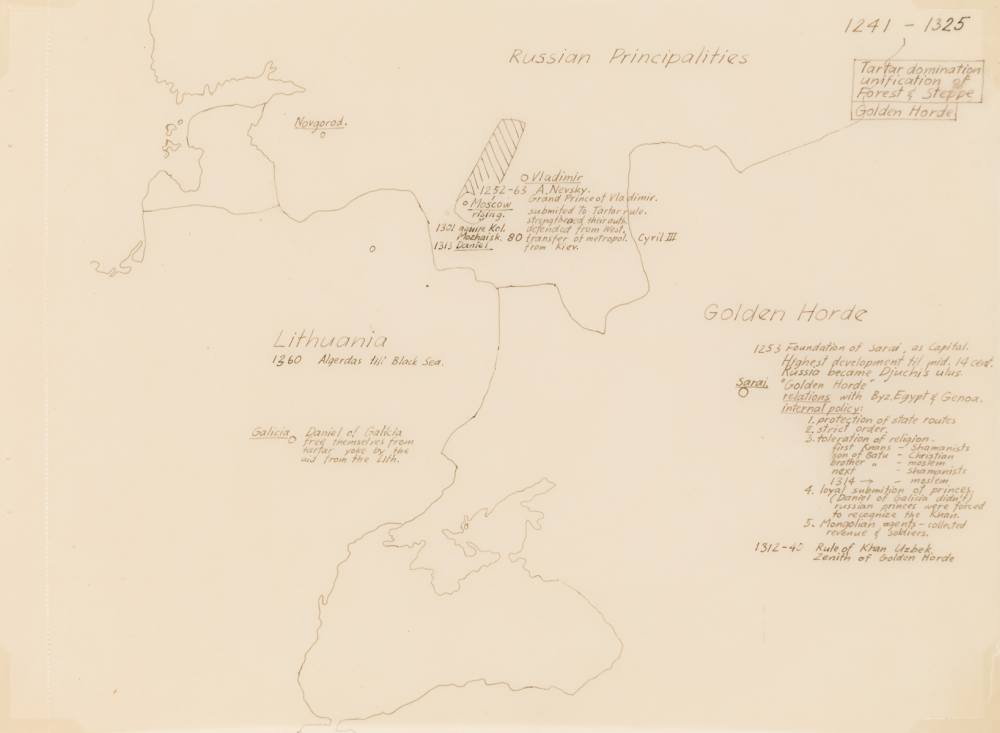
Les décennies récentes ont connu un véritable « tournant documentaire » (Eyal Weizman, Forensics Architecture: Violence at the Threshold of Detectability, 2019) affectant aussi bien les arts plastiques que la performance. Le tournant documentaire désigne, à partir des années 1990, un mouvement transversal dans les arts (théâtre, arts visuels, cinéma, littérature, performance) marqué par un retour au réel et l’usage de matériaux factuels – témoignages, archives, enquêtes, récits de vie – dans une visée à la fois esthétique et critique. Il traduit une remise en cause des fictions closes et une volonté de réarticuler l’art et le monde social, souvent en réponse à la crise de la représentation et à la perte de confiance dans les grands récits.
Ce tournant se manifeste par une volonté de puiser dans les documents, images et traces du passé pour nourrir des démarches esthétiques qui interrogent mémoire, histoire et vérité. L’exposition Archive Fever (International Center of Photography, New York, 2008), conçue par Okwui Enwezor, fut à ce titre emblématique. Elle montrait comment la photographie d’archive pouvait devenir matériau créatif et critique : chez Christian Boltanski (Réserve : les Suisses morts, 1990), des portraits anonymes collectés dans les nécrologies deviennent des monuments fragiles à une mémoire collective anonyme ; chez Walid Raad (Atlas Group, 1999-2004), de faux documents photographiques et carnets mettent en crise notre rapport à la véracité des archives de la guerre civile libanaise. Ces deux démarches révèlent, l’une par excès de fragilité, l’autre par feinte fictionnelle, que l’archive est aussi un dispositif de croyance.
Un autre courant est le « tournant éducatif » (Jacques Rancière, Le maître ignorant, 2008 ; Carmen Mörsch, Kunstvermittlung 2, 2009), qui fait de l’archive un support de transmission et de médiation. L’artiste brésilienne Rosângela Rennó, dans Vulgo [Alias] (1998), reconstitue des portraits de prisonniers en collectant des photographies judiciaires et en les anonymisant, invitant le spectateur à recomposer une mémoire collective de la marginalité. Le dispositif engage le public à se confronter à l’injustice de l’effacement mémoriel, tout en produisant ses propres récits.
Pour de nombreux artistes, l’archive est à la fois auctoritas – garante symbolique d’une légitimité historique – et matériau à déconstruire. Elle permet de court-circuiter la linéarité historique, de contester les grands récits et de proposer des histoires alternatives, fragmentées ou subjectives. Jeremy Deller, dans The Battle of Orgreave (2001), rejoue avec des centaines de figurants et d’anciens mineurs la grève de 1984 en Grande-Bretagne, dont l’affrontement violent entre mineurs et police reste un traumatisme. Le spectacle oscillait entre commémoration, performance et documentaire télévisuel, et soulevait des questions sur la mémoire collective, sa réécriture et sa spectacularisation. Milo Rau, dans Five Easy Pieces (2016), interroge les archives judiciaires et médiatiques de l’affaire Dutroux en confiant à des enfants-acteurs la tâche de rejouer ces crimes. L’entreprise suscita des critiques vives : exploitation choquante des enfants, esthétisation du sordide, confusion revendiquée entre recherche et création. Comme l’a noté Carole Talon-Hugon (L’artiste en habits de chercheur, 2021), ce type de dispositif illustre les potentielles dérives de l’hybridation archivistique lorsqu’elle instrumentalise des traces pour légitimer une posture d’artiste-théoricien sans toujours produire de véritable connaissance.
Ces usages post-modernes ont contribué à déstabiliser le statut véridictionnel de l’archive depuis le monde de l’art. Considérée naguère comme preuve objective, elle se mêle désormais à la subjectivité de l’artiste, qui l’utilise pour légitimer sa démarche. L’archive cesse d’être une source transcendante : elle devient flux, horizontalité, matériau plastique, indistinct du reste des images circulantes.
L’archive exposée, actrice et personnage
Au-delà de sa fonction documentaire, l’archive se trouve souvent « exposée » pour elle-même, dans son opacité ou sa résistance à l’interprétation. Son agentivité propre fascine : l’archive agit, interpelle, trouble. Certaines œuvres mettent en scène cette puissance autonome : Heiner Goebbels, dans Stifters Dinge (2007), mobilisait des archives sonores et visuelles sans aucun acteur sur scène ; les documents deviennent personnages à part entière, producteurs de présence.
Cette fascination entraîne parfois une fétichisation. Walid Raad a travaillé sur de faux documents de la guerre civile libanaise : carnets fictifs, photographies inventées mais présentées comme authentiques. Joan Fontcuberta, avec Fauna(1987) ou Sputnik (1997), a fabriqué de fausses archives scientifiques et spatiales, révélant combien la croyance attachée à l’archive repose sur le dispositif de monstration. Ces canulars, entre ironie et critique institutionnelle, dévoilent le pouvoir de l’archive de construire des mondes imaginaires.
Dans un monde saturé d’images et traversé par l’angoisse de l’effacement mémoriel (Andreas Huyssen, Present Pasts. Urban Palimpsests and the Politics of Memory, 2003), l’archive apparaît comme relique. Christian Boltanski a multiplié les dispositifs où les archives anonymes deviennent reliques fragiles, entre mémoire collective et oubli (Personnes,Monumenta, Grand Palais, 2010). Thomas Hirschhorn, dans Touching Reality (2012), propose une vidéo où une main féminine manipule sur une tablette des photographies d’atrocités de guerre trouvées en ligne. Le geste répétitif – zoomer, effleurer, déplacer – transforme ces images insoutenables en matière manipulable, révélant à la fois notre consommation anesthésiée des images d’archives numériques et l’ambiguïté entre voyeurisme et compassion. L’archive devient spectacle, à la limite du fétiche.
Dématérialisation, circulation et fragilisation
Parallèlement, l’archive connaît un processus de dématérialisation accélérée. Numérisation massive, bases de données ouvertes, circulation instantanée : l’archive perd sa matérialité et, avec elle, une partie de son aura. Elle devient fichier, flux, donnée, exposée aux altérations et manipulations. Plus que Walter Benjamin (« L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », 1936), souvent convoqué, il est pertinent de rappeler aujourd’hui les analyses d’Aleida Assmann (Cultural Memory and Western Civilization, 2011), qui montrent comment la mémoire culturelle circule désormais entre supports matériels et numériques, dans un va-et-vient constant entre fixation et fluidité.
De nombreux projets artistiques jouent de cette fluidité. Hito Steyerl, dans How Not to Be Seen : A Fucking Didactic Educational .MOV File (2013), détourne le langage de l’archive numérique pour montrer la vulnérabilité des images à la manipulation et à la disparition. Jenny Holzer, avec ses Redaction Paintings (2005-2010), reproduit des documents gouvernementaux censurés sur la guerre en Irak, rendant visibles les trous noirs de l’information officielle.
Un courant parallèle est celui des « fictions théoriques », qui utilisent l’archive comme matériau pour imaginer des récits spéculatifs. Des artistes comme Forensic Architecture (dirigé par Eyal Weizman) exploitent images satellites et archives numériques pour produire des enquêtes mi-scientifiques mi-artistiques, entre savoir et récit critique.
Cette fluidité, sur laquelle j’insistais dans l’introduction de L’Archive dans les arts vivants, rejoint la problématique contemporaine de la désinformation : si tout document est archivable et reproductible, qu’en est-il de sa fiabilité ? Les « deepfakes », faux documents numériques indiscernables du vrai, brouillent la frontière entre archive et fiction. Même s’il serait faux et naïf de considérer que l’archive physique l’était pleinement, ’archive numérique n’est plus garante de vérité, elle devient champ de bataille symbolique.
La mise en circulation incessante fragilise la valeur scientifique de l’archive, tout en augmentant sa valeur culturelle et politique. Elle est désormais aussi un objet de marché, de collection, de fétichisation : Trevor Paglen vend ses images satellites comme archives du présent, immédiatement intégrées au circuit marchand. En somme, l’archive est passée d’une épistémologie de la preuve à une économie du signe et du flux.
Conclusion
Du point de vue des usages artistiques, l’archive a cessé d’être simple document pour devenir une matière de création, permettant de contester les grands récits historiques et de réinventer des formes de mémoire. Mais ces pratiques débouchent aussi sur des zones grises, comme l’a montré la controverse autour de Milo Rau, où l’autorité de l’archive se confond avec la légitimation de l’artiste.
Du point de vue de l’exposition et de la fétichisation, l’archive est devenue actrice, voire personnage, fascinant par son opacité. Boltanski, Raad ou Fontcuberta en révèlent l’ambiguïté : relique ou canular, elle joue de sa matérialité et de son aura. Mais cette fascination n’est pas sans danger : elle peut virer au kitsch ou au fétiche, transformant la mémoire en spectacle.
Enfin, du point de vue de la dématérialisation et de la circulation, l’archive est emportée dans le flux numérique, où elle perd de son autorité scientifique pour devenir donnée manipulable, objet de marché ou instrument de désinformation. Pourtant, cette fragilisation ouvre aussi un espace critique : les « fictions théoriques » et les pratiques de Forensic Architecture montrent que la fiction peut devenir un outil de résistance face à la prolifération de faux et au brouillage des sources.
Ainsi se dessine une dialectique entre ces trois dimensions. Les usages artistiques, en multipliant les relectures, révèlent l’agentivité de l’archive et son pouvoir de produire du sens ; la fétichisation en souligne l’aura mais aussi les risques de dérive ; la dématérialisation, enfin, en affaiblit l’autorité scientifique tout en ouvrant la voie à des usages critiques et politiques. Penser le nouveau statut de l’archive, c’est tenir ensemble ces contradictions : entre preuve et fiction, relique et flux, autorité et manipulation. L’archive n’est plus seulement un objet de savoir, mais un acteur central de notre modernité culturelle et politique.
Occurrences de « Archive vivante » (2012-2025) : quelques jalons
- 2011-2013, festival d’Arsenal Berl : Living Archive – Archive Work as a Contemporary Artistic and Curatorial Practice.
- 2012, 25-26 octobre, université Paris-Diderot (Paris 7, Halle aux Farines) : colloque Archive vivante, organisé par le CERILAC en partenariat avec l’IRI (Centre Pompidou). Actes publiés : L’Archive dans les arts vivants (dir. Isabelle Barbéris), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015 (voir ci-dessus).
- 2013, article « How Libraries Can Use ‘Living Archives’ » de Tamara Rhodes.
- 2013, 11 avril, centre Georges-Pompidou (Paris) : rencontre Paroles d’artistes : « L’artiste, une archive vivante ? ».
- 2014, 15-17 octobre, université de Caen : colloque Processus de création et archives du spectacle vivant(mentions d’« archives vivantes » et « archives incorporées »).
- 2014-2015, Metz, Galerie Faux-Mouvement : cycle Archives au présent / Travail d’archives (référence explicite au colloque Archive vivante de 2012).
- 2020-2021, université Paris 8 / MSH Paris-Nord : journées d’étude Arborer l’archive vivante au musée.
- 2021, 24-25 novembre, MSH Paris-Nord : colloque international Arborer l’archive vivante au musée. Enjeux écologiques par le geste artistique.
- 2022, 17-18 mars, université Lyon 3 : colloque L’archive comme lieu d’expérimentation. Construction, création, performance (usage explicite de l’expression « archives vivantes et actualisables »).
- 2022, ENS de Lyon, Ateliers d’anthropologie : programme Archives vivantes (entretiens filmés menés au Sénégal et au Bénin, 2011-2015).
- 2022-2025, Cité internationale des arts (Paris) : cycle d’expositions Émersions : archive vivante, 1er volet en 2022, et poursuite en 2025.
- 2023, 10 mai, MSH Paris-Nord : journée doctorale Traces et archives vivantes, savoirs situés.
- 2023, EHESS/BnF (Paris) : séminaire Cliquer l’Archive, podcast associé : « L’archive vivante » (Benoît Labourdette).
- 2023, janvier, article « Living Archives at Tate: After An Archival Impulse » de Sarah Haylett sur le site de la Tate.
- 2024, Calenda – cycle Petite histoire / grande histoire : intervention : « L’archive vivante du corps au travail ».