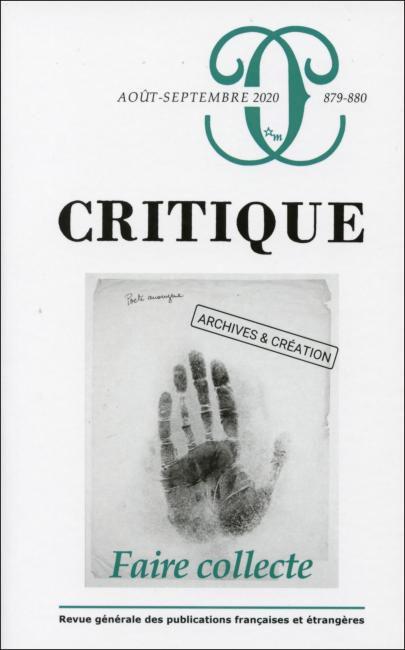Documenter le franquisme
Le numéro spécial de la revue Critique "Faire collecte. Archives et création" vient de paraître. Collecte, appropriation, création documentaire en constituent les centres de gravité : en collaboration avec la revue Critique et avec Muriel Pic, coordinatrice du numéro, Entre-Temps publie un extrait de la contribution de Pedro Cordoba, consacrée au cinéaste Basilio Martín Patino.
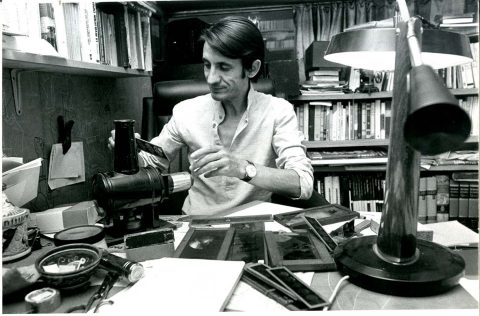
Documenter le franquisme. Montage et blocs d’enfance dans le cinéma de Basilio Martín Patino
Au départ, une image maudite. Celle d’un enfant enthousiasmé par le bruit des bottes à Salamanque, ravi de participer comme un brave aux défilés, déguisé en phalangiste ou en requeté carliste[1], parfois même en croisé ou en templier. Les rebelles ont immédiatement conquis la ville et Franco y a établi son quartier-général, quelques républicains ont été victimes d’exécutions sommaires, le philosophe Unamuno est mort confiné à son domicile mais le petit garçon n’en a rien su. La vraie guerre déchaîne ses horreurs, mais ailleurs, loin des regards, loin des cœurs. Ici, il n’y a plus qu’une fête permanente, un cirque sans chapiteau. Places et rues hébergent la parade : drapeaux au vent, bras tendus, musiques militaires, cortèges et slogans. Tout y est héroïsme et noblesse, on se croirait au cinéma : Dieu, que la guerre est jolie quand on n’a que sept ans !
Ce petit garçon s’appelle Basilio Martín Patino. Son père est un homme de droite, un instituteur de village, nommé depuis peu directeur de l’École normale à Salamanque. Sa mère appartient, elle aussi, à ce milieu catholique conservateur qui n’a pas hésité à embrasser la cause franquiste. Trois enfants dans la famille : un frère aîné qui deviendra prêtre et une sœur religieuse. C’est plus tard, beaucoup plus tard, lorsqu’il entre à l’Université, qu’il comprend sa bévue : la guerre civile n’avait pas été ce qu’on lui avait dit, ce qu’il avait cru. On avait enrégimenté (et ensoutané) son enfance. Il en devient orphelin de ses propres souvenirs mais, en même temps, incapable d’en faire le deuil : c’est la définition même (freudienne) de la mélancolie.
Tu n’as rien vu à Salamanque
Très méconnue en France, l’œuvre de Martín Patino (1930-2017) bénéficie en Espagne d’une aura croissante[2]: les hommages succèdent aux hommages, ses films sont étudiés dans les écoles de cinéma, les thèses, les livres et les articles s’accumulent sur une filmographie qui, d’une certaine façon, est plus actuelle aujourd’hui que du vivant de l’auteur. Mais comment aborder cette œuvre foisonnante, étalée sur plus d’un demi-siècle ? Nous avons choisi ce qu’on pourrait appeler une « présentation conceptuelle » : partir de la kermesse militaire à Salamanque et en déplier de proche en proche les principales configurations.
Il faut d’abord souligner un fait essentiel car tout en dépend. Cette image de « kermesse héroïque » n’est pas univoque, elle est bienheureuse tout autant que maudite, à la fois haïssable et chérie. Lorsqu’il ouvre les yeux, si longtemps après, Patino ne se résout pas à remplacer un mensonge par ce qui serait un autre mensonge : car son enfance franquiste a bien été euphorique (nous reviendrons sur ce terme), il n’est pas permis de nier cette réalité. Mais jamais, non plus, Patino ne cèdera aux expédients, aujourd’hui à la mode en Espagne, qu’on désigne sous le nom d’« équidistance » : les torts sont partagés, tout le monde a commis des erreurs, il y a eu des crimes dans les deux camps, il faut condamner toutes les violences. Ce serait bien plus abject. Le mal existe en politique, il faut pouvoir le désigner, même si on ne sait pas toujours où se trouve le bien. Notre image de départ est donc double mais les deux faces n’existent pas simultanément selon les mêmes modalités. Lorsque l’une d’elles est actuelle, l’autre devient virtuelle – et réciproquement. C’est comme si l’on passait constamment d’une machine optique à l’autre : le miroir plan qui offre une image virtuelle de l’objet, la lentille du projecteur qui montre une image actuelle sur écran. Car deux réalités contradictoires ne peuvent coexister sauf à tomber dans les sottises de la dialectique, lesquelles font sombrer dans l’« équidistance ». Entre les deux faces de l’image, Patino maintient la tension à vif, il ne s’agit pas d’en éliminer la plus dérangeante ; seul le jeu du virtuel et de l’actuel permet de tenir ce défi.
« Tu n’as rien vu à Salamanque, rien » / « J’ai tout vu à Salamanque, tout ». Un tel dispositif est connu au cinéma. Duras et Resnais l’avaient inventé pour dire l’indicible : Hiroshima. Face à une impossibilité d’un autre ordre – exprimer le bonheur d’un enfant dans la guerre – Patino oscille aussi entre deux vérités qui s’affrontent. Tu n’as rien vu actuellement, j’ai tout vu virtuellement. Ce petit appareil biface constitue ce qu’on appelle en cristallographie un germe. Plongé dans un milieu adéquat, il se propage instantanément de proche en proche et transforme l’ensemble du milieu en structure cristalline. Image-cristal. Mais une fois son oeuvre accomplie, le germe devient invisible, il disparaît dans l’ensemble cristallin. En termes moins deleuziens, on dira que, pour mieux comprendre ce lambeau d’enfance, Patino a choisi d’en filmer le hors-champ.
C’est dans cette « optique » que nous allons nous situer. Plongé dans le milieu à la fois urbain et rural de Salamanque, le germe va s’ordonner (le cristal est une structure ordonnée) autour d’un certain nombre de facettes, qui font l’être même du cristal. Films = bijoux. Il y a d’abord une première approche du milieu : Tarde de domingo (1960), un moyen métrage de type néoréaliste (on sent la présence d’Antonioni) sur l’ennui qui accable une jeune bourgeoise de Salamanque. Il y a aussi les premiers documentaires : El noveno (1961), sur une fête votive, et Torerillos (1962), sur les apprentis-toreros qu’on voyait à cette époque le long des routes, baluchon à l’épaule, à la recherche d’une « occasion ». Il y a enfin, dans cette période liminaire, un scénario qui n’a pas été tourné mais qui introduit un élément-clé : deux jeunes françaises prennent dans leur voiture des « indigènes ». Grâce à elles, ils voient le paysage qui les entoure comme jamais ils ne l’avaient vu. Pour ne pas rester englué dans la doxa, il faut interposer le regard d’un Alien qui met en valeur cet ostranenie[3] cher aux formalistes russes. Les exemples sont nombreux : Lorenzo dans le premier grand film, Nueve cartas a Berta (1966) ; Berta elle-même dans Los paraísos perdidos (1985) ; le cinéaste allemand Hans dans Madrid (1987) ; le bouffon Escribano dans La seducción del caos (1991) ; l’ex-agent secret Rodrigo dans Octavia (2002). L’ « estrangement » est souvent renforcé par l’usage d’une voix-over, chargée de tamiser la perception directe des choses : le cas le plus caractéristique est sans doute, dans Los paraísos perdidos, celui du retour de Berta qui voudrait héberger à Salamanque l’archive de son père (ce à quoi elle échouera). Lorsque le spectateur, qui ne sait pas encore qu’elle est en train de traduire Hölderlin, entend au début du film des passages d’Hypérion tandis que défilent des images du terroir, il pense d’abord à une voix-off classique puis comprend, lorsque le personnage entre dans le champ, lèvres closes, que c’est dans son propre discours intérieur – avec sa voix de femme – que prend la parole un locuteur masculin dont les mots se superposent, tout au long du film, aux choses vues. Morcellement, sauts dans l’axe, faux raccords et regards-caméra, qui doivent davantage à Godard qu’aux néoréalistes italiens, contribuent, par un surcroit d’artifice, à défamiliariser l’espace familier de Salamanque, en imposant une image alternative plus « vraie » que le décor habituel. Capitale de la Renaissance en Espagne, siège de l’une des plus vieilles universités européennes, Salamanque est un haut lieu de la culture mais aussi (ce sont les mêmes familles) la ville où réside l’une des oligarchies les plus réactionnaires d’Espagne. C’est pourquoi l’espace de ces films est double, inséparablement urbain et rural, puisque l’élite sociale est unique et occupe tour à tour ses palais en ville et ses demeures seigneuriales à la campagne, consacrant une partie des domaines à l’agriculture et le reste à la dehesa, où vivent les taureaux de combat. L’ identité culturelle de Salamanque repose tout autant, sinon plus, sur les taureaux que sur l’université.
Rien de tout cela ne constituerait évidemment un cristal si ne s’y ajoutait un personnage-clé, qui en fait tenir d’un seul coup toutes les faces : la fille de l’universitaire exilé. Rencontrée lors d’un voyage d’études à Londres par le jeune Lorenzo, le premier alter ego du cinéaste, Berta est l’incarnation même de la liberté, une promesse de vie. Les Nueve cartas a Berta, film épistolaire où Lorenzo s’adresse à cette Dame aussi hermétiquement silencieuse que Béatrice (le titre joue sur la magie du chiffre 9 dans la Vita nova), ont marqué une génération de jeunes Espagnols des années 1960. Les plus militants trouvèrent que le héros n’était pas assez « positif » et qu’il n’aurait pas dû se résigner à la fin. Or c’était justement cela le franquisme : non plus la recherche d’une adhésion, à laquelle le régime avait renoncé depuis longtemps, mais celle d’une résignation. Les enfants de la guerre devaient comprendre qu’ils ne relèveraient jamais la tête.
Bien après la mort de Franco, Patino donne un tout autre éclairage à ce qu’on pourrait appeler le cristal de Salamanque. Ce sont les films Paraísos perdidos (1985), déjà cité et jugé trop « littéraire » par la critique (la mode est alors à Almodovar, pas à Hölderlin) et Octavia (2002), paradoxalement trop baroque et trop austère à la fois, qui est un échec commercial. Patino tourne alors la page du cinéma pour salles obscures. Il travaille pour la télévision et se consacre à une nouvelle expérience, celle des installations dans différents espaces culturels : remontage en vidéo d’anciens films pour le triptyque des « Paradis » (2006) au Centre José Guerrero de Grenade[4] ; puis d’autres projections accompagnées, pour que le public puisse lui-même s’approprier le passé et « monter » ses propres histoires, de photos, d’affiches, de journaux, de tracts, de lettres et de cahiers d’écoliers des années 1900-1930 réunis avec l’aide d’Inmaculada Vicente, qui venait de publier un livre bâti à partir d’archives familiales[5]. Il y avait aussi, dans cette installation, une partie de sa fabuleuse collection privée d’appareils à reproduire des images qui, par la suite, a été donnée à la Filmoteca de Castilla y León où elle est aujourd’hui accessible au public dans le cadre d’une exposition permanente[6]. Le cinéaste est devenu plasticien.
Tu n’as rien vu à Guernica
La deuxième grande formation cristalline apparaît lorsque le germe (l’image de l’enfant dans le défilé) est plongé, non plus dans le milieu « familier » de Salamanque, mais dans celui de l’Espagne en général. Les cristaux de l’histoire remplacent alors le cristal de Salamanque. Le film le plus emblématique de cet ensemble est Canciones para después de una guerra, réalisé en 1971, d’abord autorisé puis immédiatement interdit par la censure. Il faudra attendre la mort de Franco pour le voir dans les salles, où il obtient un succès massif, le seul qu’ait jamais rencontré un film de Patino auprès du grand public.
L’ idée de génie fut de faire un film de montage à partir d’images officielles et de chansons célèbres que le cinéaste s’approprie librement. Le matériel d’archives était composé à 90 % des Actualités filmées franquistes (le célèbre NO-DO, obligatoire à toutes les séances de cinéma) et, pour le reste, d’extraits de films commerciaux, de concerts publics, d’affiches, de réclames, de coupures de journaux, de pages de revues, de vignettes de BD (ou « illustrés » comme on disait jadis), etc. Du côté de la bande-son, une trentaine de grands succès de la chanson avec les vedettes les plus célèbres de la scène espagnole. Comment y voir l’ombre d’une intention subversive puisque tout, à la fois les images et le son, avait été non seulement approuvé mais promu par le régime ? Il y avait évidemment plusieurs anguilles sous roche. Le film commence à la fin de la guerre et se termine avec le rapatriement des rescapés de la División Azul, libérés par les Soviétiques, en 1954. Cet intervalle de quinze ans correspond au titre : l’interminable après-guerre… Le problème est qu’en 1971 le régime avait depuis longtemps voulu tourner cette page. On pariait désormais sur le « développement » et le tourisme de masse. Difficile, avec ce film-là, de vendre à l’étranger la « nouvelle » Espagne… Il y avait évidemment aussi le rapport image-son. Qu’archive visuelle et archive sonore fussent politiquement irréprochables n’empêchait pas leur rencontre d’engendrer un effet de sarcasme. Le procédé n’est pas inédit : on peut penser par exemple à la séquence, dans Le Chagrin et la Pitié, où Max Ophuls fait écouter « Ça sent si bon la France » de Maurice Chevalier sur les images de l’entrevue Pétain-Hitler. Ce qui singularise le film de Patino, c’est le caractère systématique de ce décalage entre l’image et le son au point que tout spectateur est à chaque instant amené à chercher une « malice » qui lui aurait échappé. Tâche d’autant plus difficile que souvent les images sont si hétérogènes et défilent si vite que c’est déjà dans la mémoire qu’il faut aller chercher le passage significatif de la chanson tandis qu’une nouvelle devinette a pris la relève. Il faut renoncer à tout élucider.
Si la considération des phénomènes de montage et de mixage suffit à résoudre le premier paradoxe, celui d’un film subversif à partir de documents officiels, d’autres apories sont bien plus retorses. Il se trouva par exemple un grand nombre de dignitaires du régime pour applaudir le film : ces images célébraient leurs exploits de jeunesse et les petites blagues aigries qu’on pouvait deviner en arrière-fond ne comptaient pas face à la réalité imposante de l’histoire : elles témoignaient tout au plus de l’impuissance des vaincus. C’est donc la frange la plus réactionnaire et la moins « politique » du franquisme qui se laissait séduire par la « vérité » de l’archive. Plus perspicace, l’épouse de l’amiral Carrero Blanco[7], qui avait son franc-parler, conclut : « Le fils de pute qui a fait ça devrait être en prison. » Un paradoxe encore plus bizarre concerne l’autre camp. Pourquoi ces chansons à succès des années 1940-1950 continuaient-elles à bouleverser les spectateurs des années 1970, surtout s’ils se réclamaient de la gauche et de l’art d’avant-garde ? Car il ne fait pas de doute : c’est d’abord pour les chansons que les spectateurs se déplacèrent en masse. Or la plupart des textes sont (ou peuvent sembler) d’un mauvais goût épouvantable, la musique flonflonesque et les artistes, sans exception, avaient mis leur image au service du franquisme. Par un deuxième tour d’écrou, encore plus rocambolesque, ces textes célébraient, un peu à la manière de la « chanson réaliste » française, un monde interlope de délinquants, de marginaux et de prostituées, de marins tatoués dans les tavernes et de corps électrisés par les feux d’Éros[8]. En quoi l’idée d’un bonheur dans le crime ou un plaidoyer pour la ruine et la perdition de l’âme étaient-ils compatibles avec les valeurs traditionnelles et catholiques promues par le franquisme ? C’est un tout autre abîme pour la pensée qui s’ouvre ici. Il concerne à vrai dire la « culture de masse » et le kitsch. Face aux différents dogmatismes, on aura recours à la théorie du primitif chez Benjamin et on se contentera de rappeler sa définition, si profonde : « Le kitsch est la grimace du totem[9]. »
L’ interdiction de Canciones plonge Patino dans la fureur. Il conçoit un projet digne de don Quichotte : devenir cinéaste clandestin. Il n’a pas manqué dans l’histoire récente de poètes, et même de romanciers, publiant sous forme de samizdat, ou l’équivalent. Il y a eu aussi des peintres enfermés dans leur atelier et refusant d’exposer, comme Picasso sous l’Occupation. Mais cinéaste ? Or c’est bien ce que veut Patino : défier Franco avec ses armes dérisoires comme le vieux chevalier s’en prenant aux géants. Deux films sont réalisés dans ce contexte. Le premier est un documentaire tourné dès la même année 1971 – encore sous le coup de l’interdiction de Canciones – sur les trois bourreaux alors en activité en Espagne : Queridísimos verdugos (« Très chers bourreaux »). Avec une caméra 16 mm, un magnétophone, deux techniciens engagés au Portugal, un peu de ferraille pour les déplacements et les auberges, de quoi aussi stipendier les bourreaux et les régaler de cigares et de vin, Patino entreprend ce qu’il appelle un « safari cinématographique » de six jours, zigzagant entre Badajoz, Grenade, Valence et Madrid pour être déjà partis plus loin en cas de dénonciation à la Garde Civile. Dix heures d’enregistrement et un très long montage, tellement le simple visionnage des rushes était éprouvant. « Une expérience que je ne recommencerais pour rien au monde », dira plus tard le cinéaste qui poursuit le règlement de comptes avec un nouveau film de montage, réalisé en 1974 et consacré à la figure du Dictateur depuis ses débuts dans l’Armée d’Afrique jusqu’au coup d’État de 1939 : Caudillo. Le problème semble encore plus insoluble. Comment réaliser un film de montage alors que Patino n’a évidemment plus le droit de puiser dans les archives espagnoles et ne peut pas davantage travailler à Moscou ou à Berlin-Est sur les archives soviétiques ? Pathé et Gaumont lui fournissent quelques matériaux intéressants à Paris ainsi que Movietone à Londres. Mais il a surtout un joli coup de chance à Lisbonne : dans les anciens studios de la Tobis, voués à la casse, il y avait tout un fonds d’archives franquistes car, pendant la guerre civile, les labos se trouvaient en zone républicaine et les fascistes devaient passer par le Portugal de Salazar. Le bâtiment allait être démoli de façon imminente. Patino rachète à bas prix la totalité de l’archive et récupère tout ce qu’il peut emporter dans ses valises juste avant que ne tombe sous le pic cette caverne d’Ali-Baba[10].
Entre les deux séries cristallines, il n’y a pas seulement changement d’échelle, de Salamanque à toute l’Espagne. Ni même passage d’une dominance de la fiction à la primauté de l’archive. Ou plutôt, ces phénomènes sont subordonnés à un questionnement plus radical sur la nature des images. Dans le premier cas, il s’agit de dépayser les images trop connues (ostranenie) ; dans le second, de mettre en question le rapport de l’image au référent en tant que tel. Voir ou ne pas voir ce qui s’est passé dans l’univers familier de Salamanque ne relève pas de la même injonction que voir ou ne pas voir ce qui eut lieu à Guernica, un jour de marché.
—
[1] Équivalent de nos Chouans, intégrés dans l’armée franquiste.
[2] Conçu comme un vaste cycle de conférences, de témoignages, d’expositions et de projections mais interrompu pour cause de pandémie, le dernier grand hommage s’est déroulé à l’université de Salamanque à partir du 12 février 2020.
[3] Chklovski appelait ostranenie (« estrangement ») l’ensemble des procédés littéraires destinés à mettre à distance notre perception habituelle de la réalité en la rendant autre, c’est-à-dire à l’aliéner pour la désaliéner.
[4] « Paradis pour survivre », « Paradis et Apocalypse », « Paradis et Utopies ».
[5] C’est l’installation Espejos en la niebla (« Miroirs dans la brume ») au Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2008. Pour sa part, le livre d’Inmaculada Vicente retraçait les « vies parallèles » d’une famille de grands propriétaires et d’une famille de paysans pauvres expulsée par les premiers. Avant de connaître l’auteur, Patino avait déjà utilisé une partie de cette histoire dans Octavia.
[6] Devant ces objets, on se prend à rêver aux ancêtres du cinéma dans les listes de Benjamin : les panoramas et les dioramas, bien sûr, mais aussi les cosmoramas, les diaphanoramas, les navaloramas, les géoramas, les cinéoramas, les phanoramas, les stéréoramas, les cycloramas… On se prend aussi à évoquer tous ces appareils, parfois connus depuis des siècles, réservés à des usages techniques ou, au contraire, relégués au monde des forains et des bonimenteurs : la vieille camara obscura des peintres, l’épidiascope, le zootrope, le praxinoscope, le fantascope, le lampadorama, le stéréopticon, le polyorama, le multithaumatrope, etc. Le couple caméra / projecteur (et aujourd’hui leur indistinction dans un simple smartphone) a effacé des mémoires cette riche préhistoire. Patino, lui, voulait la sauver de l’oubli et la montrer au public dans la matérialité nue des objets eux-mêmes.
[7] Les plus vieux de nos lecteurs doivent se souvenir de cet amiral qui, désigné successeur de Franco, fit le grand saut en 1973. Ce magnifique attentat dégageait le chemin du futur.
[8] Pour une analyse de la copla, voir la rubrique « Espagne » dans La Chanson mondiale depuis 1945 (Larousse, 1996). L’ auteur s’appuie d’ailleurs sur le film de Patino, défini comme « le meilleur hit-parade de l’Espagne paléo-franquiste ».
[9] La formule se trouve, avec une traduction légèrement différente, dans « Kitsch onirique », OEuvres II, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2000, p. 10.
[10] Pour compléter cette « tétralogie du franquisme », il faudrait ajouter un troisième « film de montage » – Retablo de la guerra civil – en 1980. Nous sommes désormais dans l’Espagne démocratique mais si le point de départ est toujours l’archive, il ne s’agit plus d’un film au sens propre. Montré sur des moniteurs, il s’adresse aux visiteurs d’une exposition qui eut lieu au Palacio de Cristal de Madrid. Ce fut la première intervention de Patino dans ce nouveau type d’espace.
—
Lire la suite dans « Faire collecte. Archives et création », le numéro 879-880 de la revue Critique, coordonné par Muriel Pic.