Dans les dédales du Web
Depuis l’émergence du web il y a désormais trente ans, les historiens déambulent dans la toile, arpentant ses dédales comme ils le feraient dans un espace public où sont formulés et circulent des discours, notamment sur leur propre discipline. Sorti en mai 2019, "Dans les dédales du web" propose une mise au point collective sur ces déambulations.
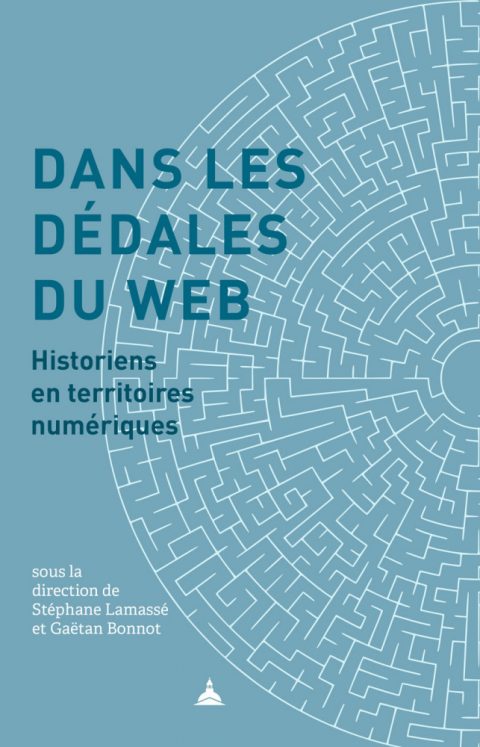
Par le biais de différentes thématiques (la question de la temporalité, celle des définitions d’un corpus et du statut documentaire des « sources » numériques, ou encore celle de la toile comme espace public et productrice d’autorité), l’ouvrage rend compte de démarches pratiques et de travaux en cours. Situées à l’intersection de la mise en œuvre de recherches historiques sur des documentations numérique et de réflexions méthodologiques interdisciplinaires (histoire, informatique, mathématiques notamment), les contributions de cet ouvrage peuvent être comprises comme autant de portes ouvertes sur ces territoires à explorer pour l’historien.ne.
Entre-Temps vous propose de lire l’introduction de cet ouvrage et remercie très chaleureusement, à ce titre, les Éditions de la Sorbonne ainsi que les auteurs.
Introduction
Le colloque dont ce volume est la publication[1] répondait à une volonté de mettre en place des protocoles scientifiques en associant des dispositifs techniques et technologiques à une réflexion épistémologique et disciplinaire[2], prenant ainsi le contre-pied d’une posture qui les réduirait à des savoir-faire techniques, des « outils » pour l’historien. La problématique a été également orientée vers une optique résolument pluridisciplinaire (histoire, statistiques, informatique), avec pour objectif central d’identifier des objets de recherche communs à différents champs. En se saisissant de la Toile, les communications ont fait l’effort de mettre en évidence des démarches pratiques, presque d’atelier. Les interventions, dont résultent les articles qui composent ce volume, n’avaient pas vocation à présenter des travaux achevés, finis, dans lesquels les scories comme les manques seraient gommés pour entrer dans le moule calibré d’exposés rodés. Les communications ont parfois fait écho aux échecs, aux écueils, mais aussi aux difficultés éprouvées. Cet exercice supposait de partager, plus que des usages, des compétences dans chacun des domaines. Le chemin pour y parvenir a été particulièrement escarpé, il a obligé les participants à quitter le confort de leur champ propre, répondant ainsi à l’invitation de Williard McCarty qui proposait dans Humanities Computing une action collective, une réflexion ouverte et plurielle[3].
Dans les dédales du web, ce titre aux résonances résolument contemporaines, n’est pas tant une contribution à l’histoire du temps présent qu’un questionnement sur les rapports entretenus par l’histoire vis-à-vis d’un objet du monde présent, le web, compris comme un construit social et technique au sein duquel des acteurs se positionnent et communiquent. Un certain nombre d’études souligne les transformations que le web produit sur l’historien et ses méthodes. Lorsqu’il évoque le devenir du médiéviste au XXIe siècle, Jean-Philippe Genet souligne, par exemple, que l’internet transforme certes la manière de lire et d’écrire, mais également le « mode de pensée qui conduit à l’écriture[4] ». La figure du « cyber-historien[5] », décrite par Philippe Rygiel, va dans le même sens. Mais la Toile, en creux du discours lui attachant l’idée d’un changement continu du métier de l’historien dont elle serait responsable, réactive aussi des approches critiques qui semblaient appartenir à une érudition classique. C’est ce que relevait Patrick Boucheron il y a quelques années, dans un entretien où il affirmait que le médiéviste est armé conceptuellement pour comprendre le caractère composite d’un document, la glose, la non-linéarité du texte ou encore sa « dissémination sans auteur[6] ». À cela, on peut rajouter une réflexion sur la construction des sources[7]. Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, l’historien qui cherche à s’emparer de ces questions ne se trouve pas, tant s’en faut, confronté à une terra incognita[8].
Les historiens n’ont jamais vraiment cessé de s’intéresser aux développements de l’informatique et du quantitatif[9]. On dira peut-être qu’ils furent peu nombreux, mais l’histoire en tant que réseaux d’hommes, en tant qu’institutions universitaires leur a laissé une place. Même dans le champ académique, elle a su rester attentive[10]. À la charnière des années 1950, l’informatique, discipline alors émergente dont le nom même n’était pas encore fixé, permettait de manipuler, questionner autrement, à la fois la construction des données mais aussi les statistiques que l’on pouvait en extraire. De la même façon, la Toile, depuis déjà une vingtaine d’années, suscite la curiosité d’historiens qui ont écrit sur différentes facettes de leurs rapports à l’internet. Pour aborder des questions qui semblent aujourd’hui très modernes, il est toujours intéressant de revenir sur cette littérature relativement importante et un peu ignorée, constituant aujourd’hui un élément d’historiographie. Dès le tournant des années 2000, les bouleversements et les enjeux induits par le développement de l’internet, dans les sciences humaines et sociales en général et au sein de l’histoire en particulier, ont été pointés et décrits[11]. On pense évidemment à l’ouvrage pionnier de Rolando Minuti[12], mais également à des articles témoignant de cette transformation du système communicationnel. C’est bien là le sens qu’il faut donner à l’Atelier Internet, un séminaire fondé par Éric Guichard à l’École normale supérieure dès 1995, au Rapport Internet et les chercheurs[13] ou encore aux colloques de 1999, « Comprendre les usages d’Internet[14] », et de 2003, « Mesures de l’internet[15] ». Cette tendance semble s’être renforcée avec l’essor des digital humanities, groupe très actif et composite[16]. Les enjeux évoqués sont régulièrement reconsidérés lors de rencontres scientifiques, de séminaires ou encore d’actes éditoriaux, dont le rythme s’est considérablement accéléré depuis une dizaine d’années[17]. Toute cette littérature fournit aujourd’hui un socle pour des études à venir qui concerneraient des données du web.
Au-delà d’un renouveau des supports et des pratiques, le rapport de l’historien à ce matériau, même si celui-ci semble moins tactile et immédiat que ne le sont les archives papier, n’en demeure pas moins vivant, au sens où Arlette Farge l’entend[18]. L’historien est donc confronté à un web incarné, moteur et vecteur de nouvelles pratiques, d’identités, de représentations. L’immédiateté et l’ubiquité de ce dispositif réintroduit des questions toujours stimulantes autour de la place de l’historien académique et de l’histoire dans l’espace social. La « donnée » n’a peut-être jamais été autant au cœur de nos sociétés. On parle de données ouvertes, d’un « âge de l’abondance », du passage d’un web de l’information à celui de la connaissance. Objet d’enjeux économiques, politiques, et cela dès sa conception, la « donnée » est aujourd’hui utilisée à des fins d’intelligence artificielle et impliquée dans tous les mondes du numérique. De la robotique aux systèmes de reconnaissance automatique, on utilise actuellement les big data, même en histoire[19], ce qui ne peut qu’être attractif pour l’ogre qu’est l’historien[20]. Cependant, le chercheur se confronte ici à cette question des « données », souvent mouvantes, composites, tantôt massives, d’un volume qui les rend difficilement préhensibles, tantôt extrêmement pauvres[21]. Elles sont toujours le fruit de dispositifs qui les ont formatées. À considérer la masse de données ainsi véhiculées, l’exercice d’un regard critique vis-à-vis de la logique qui voudrait que l’administration de la preuve se fasse nécessairement par le nombre semble de mise[22]. Ces caractéristiques ne sont pas étrangères à la construction du récit historique. Alors que l’on parlait d’une « crise » du métier de l’historien et de la dissolution de son objet[23], l’étude de la Toile peut apparaître comme une autre façon d’éprouver les méthodes de la discipline, comme un révélateur de sa capacité à produire du sens, à mobiliser et à infléchir une méthodologie face à des données nouvelles et dynamiques.
Ces observations ouvrent des pistes de recherche et invitent à s’intéresser à nouveau aux rapports entre l’historien et le web et soulèvent des interrogations quant à l’accès aux sources, à l’administration de la preuve. L’élaboration de méthodes scientifiques adaptées au dispositif « techniquement complexe et socialement construit[24] » que constitue la Toile apparaît comme un prérequis nécessaire pour repenser le rapport à cet objet d’histoire. Dans ce contexte, il devient possible, nécessaire, d’accroître aussi les collaborations entre les sciences humaines et sociales.
Quatre grandes thématiques ont émergé des articles de ce volume qui, chacune à sa manière, ont appréhendé des dimensions relatives à toutes ces considérations.
La dimension temporelle des données
La temporalité constitue un enjeu, souvent assez peu relevé, de la compréhension de la Toile. C’est pourtant là une préoccupation essentielle, une mise à distance nécessaire. Tout d’abord, il faut peut-être remarquer que, en dépit du discours sans cesse réactualisé de la « révolution en marche[25] », nous sommes face à quelque chose qui sort de l’enfance. Si l’on met de côté le fétichisme de la date et la recherche d’une origine unique, le web est né autour des années 1990 : c’est une pousse de 27 ans. Mais la Toile n’est qu’un tissu sur une structure plus profonde et plus ancienne qui est l’internet. L’information numérique produit une archive en continu, et plus de vingt années d’archives ont donc été créées et véhiculées par ce réseau des réseaux, d’ores et déjà devenu un territoire de recherche en tant que tel pour la discipline historique. Comment naviguer dans l’épaisseur des médiations que forme la Toile ? Comment évaluer l’évolution, les ruptures dans une technologie où l’évanescence est la norme et qui cependant donne l’illusion de la stabilité et de la pérennité ? Est-il possible de saisir des durées, des dynamiques, des rythmes d’écriture qui soient liés au champ historique ? Ces interrogations traversent largement l’ensemble des contributions, ce qui interroge quant à un retour de l’analyse temporelle au sens statistique du terme. C’est d’ailleurs le sens de l’article de Madalina Olteanu et Julien Alerini. Mais les historiens de ce volume ont proposé d’autres façons d’aborder le rapport au temps.
L’une d’entre elles concerne les résonances que peuvent trouver les événements passés sur le réseau des réseaux. Jean-Philippe Genet propose d’aborder ces questions au travers d’une expérience se fondant sur l’un des socles de la société médiévale anglo-saxonne : la Magna Carta de 1215. Sa démarche repose sur une navigation méthodique, documentée et critique[26]. Elle le conduit à analyser l’actualité de ce document en mettant en avant des différences notables entre des imaginaires et des mémoires francophones et anglophones.
Valérie Schafer propose, quant à elle, une réflexion davantage centrée sur ce que peut signifier l’archivage du web, patrimonialisé dès 2003, et la réalité des possibilités qui semblent offertes, qu’il s’agisse d’Internet Archive ou de la Bibliothèque nationale de France. Une prise en compte de la dimension temporelle est nécessaire tant dans l’interrogation des données que dans leur accès puisque, comme le développait Niels Ole Finneman, différentes temporalités se chevauchent dans ce web archivé[27].
Enfin, c’est à l’étude d’un gisement de données, en l’occurrence un ensemble de recensements canadiens, produits entre 1871 et 1916 et mis en ligne, que nous invite Anthony Nelzin-Santos. Ce dernier pose différemment la question de la production sociale que constituent ces inventaires, souvent abordée par des sociologues et des statisticiens comme Alain Desrosières[28]. Ici l’historien porte davantage l’accent sur ce que peuvent refléter et induire les choix de mise en ligne. Il montre alors à quel point il est difficile d’accéder au matériau historique par le biais du document numérisé. Pour obtenir des résultats et se donner une chance de pouvoir conduire une étude temporelle, la mise en place d’un outil permettant l’investigation et la réconciliation de données là encore très hétérogènes a été nécessaire.
Corpus et documents
La question de la fouille du web et de sa collecte apparaît première. Le chercheur se trouve dès lors confronté à la nécessaire constitution d’un corpus. Comment parvenir à faire corpus à partir de ce web hétérogène, désordonné, instable qui offre lui-même ses propres métriques et hiérarchies[29] ? Quelle porte d’entrée peut permettre d’accéder aux informations ? Les catégories classiques se heurtent à la nature des données accessibles. Le caractère mouvant et composite des sources de la Toile rend en effet malaisée, voire inopérante, la définition de situations de communication déterminées, la diachronie ou encore la contrastivité, clés de voûte dans l’établissement d’un corpus tel qu’Antoine Prost le formulait pour les analyses lexicométriques[30]. Ces catégories s’avèrent brouillées au sein de scénographies numériques, le web étant une mise en forme dont la complexité est la règle. Les compétences techniques mobilisées sont souvent très importantes et sont fréquemment confrontées à des données difficiles.
L’utilisation des bases de données accessibles en ligne, documentaires comme heuristiques, pourrait donner le sentiment de simplifier la question. Que peut-on extraire des catalogues de bibliothèque qui furent parmi les premiers gisements de données de l’internet ? Octave Julien a tenté d’utiliser ceux auxquels le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France donne accès en ligne. Que peuvent nous apprendre ces fiches de catalogue, dont il est d’usage de discuter la qualité ? En dépit de résultats obtenus sur les fonds latins et français qui restent difficiles à interpréter finement, l’évolution temporelle des manuscrits conservés reflète des tendances utiles. Ce sont l’expertise et l’érudition dans le domaine de la bibliométrie qui permettent d’aborder autrement les problèmes de qualité de données.
Cette invitation à la précaution, et sans doute au retour sur la production des données, a été formulée en 2016 alors même que la Toile portait la promesse d’une interopérabilité ouvrant vers de nouvelles exploitations. Qu’en est-il concrètement ? Dans quelle mesure l’historien peut-il mettre en œuvre une démarche documentaire à partir de ces informations qui demandent à être traitées selon des critères, encore largement à définir, pour devenir un matériau exploitable ? C’est dans cette voie que poursuit l’intervention de Léo Dumont en proposant une recherche sur les brochures conservatrices de 1849 à partir de la plateforme open data de la Bibliothèque nationale de France et de la version sémantique des notices du catalogue général en juillet 2017. Comment peut-on acquérir un corpus à partir de ces outils ? À quelles contraintes l’historien se trouve-t-il confronté ? Là encore, ces dispositifs techniques évoluent, parfois rapidement, ce qui a tendance à générer l’illusion qu’ils ont toujours permis les mêmes opérations. L’histoire se produit aussi avec les moyens documentaires d’une époque. Les technologies du web sémantique, explorées ici, sont en évolution constante : dans l’intervalle de temps séparant le moment de la communication de celui de l’écriture, puis de l’édition de cet ouvrage, les outils sémantiques mis en ligne par la bibliothèque ont changé.
Voilà à présent plus de dix ans que le web sémantique a fait son entrée dans le paysage des sciences humaines[31] : Dbpedia, par exemple, date de 2007. Les ontologies se sont depuis multipliées, et c’est sur cet aspect que la contribution d’Amina Souag porte. Elle propose un état de l’art pour archéologues et historiens. En tant que professionnelle de l’informatique, elle prête une attention rigoureuse aux difficultés que ces technologies peuvent rencontrer, notamment avec l’exemple de l’usage de terminologies communes. Elle rejoint ici Francesco Beretta qui, lors du colloque, avait évoqué les enjeux autour de la tension entre ontologies et digital history.
La Toile et la production d’autorité
Les questions de l’autorité, de la figure de l’historien amateur, de la construction de récits historiques et de leur ré-appropriation dans des espaces publics, sont abondamment traitées dans d’autres publications[32]. Lors des séances de ce colloque, les discussions se sont parfois orientées vers la constitution de postures d’autorité et ont questionné les rapports à l’histoire qu’elles permettent aux internautes de construire. Aussi ne faut-il sans doute pas se laisser surprendre par le retour de Wikipédia comme objet d’étude[33]. L’encyclopédie gère elle-même sa mémoire en fournissant l’accès à ses données. Elle est aussi devenue une norme utilisée jusque dans les moteurs de recherche. L’analyse pointue produite par Jean-Luc Chappey autour de la notice de Robespierre reflète la complexité de cette écriture, souvent renseignée, qui n’est pas sans conflits, débats, oppositions. Comme il le rappelle, les choix, la structuration, le récit écrit, notamment pour les biographies ou les batailles, témoignent d’une approche fournissant de beaux matériaux pour questionner ce qu’est l’écriture de l’histoire avec des élèves et pourquoi pas des étudiants.
L’analyse temporelle réalisée par Benjamin Deruelle et Stéphane Lamassé à partir des sources offertes par Wikipédia pour la notice « Jeanne d’Arc » affronte sans détour la complexité des techniques comme des méthodes que requiert la manipulation des données produites par l’encyclopédie. L’étude de l’écriture en volume dans le temps, couplée à une approche plus « qualitative », lexicale, permet d’isoler des périodes, des rythmes. Or, et c’est un point important, de nombreuses ressources du web font référence et pointent par des liens à des états de Wikipédia, mais renvoient, de fait, à la notice actuelle. Pouvoir remettre la production d’une notice dans un contexte plus large s’avère un moyen utile pour comprendre les usages qui sont faits de cette encyclopédie.
On l’aura compris, l’ensemble des contributions de ce volume ne traitent pas uniquement du rapport critique qu’il est nécessaire d’introduire entre l’historien et cette « donnée » qui ne possède pas le caractère d’évidence que l’on veut parfois lui accorder[34]. Il s’agit plutôt de proposer des protocoles d’étude, des essais. À ce propos, la contribution d’Éric Guichard est originale en ce qu’elle décrit la mise en place d’un outillage pour la construction d’une enquête sur les universités européennes dans la longue durée. Il articule une pensée sur la relation entre l’histoire et une autorité politique qui oriente la recherche et la production de connaissances nouvelles. Éric Guichard montre alors l’importance de la maîtrise de ces contraintes, inhérentes au fonctionnement institutionnel de la recherche, sans pour autant perdre de vue les enjeux scientifiques qui nécessitent de conjuguer des compétences techniques et épistémologiques pour la réalisation d’applications.
La Toile comme espace public
La question de l’écriture et de sa relation à de nouvelles autorités pose, entre autres, celle du rapport à l’espace public. L’histoire, comme tous les champs du savoir, est confrontée à cet aspect, soit parce que les historiens y interviennent, soit parce qu’ils étudient ce que cet espace public peut faire d’elle. Alain Dallo, Sébastien Ledoux et Denis Peschanski ont utilisé le blog de la série française Un village français pour essayer de comprendre les rapports à la mémoire, à l’histoire et à l’historien qui se tissent dans ces espaces conversationnels. Ici, le protocole multiplie les points de vue statistiques (analyse factorielle, analyse de réseaux sociaux, analyses sémantiques[35]) afin de tenir compte de la dimension réticulaire des échanges et de la diachronie liée à la structure de cette documentation.
Les espaces publics ouverts par le numérique sont pluriels et, comme vient nous le rappeler Damien Hamard, les restreindre aux grands réseaux sociaux, accessibles au plus grand nombre, est difficilement tenable. Son étude sur les listes de discussion des archivistes est centrée sur des corps de métier. Elle ne repose pas sur une fouille du web mais sur des documents émanant de réseaux institutionnels, compris dans l’internet. C’est un espace du système communicationnel qui s’est mis en place durant une quarantaine d’années et qui aujourd’hui est devenu un territoire pour l’analyse historique. Par cet article, fruit d’un travail de doctorat, Damien Hamard illustre également l’importance croissante qu’occupent ce type d’analyse dans les travaux académiques actuels.
Twitter est en revanche probablement un des réseaux sociaux les plus étudiés dans les sciences humaines et sociales[36], les sciences de l’information et de la communication, jusqu’au halo formé par les data scientists[37]. Autour d’une étude de cas d’histoire immédiate sur le référendum grec en 2015, Sofia Papastamkou a analysé cette documentation en historienne, c’est-à-dire avec une attention rigoureuse aux fragilités du corpus et des données qu’elle manipule. Face à la masse documentaire charriée par des flux difficilement appréhendables, avec une chercheuse qui se fait « moissonneuse », se trouve posée la question méthodologique de la représentativité des informations identifiées, récupérées pour être ensuite traitées. Une des particularités de ces études tient peut-être en effet dans l’archivage, compris comme recueil et conservation, que l’historien fait des tweets. D’une certaine façon, le travail qu’elle effectue sur ces archives dont on ne contrôle pas la pérennité offre un point d’ancrage pour les historiens futurs. Mais ceci pose dès lors la problématique d’une ré-expérimentation, espérée jadis par Jean-Philippe Genet[38], et dont l’horizon semble ici s’éloigner.
—
[1] Il s’est tenu les 6 et 7 juin 2016 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L’annonce est consultable sur Calenda (https://calenda.org/360039). Il était organisé par le LaMOP et le Pireh, le Pôle informatique de recherche et d’enseignement en histoire, créé dans les années 1990 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne par Jean-Philippe Genet et Julio Romero-Passerin d’Entrèves. Nous remercions chaleureusement les auteurs d’avoir accepté de publier des textes qui étonneront peut-être le lecteur, et donneront sans doute envie aux spécialistes d’y réagir.
[2] Stéphane Lamassé, Philippe Rygiel, « Nouvelles frontières de l’historien », Revue Sciences/Lettres, 2, 2014, https://journals.openedition.org/rsl/411, consulté le 25 février 2019, DOI : 10.4000/rsl.411.
[3] Williard McCarty, Humanities Computing, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005.
[4] Jean-Philippe Genet, « Être médiéviste au xxie siècle », dans Être historien du Moyen Âge au XXIe siècle, XXXVIIIe congrès de la Shmesp (Cergy-Pontoise, Évry, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines, 31 mai-3 juin 2007), Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 9-33.
[5] Philippe Rygiel, « L’enquête historique à l’ère numérique », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 58/4bis, 2011, p. 30-40. On peut se référer au dossier « Le métier d’historien à l’ère numérique : nouveaux outils, nouvelle épistémologie ? », coordonné par Nicolas Delalande et Julien Vincent.
[6] Interview de Catherine Calvet, « Un médiéviste est bien armé pour comprendre internet », 26 décembre 2013, http://next.liberation.fr/culture/2013/12/26/un-medieviste-est-bien-arme-pour-comprendre-internet_969055, consulté le 20 octobre 2017.
[7] Joseph Morsel, « Les sources sont-elles “le pain de l’historien” ? », Hypothèses, 7, 2004, p. 271-286.
[8] Aurélien Berra, « Pour une histoire des humanités numériques », Critique, 819-820, 2015, p. 613-626.
[9] Edgard Lejeune prépare actuellement une thèse de doctorat à Paris 7, sous la conduite de Karine Chemla en codirection avec Sheirley Carter-Thomas, dont le titre est Ce que l’ordinateur fait au travail de l’historien. Pour une histoire matérielle du tournant informatique des années 1980.
[10] On peut penser, entre autres, à la VIe Section de l’EPHE avec Marc Barbut, au Laboratoire de lexicométrie de l’École normale supérieure Saint-Cloud, à l’atelier « L’histoire et l’historien face au quantitatif » conduit par Claire Lemercier et Claire Zalc à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, ou encore au PIREH à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
[11] Par exemple, Christine Ducourtieux, Marie-Anne Polo de Beaulieu, « Ménestrel ou médiévistes sur l’internet, sources, travaux, références en ligne », dans Jean-François Soulet, Éric Castex (dir.), L’informatique dans l’enseignement de l’histoire et la formation des historiens, actes du Ve colloque de l’Association française pour l’histoire et l’informatique, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 317-325.
[12] Rolando Minuti, Internet et le métier d’historien, Paris, PUF, 2002.
[13] Rapport Internet et les chercheurs, élaboré à l’ENS (Daniel Béguin, Christine Ducourtieux, Éric Guichard, Rupert Hasterok et Frédéric Zana) dès 1995 et remis au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Direction de l’information scientifique et technique des bibliothèques, juillet 1998).
[14] http://barthes.ens.fr/colloque99, consulté le 20 octobre 2017.
[15] http://www-sop.inria.fr/axis/cmi, consulté le 20 octobre 2017.
[16] La carte interactive proposée par le DARIAH représente bien la diversité des digital humanities, https://registries.clarin-dariah.eu/courses/, consulté le 18 janvier 2018.
[17] Compte tenu de l’abondance et de la diversité des références, il serait vain d’entreprendre ici la réalisation d’une liste exhaustive ; on peut néanmoins en citer quelques-unes dans des directions complémentaires : la table ronde de la Société d’histoire moderne et contemporaine, « Le métier d’historien à l’ère numérique », organisée le 12 mars 2011 ; la journée d’étude organisée à Toulouse le 13 juin 2013, « L’histoire numérique/Digital History », par le laboratoire Framespa ; les journées d’études organisées les 1er et 2 décembre 2014 à l’EHESS par l’atelier Recherches et pratiques historiographiques sur le thème « Entre outil et culture. Le numérique un défi pour l’historiographie » ; la journée organisée le 30 juin 2015 par le PAMAL et le projet ANR WEB90 intitulé « Entre archéologie et histoire du Web », mais aussi des publications comme Jean-François Soulet, Éric Castex (dir.), L’informatique dans l’enseignement de l’histoire et la formation des historiens, op. cit. ; Serge Noiret, Philippe Rygiel (éd.), Les historiens, leurs revues et Internet, Paris, Publibook, 2005 ; « Internet et mouvements sociaux : nouvelles pratiques militantes, nouvelles sources pour l’histoire », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 79, 2005 ; « Le métier d’historien à l’ère numérique : nouveaux outils, nouvelle épistémologie ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 58/4bis, 2011 ; Jean-Philippe Genet, Andrea Zorzi (éd.), Les historiens et l’informatique, un métier à réinventer, Rome, École française de Rome, 2011 ; « Histoire de l’Internet, l’Internet dans l’histoire », Le Temps des médias, 18, 2012.
[18] Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Seuil, 1997 [1989], p. 23.
[19] On peut penser à l’exemple de la Venise Time Machine qui s’étend aujourd’hui à plusieurs projets européens. Cette perspective peut apparaître nouvelle dans la mesure où la construction du récit historique repose plus généralement sur des données que l’on pourrait qualifier de low data (données floues, ténues, parcellaires, etc.).
[20] Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1952 [1949].
[21] Olivier Ertzscheid, Gabriel Gallezot, Brigitte Simonnot, « À la recherche de la “mémoire” du web : sédiments, traces et temporalités des documents en ligne », dans Christine Barats (dir.), Manuel d’analyse du web, Paris, Armand Colin, 2013, p. 53-73.
[22] Danah Boyd, Kate Crawford, « Six Provocations for Big Data », texte de la conférence « A Decade in Internet Time », Symposium on the Dynamics of the Internet and Society, Oxford, 21 septembre 2011. On pourra consulter aussi le livre de Patrick Manning, Big Data in History, Basingstoke, Palgrave, 2013.
[23] Gérard Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, Belin, 1996.
[24] Laurence Monnoyer-Smith, « Le web comme dispositif : comment appréhender le complexe ? », dans Christine Barats (dir.), Manuel d’analyse du web, op. cit., p. 12-13.
[25] L’expression n’existe pas vraiment, on peut observer la fortune d’autres locutions comme « révolution numérique » ou « informatique ». Ainsi dès la fin des années 1960, le qualificatif révolutionnaire est accolé à l’informatique (voir, par exemple, parmi de nombreuses autres productions, Daniel Garric, L’informatique révolution totale, Paris, Publications premières, 1969) et la progression de son usage semble marquer un tassement sensible autour des années 1980 avant un recul effectif vers les années 2000, au profit du terme numérique. Ces éléments, obtenus à partir de Google Ngram Viewer pour une requête croisant les expressions « révolution informatique » et « révolution numérique », mériteraient d’être fouillés. Une étude diachronique serait probablement intéressante pour dépasser ces tendances observées à partir d’un corpus dont nous n’avons pas la maîtrise. Et cela d’autant plus que les études synchroniques sur les termes, comme « numérique », sont plus nombreuses. Voir par exemple Alexandre Moatti, « Le numérique rattrapé par le digital ? », Le Débat, 1/188, 2016, p. 68-72, https://www.cairn.info/revue-le-debat-2016-1-page-68.htm, consulté le 20 janvier 2018, DOI : 10.3917/deba.188.0068.
[26] Les remarques critiques proposées par Jean-Philippe Genet à partir des moteurs de recherche ne sont pas sans rappeler celles faites par Philippe Rygiel dans son article « L’ordinateur, le réseau et l’écriture de l’histoire », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2/82, 2006, p. 75-79, https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2006-2-page-75.htm, consulté le 18 janvier 2018.
[27] Niels Ole Finnemann, « Hypertextual Relations in Digital Born Materials Hypertext and Time: Towards a Genre Analysis of Heterogeneous Digital Materials », RESAW Conference, Aarhus University, Danemark, 8-10 juin 2015.
[28] Alain Desrosières, L’argument statistique. Pour une sociologie historique de la quantification (tome I) et Gouverner par les nombres (tome II), Paris, Presses de l’école des Mines, 2008.
[29] Dominique Cardon, « L’ordre du web », Médium, 29, « Réseaux : après l’utopie », 2011, p. 9-21.
[30] Antoine Prost, « Les mots », dans René Rémond, Pour une histoire politique, Paris, Seuil, 1988, p. 255-285.
[31] Soulignons toutefois la mise en question du web sémantique par François Rastier dans « Sémantique du web vs Semantic Web ? Le problème de la pertinence », Syntaxe et sémantique, 9/1, 2008, p. 15-36.
[32] On peut citer, entre autres, les travaux de Louise Merzeau et encore Serge Noiret.
[33] Lionel Barbe, Louise Merzeau, Valérie Schafer (dir.), Wikipédia, objet scientifique non identifié, Nanterre, Presses universitaires de Paris-Ouest, 2015 ; Frédéric Kaplan, Nicolas Nova, Le miracle Wikipedia, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2016.
[34] On peut penser à la réflexion de Bruno Latour proposant d’appeler les « obtenues » en lieu et place des « données » (Bruno Latour, L’espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l’activité scientifique, Paris, La Découverte [Armillaire], 2001).
[35] Les auteurs n’hésitent pas à recourir à l’évaluation de méthodologies plus contemporaines, notamment un algorithme développé pour l’analyse des réseaux de textes (voir https://linkage.fr/).
[36] Voir notamment Frédéric Clavert, « Échos du centenaire de la Première Guerre mondiale sur Twitter », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 121-122, 2016, p. 18-25.
[37] Louise Merzeau « Twitter, machine à faire et défaire l’autorité », Médium, 34/1, 2013, p. 171-185.
[38] Jean-Philippe Genet, « Histoire, informatique, mesure », Histoire & Mesure, 1/1, 1986, p. 7-18.